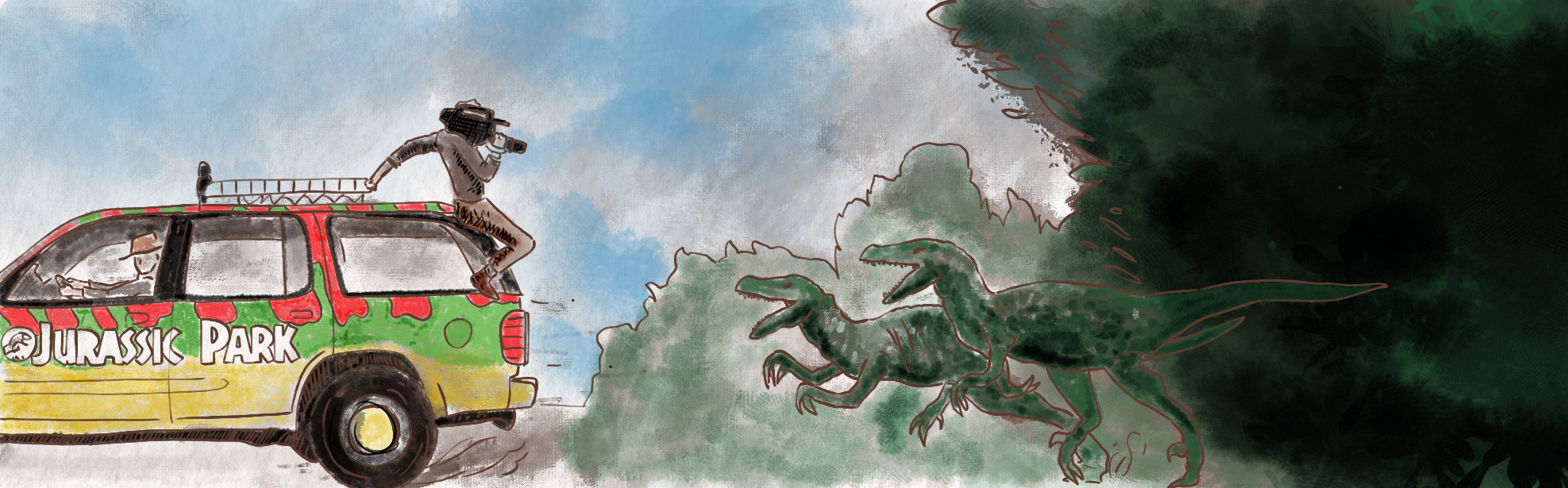
Jurassic Park ou les dinosaures-attractions. Pour une cinématographie cynégétique
Strange attractors ? Dr. Sattler, I-I refuse to believe that you aren’t familiar with the concept of attraction 1.
Le dinosaure-attraction
S’il possède bel et bien une existence littéraire, le dinosaure de lettres peine à émerger davantage que comme élément de décor, alimentant en poncifs (ce que traduit d’ailleurs la confusion quant à ce qui relève ou non du dinosaure) la littérature de vulgarisation aussi bien que le roman d’aventures 2. Son devenir de sujet poétique s’éclipse quant à lui aussi vite que la poésie qui, toujours au XIXe siècle, donne corps à sa bizarrerie linguistique et rend compte de son potentiel mélancolique 3. N’en déplaise aux formes de la matière littéraire, des incongruités revendiquées des poètes aux hypotyposes d’un Conan Doyle, c’est dans l’image et, plus encore, dans l’image animée que l’on trouvera réponse au désir de spectaculaire auquel invite le dinosaure.
C’est au cinéma qu’il revient très vite de relever le défi technique de monstration du dinosaure ; un défi dont le cinéma s’empare comme d’un pari lancé quant aux difficultés qu’il se propose de dépasser, aussi bien que des impossibles qu’il se promet de transgresser. Le dinosaure permet à ce titre de tester les capacités de l’image cinématographique et, partant, de cultiver à la fois son savoir-faire et son savoir faire-voir.
Après Winsor McCay, premier à rendre vie au dinosaure à partir de milliers de dessins qui seront le support d’une animation bien connue (Gertie the Dinosaur, 1914) c’est au tour de Willis O’Brien d’innover, en trouvant dans le dinosaure (mais pas seulement) l’occasion d’un premier film d’animation en stop motion (The Dinosaur and the Missing Link : A Prehistoric Tragedy, 1915). Il sera suivi en 1918 de The Ghost of Slumber Mountain, véritable succès de box-office qui donne un indice déjà de la rentabilité du dino-spectacle (cela, les visiteurs du Crystal Palace lors de l’Exposition Universelle de Londres en 1851 l’avaient déjà compris). Son succès vaudra à O’Brien d’être choisi pour réaliser les effets spéciaux du Lost World de Harry Hoyt en 1925, puis du King Kong de Merian Cooper et Ernest Schoedsack en 1933. Notons que dans la première version cinématographique du classique de Conan Doyle, le professeur Challenger rapporte en Angleterre non pas un ptérosaure mais un brontosaure qui finit par s’échapper, terrifiant les foules londoniennes. Dans cette scène, un classique du motif du « monstre dans la ville », le dinosaure rencontre littéralement son public, suscitant effroi et panique. Cette scène ne concourt pas pour rien dans la réussite commerciale du film : la rencontre entre le dinosaure et les foules nourries au divertissement est à la fois une préfiguration de la place désormais incontournable du dinosaure dans la production grand spectacle, et une façon de dramatiser un dinosaure qui ne se suffit plus à lui-même, ainsi que le revendique plus tard le successeur de O’Brien, Ray Harryhausen :
Nous ne faisons pas des films pour des paléontologues. Si vous vous contentez de montrer un groupe de dinosaures qui courent en aboyant, il n’y a aucun effet dramatique. Pour cela, il faut ajouter des humains ! […] Il n’y a aucun humain dans Sur la terre des dinosaures (série télévisée de la BBC). C’est bien plus réaliste, mais ils ont essayé de faire des dinosaures qui conviennent aux paléontologues ; notre but n’est que de divertir ! Et on ne divertit personne avec un dinosaure mâchouillant un autre dinosaure 4 !
Mais c’est le geste de création cinématographique présidant à la mise à l’écran des dinosaures que nous retenons ici, ce geste étant à la fois répété et mis en scène dans le Jurassic Park de Steven Spielberg (1993), dont il constitue ce faisant la matrice.
Le dinosaure apparaît donc comme une forme susceptible de rappeler que le cinéma demeure avant tout une machine à faire voir proposant une prouesse technique vantée pour elle-même. Contre la tendance qui consisterait à penser les productions cinématographiques à partir d’outils littéraires et, plus précisément, d’outils fictionnels qui envisagent le cinéma comme une machine à raconter des histoires, le spectaculaire dinosaurien, désormais archétypal des productions dites grand public, engage une réflexion quant à la nature du matériau cinématographique. Tom Gunning distingue à ce titre deux modalités, attraction et narration, qui ne sont pas seulement deux manières d’œuvrer le cinéma mais également deux attitudes d’analyse devant l’image cinématographique :
L’attraction, en tant que concept théorique d’une part, pratique esthétique de l’autre, contrebalance la tendance à privilégier les structures narratives dans l’analyse du cinéma, à faire comme si l’histoire fournissait le noyau de la majorité des films et que les autres aspects visuels et formels offrent tout au plus un revêtement décoratif 5.
Le terme d’attraction, emprunté à Sergueï Eisenstein, met l’accent sur la nature première du média cinématographique, à savoir une machinerie qui relève, ainsi que le rappelle Viva Paci, du dispositif au même titre que l’attraction de cirque ou de foire. Le spectaculaire de l’attraction tend ainsi vers une autoréférentialité du cinéma. À la suite de Gunning, Paci souligne que la distinction attraction/narration (à laquelle nous pourrions substituer la distinction spectaculaire/récit) engage une double temporalité cinématographique : si « la narration implique une trajectoire, une progression vers un but », donc un temps long pensé comme développement et résolution, l’attraction demeure quant à elle ponctuelle, elle se réaliserait dans la soudaineté, et n’indique pas de « progression vers un but prévisible 6 » : elle n’est que le cinéma lui-même qui s’affiche comme cette machine qui donne à voir et dont participe, entre autres, la culture des monstres – la machine à monstration, nous le savons depuis longtemps, est une machine à monstres.
Si la galerie de ces derniers est vaste, chacun ne manque pas d’interroger et d’activer des modalités particulières. Stephen Jay Gould revient sur la fascination spécifique exercée par le dinosaure :
J’ai demandé une fois à mon collègue Shep White, l’un des chefs de file en matière de psychologie enfantine, pourquoi les gosses s’intéressent tellement aux dinosaures. Il m’a donné une réponse à la fois succincte et élégante : « Ils sont grands, féroces et éteints. » J’aime beaucoup cette réponse, mais elle ne peut pas résoudre la question qui a motivé cet essai. Les dinosaures étaient aussi grands, féroces et éteints, il y a vingt ans, mais la plupart des gosses ou des adultes s’en souciaient comme de l’an quarante. Aussi je persiste à demander : comment a débuté la vogue actuelle des dinosaures 7 ?
Si la réponse est effectivement insuffisante, elle a néanmoins le mérite de rappeler que non seulement le dinosaure apparaît comme spectaculaire en soi, mais encore permet-il au cinéma de s’afficher comme machine à spectaculaire en étant le lieu de résurrection du spectaculaire éteint. Figure de l’extrême, du record, de la performance, du superlatif, le dinosaure apparaît très tôt comme un agent pertinent du défi visuel que propose de relever l’industrie cinématographique, désireuse de se présenter comme le lieu de représentation de l’irreprésentable : « Entrés en correspondance, le rêve de dinosaures et le rêve de machines autrement contemporaines s’associent par le flux de désir qu’ils produisent 8. »
Le dinosaure des origines
En 1993 avec Jurassic Park, Steven Spielberg s’inscrit lui-même dans un processus métadiscursif : en s’emparant d’un récit mettant en scène un parc d’attractions animalières, il s’agissait précisément de faire du cinéma qui parlerait du cinéma lui-même, formulant la promesse du « jamais vu » chère aux Lumière.
C’est que, rappelle Tom Gunning,
La forme originelle de l’attraction équivaut à la forme originelle du cinéma ; avant d’être une machine à nous raconter des histoires, c’est une machine qui nous fait voir et une machine qui montre. L’acte de voir peut paraître aller de soi. Il peut être émoussé par l’habitude et la familiarité. Le rôle du cinéma est de rompre avec la familiarité routinière qui recouvre notre perception quotidienne en rendant celle-ci étrange, nouvelle et à nouveau puissante, comme si nous découvrions les choses pour la première fois. Aussi complexe que puisse être l’attraction à l’intérieur d’un texte cinématographique complet, son essence reste cet acte de monstration, d’exposition à un spectateur. Cet acte renouvelle la perception dans toute son intensité 9.
Incarnant le passé, le dinosaure permet précisément à Spielberg de donner corps à ce cinéma des origines, assumant, dans le renouvellement technique, la réalisation d’un cinéma nostalgique des premiers âges. Du cinéma à voir du cinéma, en somme.
En effet, que se passe-t-il dans Jurassic Park, sinon que la mise en scène du désir d’un homme de montrer des monstres à d’autres hommes, et ce pour la première fois, « [renouvelant] la perception dans toute son intensité » ? Le parallèle entre John Hammond et Steven Spielberg est à ce titre éloquent, le personnage du « montreur » étant présenté comme un illusionniste par l’évocation de sa première attraction : un cirque de puces, merveilleuses d’inexistence.
C’est bien une invitation à voir « pour la première fois » que lance John Hammond à Alan Grant et Ellie Sattler dont la perception, jusque-là, ne pouvait être que fragmentaire, comme fragmentaires les dinosaures inanimés d’os et de sable dont ils font la découverte 10.
La métaphore cinématographique et son parallèle avec l’attraction foraine engagent une fiction de l’emprisonnement, dans laquelle les personnages sont littéralement mis à la merci du spectaculaire. Parodiant par effet d’exagération les critiques habituellement formulées à l’encontre du cinéma grand spectacle et, plus généralement, du spectaculaire 11, Spielberg joue du « piège spectaculaire » en multipliant les principes de réclusion et de clôture (insularité, parcours-type en voiture sur rail, clôtures électrifiées, mise en scène du dispositif d’attache des attractions foraines lors de la présentation animée, verrouillage informatique…) et en insistant sur le désir des personnages d’échapper à cette réclusion. Le plaisir cinématographique se nourrit alors aussi bien du spectacle de la prise au piège spectaculaire que de la nécessité de s’en éveiller (repousser les barres de maintien lors de la présentation animée, sortir de la voiture lors du parcours-type, et bien sûr s’échapper de l’île).
L’assimilation du parc à une attraction est au demeurant pleinement assumée dès l’arrivée des personnages sur l’île : aux secousses de l’hélicoptère prêt à atterrir, John Hammond conseille à chacun d’attacher sa ceinture, signifiant discrètement que le « manège » s’apprête à démarrer ; une scène qui préfigure par ailleurs des dysfonctionnements à venir puisque la ceinture d’Alan Grant comprend une malfaçon et ne se ferme pas.
Arriver sur l’île revient à pénétrer un univers instable de débordements en tous genres. Un univers qui se révèle fidèle au portrait que fait Viva Paci du cinéma-attraction :
Les roulements de trucages, les prestidigitations et les vues stupéfiantes soutenaient et même fondaient ce cinéma. Le sens du spectacle qu’offraient les films des premiers temps pourrait être résumé dans l’idée que le spectateur était confronté à des images instables, à des présentations en coups d’éclats. Des éclats de présence, donc, créés pour le plaisir de la vision-apparition, immédiate et fugace, presque des épiphanies, et éventuellement retardés pour accroître la jouissance liée à leur surgissement 12.
Les dinosaures constituent ici, au-delà des « vues stupéfiantes » qui ne manquent pas, l’attraction intradiégétique et extradiégétique du film. Après l’arrivée sur l’île, l’entrée dans le parc est à son tour placée sous le signe de l’entrée dans le royaume du spectaculaire, ce que symbolise assez facilement le franchissement de la gigantesque porte d’entrée, qui est aussi le moment de l’entrée des personnages dans les territoires du wild – entendu ceux de la découverte et de l’aventure de la perception. Une aventure du regard, d’abord, qui conjugue le retour au primitivisme dinosaurien, le primitivisme du cinéma-attraction (cinéma dit « des origines » ou « des premiers temps »), ainsi qu’un primitivisme spectatoriel qui se traduit chez Spielberg par un « retour de l’enfance du regard et l’aveu d’un besoin de sidération 13 ». Primitivisme de la sensation, donc, que recouvre la dimension onirique du film (pensons notamment à la scène des brachiosaures qui, à 01:19:05 forme un véritable tableau en même temps qu’une pause explicite, puisque le « chant » des dinosaures accompagne le sommeil des personnages).
Reste que les dinosaures spielbergiens doivent laisser les personnages bouche bée, immobiles et muets, traduisant dans l’image ce que l’image elle-même supposément produit chez un spectateur soumis à la démesure du spectaculaire. Une esthétique de la sidération est ainsi mise en œuvre. Ellie Sattler devant le brachiosaure dans un système de plongée/contre-plongée qui traduit le dépassement (00:19:20), Alan Grant devenant (et imposant à Lex de devenir) nature morte et figée devant le tyrannosaure devenu nature vive (01:05:25), ressuscitée par la technique, ou encore le jeune garçon sermonné par Alan (00:07:15), sont autant de scènes où la respiration doit faire défaut, où le dinosaure impose le silence dans un renouvellement cinématographique du sublime :
La passion causée par le grand et le sublime dans la nature […] est l’étonnement, c’est-à-dire un état de l’âme dans lequel tous ses mouvements sont suspendus par quelque degré d’horreur. L’esprit est alors si complètement rempli de son objet, qu’il ne peut en concevoir d’autre ni par conséquent raisonner sur celui qui l’occupe. De la vient le grand pouvoir du sublime qui, loin de résulter de nos raisonnements, les anticipe et nous entraîne avec une force irrésistible 14.
On se souvient que pour Burke le sublime est conditionné à l’exercice de la terreur, à laquelle s’ajoute l’obscurité dans son sens le plus étendu, à savoir la méconnaissance des contours de ce qui nous fait face : « Lorsque nous connaissons toute l’étendue du danger, lorsque nous pouvons y habituer nos yeux, une grande part de l’appréhension s’évanouit 15. » L’obscurité est à ce titre pourvoyeuse d’insaisissabilité et d’incapacité à la familiarisation :
Je pense qu’il y a dans la nature des raisons pour lesquelles une idée obscure, convenablement rendue, doit affecter davantage qu’une idée claire. C’est notre ignorance des choses qui cause toute notre admiration et qui excite principalement nos passions. La connaissance et l’habitude font que les causes ne nous touchent que légèrement 16.
L’ignorance est chez Burke question de dimensions : surdimension temporelle de l’éternité, surdimension spatiale de l’infini. La perception, mise en échec par ces deux forces, ne peut s’en trouver que limitée, lacunaire :
Considérons que la grandeur peut difficilement frapper l’esprit, si elle ne se rapproche pas en quelque sorte de l’infini ; ce qui ne saurait arriver quand on perçoit des bornes. Or, saisir un objet directement et en percevoir les bornes est une seule et même chose 17.
La difficulté technique qui consiste à présenter des dinosaures dans leurs dimensions est donc au service du sublime, puisque cacher une partie des dinosaures (comme le sont, dans plusieurs scènes, le tyrannosaure, les vélociraptors ou le dilophosaure, c’est-à-dire ceux qui, précisément, représentent un danger immédiat) contribue en fait à en indéfinir les dimensions.
Quant à la dimension temporelle (l’éternité), centrale dans le sentiment du sublime, elle passe également par la vision en étant prise en charge, là encore, par le spectacle du dinosaure qui, dans sa seule présence, constitue une vertigineuse et en cela paradoxale rétractation du temps :
[…] dinosaurs and man, two species separated by sixty-five million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea, what to expect 18 ?
Une cinématographie cynégétique, ou persévérer dans l’étonnement
Les pouvoirs de la vision s’imposent comme motif central dès l’incipit du film. Dans cette scène d’ouverture, un ouvrier est littéralement happé par la créature (un vélociraptor) dans un plan oculaire (à 00:03:05 notamment) qui n’est pas sans rappeler le criminel sublime de Thomas De Quincey : « La pauvre imagination défaillait, vaincue, impuissante, fascinée par l’œil reptilien du meurtrier 19 » : le spectaculaire suppose bien, ici, un œil terrifié et soumis, un voir passif, et un faire voir actif, œil dominant qui ne laisse aucune chance à sa proie. L’esthétique de la sidération, mentionnée plus haut, se met ainsi au service d’une cinématographie cynégétique, le spectaculaire devenant la modalité privilégiée d’une prise en chasse du spectateur. Cette perspective cynégétique se manifeste dans ses effets intradiégétiques par des personnages affolés, poursuivis, coursés, eux-mêmes aux prises d’un cinéma de vision-apparition, d’immédiateté et de fugacité, de retardements pour accroître la puissance du surgissement, selon les formules employées par Viva Paci pour caractériser le cinéma des attractions. Dans Jurassic Park, les retardements sont nombreux. Symboliquement, aucun dinosaure ne se montre lors de la visite du parc par le groupe, sinon le tricératops dysfonctionnel. Les scènes de mise en absence ou en invisibilité se multiplient, comme un travail préparatoire à l’excès du surgissement : ainsi du dilophosaure qui ne se montre pas (00:40:25), du tyrannosaure qui ne fait guère mieux malgré la chèvre qu’on lui sert (à partir 00:42:30), mais aussi du jeu de cache-cache qu’entreprend ce même dilophosaure avec Nedry, lequel vient symboliquement de perdre ses lunettes, ou encore du garde-chasse Robert Muldoon qui, croyant avoir pris en chasse un vélociraptor à peine mais dangereusement visible (il n’est qu’un leurre pour le chasseur croyant chasser), n’aperçoit pas celui qui attend le bon moment pour le dévorer.
Surtout, la perspective cynégétique du spectaculaire permet à Spielberg de faire coïncider l’état des personnages et l’état du spectateur, à son tour inlassablement happé par une image qui cherche à faire contact avec lui en brisant l’interface de l’écran selon un effet saisissant de gradation. Le dinosaure apparaît tout d’abord, fossilisé et impuissant (si bien que la main d’Alan Grant suffit à en faire buguer l’image), par l’intermédiaire de l’écran d’ordinateur (00:06:07) ; dessin animé et plus proche d’un Gertie que d’un terrible prédateur, il apparaît ensuite sur l’écran d’une salle de cinéma dans les explications données par John Hammond quant aux techniques de clonage utilisées (de 00:24:15 à 00:26:00) ; vivant, il se cache comme le dilophosaure (00:40:25) ou, plus encore, comme les vélociraptors lors de leur déjeuner, derrière l’écran des feuillages (00:30:45) ; mortellement terrifiant, il s’en prend enfin aux enfants réfugiés dans la jeep : ne les sépare que la mince vitre du véhicule qui promet de se briser (de 01:02:00 à 01:03:35). Ce dernier passage est d’autant plus éloquent que le projecteur braqué par Lex double le procédé de projection cinématographique, la vitre représentant un écran désormais incapable de mettre à distance l’objet qu’il donne non plus seulement à voir, mais à vivre. Dès lors, les enfants en passe d’être pris dans la gueule du tyrannosaure sont bien ceux qui remplissent la salle, et la diversification des supports-écrans prêtés à l’image consommée fait oublier que le dinosaure est, avant tout, une image qui me consomme par sa puissance spectaculaire : « Les vitres sont brisées : l’émerveillement devant ce qui dépasse l’homme devient contact, mais un contact mortel 20 », résume Pierre Berthomieu.
De fait, dans un même mouvement, Spielberg propose de jouer sur l’ambivalence d’une alliance entre la sauvagerie de l’état de nature et la puissance technique : ainsi de la salle de contrôle informatique (01:48:00) qui voit poindre de l’autre côté de sa porte le représentant de la sauvagerie (le vélociraptor) et qui n’empêche pas son entrée (le système dysfonctionne et, ce-faisant, permet au prédateur de tenter une effraction, jusqu’à l’intervention de Lex). Par un retournement ludique, Spielberg rappelle que la puissance technique est au cœur de la puissance spectaculaire du cinéma, Jurassic Park offrant avec ses dinosaures un renouvellement technique qui ouvre, une fois encore, le placard de nos cauchemars.
Le film se clôt sur deux éléments conclusifs de cette partie de chasse cinématographique.
Le premier, c’est le surgissement ultime du spectaculaire qui vient en apothéose mettre fin à la déroute des personnages (01:52:25). L’irruption du tyrannosaure lors de cette scène finale réinvestit un classique du spectaculaire théâtral de façon presque littérale : le deus ex machina devient deus rex machina. Quant au message du réalisateur, s’il en fallait un, il s’inscrit en grosses lettres sur la banderole qui, s’effondrant, passe devant le roi des dinosaures : « When Dinosaurs Ruled the Earth », comme un attachement intact au cinéma spectaculaire et technique des premiers temps, aux monstres du passé.
En second lieu, la conclusion du premier comme celle du deuxième opus nous invitent à définir le spectaculaire comme le discours victorieux du spectacle sur le spectateur. Une victoire traduite par l’épuisement final des personnages : certains s’endorment dans l’hélicoptère à la fin du premier opus, et à la fin du deuxième la famille s’endort sur le canapé, devant la télévision, avec sur la table un bol de popcorn, Spielberg s’amusant lui-même (et assumant pleinement) de ce que Jurassic Park ait été rangé dans la catégorie des ‘popcorn movies’ ; de quoi, finalement, concilier le spectaculaire dans sa valeur émotionnelle et dans sa valeur commerciale, qui ne sont nullement antithétiques. Dans les deux cas, le sommeil des personnages dit la même chose : le spectaculaire, qui « permet à sa façon de parler du partage accru des ‟émotions collectives” 21 » l’emporte quand le spectateur est épuisé.
Le renouvellement des sens appelle, en quelque sorte, le repos du guerrier. La surenchère spectaculaire, souvent sujette à critique, répond au désir évoqué par Patrice Buendia de
[…] rendre au spectateur [sa] virginité, pour mieux la lui ravir – avec son consentement satisfait – dans un maelstrom de plaisir, de surprise et de sidération C’est bien évidemment là qu’on trouve le spectaculaire, il correspond exactement à cette perte de virginité 22.
À ce titre, la logique de la surenchère apparaît comme une fabrique à innovations, et le spectaculaire s’affiche en modalité d’élaboration d’outils nouveaux, de façons nouvelles de ressentir et/ou de se confronter collectivement à l’émotion. Un spectaculaire-laboratoire, en somme : d’intelligence, de savoir-faire, d’imagination, de sensations.
Patrice Buendia, comme beaucoup d’autres théoriciens du cinéma et du spectaculaire cinématographique, rend ainsi à son tour justice à Jurassic Park :
Je le répète : Spielberg fait partie de ces cinéastes qui courent après cette émotion originelle du Cinématographe. Une fois de plus, il a réussi. « Du jamais vu ! ». C’est ce qu’il a proposé, comme les Lumière. Même si les ficelles de son film ont déjà servi à maintes reprises, il a su donner à Jurassic Park la dimension spectaculaire qui a sidéré quelques dizaines, quelques centaines de millions de spectateurs. Les Lumière avaient pu se contenter d’un simple train, Spielberg, lui, doit avoir recours à un tyrannosaure 23.
Le rapprochement entre Spielberg et les Lumière confirme nos intuitions : Jurassic Park, en renouvelant les techniques, participe précisément d’un contrat originel du cinématographe, et semble indiquer que le spectaculaire cinématographique concourt à faire perdurer notre tradition de l’innovation, constituant une force de persévérance dans la connaissance de « ce qui étonne » et, partant, dans la connaissance de l’homme.
- Ian Malcolm dans Steven Spielberg, Jurassic Park, © Universal Pictures, Amblain Entertainment, 1993, 00:15:40.
- Nous renvoyons notamment à l’article de Jean Le Loeuff, « Dinos de lettres et d’os : dinosaures et littérature de 1836 à 1912 », Pop-en-stock, « Dinosaures et dinomaniaques », Matthieu Freyheit (dir.), en ligne, http://popenstock.ca/dossier/article/dinos-de-lettres-et-d%E2%80%99os-dinosaures-et-litt%C3%A9rature-de-1836-%C3%A0-1912.
- Nous renvoyons à l’article de Yohann Ringuedé, « Se souvenir des antédiluviens. Le dinosaure et la crise poétique dans la seconde moitié du 19e siècle », Pop-en-stock, « Dinosaures et dinomaniaques », Matthieu Freyheit (dir.), en ligne, http://popenstock.ca/dossier/article/se-souvenir-des-ant%C3%A9diluviens-le-dinosaure-et-la-crise-po%C3%A9tique-dans-la-seconde.
- Interview de Ray Harryhausen dans John Landis, Créatures fantastiques et monstres au cinéma, Hélène Zylberait (trad.), Paris, Flammarion, 2012 [2011], p. 148-149.
- Tom Gunning, « Rendre la vue étrange : l’attraction continue du cinéma des attractions », p. 15-29, in Viva Paci, La Machine à voir. A propos de cinéma, attraction, exhibition, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 19.
- Id., p. 20.
- Stephen Jay Gould, La Foire aux dinosaures, Paris, Seuil, 1993 [1991], p. 89.
- Matthieu Freyheit, « Dinosaur dreams. Et cette machine dans ma tête… », Pop-en-stock, « Dinosaures et dinomaniaques », Matthieu Freyheit (dir.), en ligne, http://popenstock.ca/dossier/article/%C2%ABdinosaur-dreams%C2%BB-et-cette-machine-dans-ma-t%C3%AAte.
- Tom Gunning, « Rendre la vue étrange : l’attraction continue du cinéma des attractions », op. cit., p. 28.
- Voir Matthieu Freyheit, « Nature morte, fiction vive : extinction et narration dans Jurassic Park », Cahiers ERTA, n°6, 2014, « Nature morte », Ewa M. Wierzbowska (dir.), p. 161-175.
- Voir Pascale Goetschel, « Le spectaculaire contemporain », Sociétés & Représentations, n°31, 2011/1, « Le spectaculaire à l’œuvre », Pascale Goetschel (dir.), p. 9-15.
- Viva Paci, La Machine à voir. A propos de cinéma, attraction, exhibition, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 31.
- Pierre Berthomieu, Hollywood moderne : le temps des voyants, Pertuis, Rouge Profond, 2011, p. 546.
- Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Baldine Saint Girons (trad.), Paris, Vrin, 2009 [1757], p. 119-120.
- Id., p. 122.
- Id., p. 126.
- Id., p. 128.
- Alan Grant dans Steven Spielberg, Jurassic Park, © Universal Pictures, Amblain Entertainment, 1993, 00:36:05.
- Thomas De Quincey, De l’Assassinat considéré comme un des beaux-arts, Pierre Leyris (trad.), Paris, Gallimard, 1995 [1854], p. 128.
- Pierre Berthomieu, « Le Monde perdu : le signe qui tue », Positif, n°441, novembre 1997, p. 55-57, p. 56.
- Pascale Goetschel, « Le spectaculaire contemporain », Sociétés & Représentations, n°31, 2011/1, « Le spectaculaire à l’œuvre », Pascale Goetschel (dir.), p. 9-15, p. 15.
- Patrice Buendia, « Du jamais vu ! Le spectaculaire et les effets spéciaux au cinéma », p. 137-144, in André Gardies, Christine Hamon-Sijérols, Le Spectaculaire, Lyon, Aléas, « Les Cahiers du GRITEC », 1997 p. 141.
- Id., p. 143.
