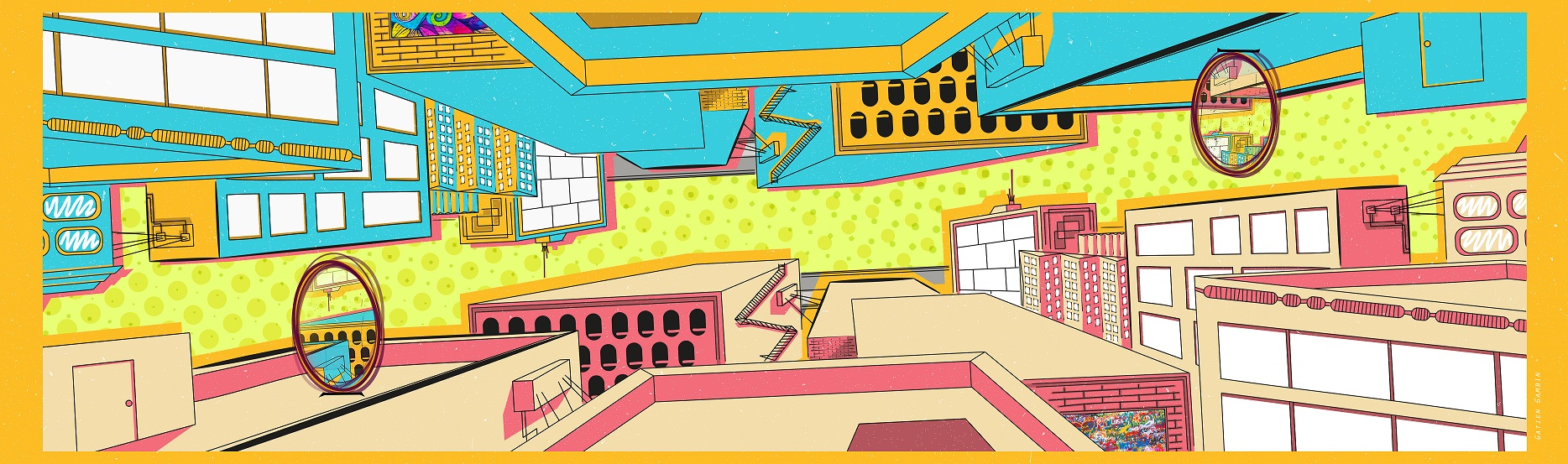
Le musée : espace de représentation(s), espace de narration(s)
À l’entrée « Représenter » Le Dictionnaire de muséologie indique que « le musée apparaît comme l’un des dispositifs par excellence de la représentation du réel et de l’histoire, en recourant à de multiples moyens de représentations, notamment l’exposition d’objets authentiques 1 ». Toutefois, ces « objets authentiques », également appelés « vraies choses » (real things), valent dans le musée comme des « substituts de la réalité de laquelle [ils] ont été prélevés et qu’[ils] représentent 2 » : le processus de muséalisation neutraliserait ainsi la nature des objets qui deviennent, une fois franchi le seuil du musée, des œuvres muséales, des muséalies.
Pour autant les objets prélevés – et privés – de leur environnement naturel continuent à dialoguer avec l’extérieur, c’est pourquoi le musée qui les expose en est le responsable, au sens étymologique, c’est-à-dire qu’il en est le garant et qu’il doit répondre d’eux. D’abord pour des raisons évidentes de conservation et de transmission (garant physique) ; ensuite, pour le discours qu’il élabore à leur sujet (garant moral). C’est une fonction essentielle qui est largement soulignée de nos jours : le musée est pourvoyeur de sens, c’est un herméneute qui propose un point de vue, un récit autour de ses collections. La représentation au musée a donc partie liée avec la Fable. La place publique n’est cependant pas toujours en phase avec la narration échafaudée au sein des musées, c’est pourquoi les récits muséaux font l’objet de réécritures régulières, avec le concours d’acteurs toujours plus nombreux et diversifiés. Autant d’éléments qui invitent à réfléchir au caractère lisible ou illisible du musée dans un cadre spatio-temporel déterminé : correspond-il ou non aux horizons d’attente des visiteurs ? La représentation des objets au sein de l’espace muséal se penserait, en conséquence, en termes d’écart ou non vis-à-vis de la doxa.
Dans son étude proposée à l’occasion de la Chaire 2021 du Louvre 3, Neil MacGregor distingue cinq objets qui colorent les actuels discours muséaux : l’émergence des communautés, la résurgence des nationalismes, le retour au religieux, le solde du passé colonial et les questions environnementales. Ce sont autant de facteurs a priori exogènes au musée mais qui l’enjoignent en permanence à clarifier sa position à leur sujet et à se remodeler en profondeur si nécessaire : à n’en pas douter, le récit muséal doit prendre un tournant éthique. Un des enjeux majeurs de ces nouveaux défis se cristallise autour de la question, entre autres, de la décolonisation des musées, qui induit celle, encore plus sensible et technique, de la restitution, portée notamment en France par le rapport Sarr-Savoy 4 à la suite du discours du Président Macron à Ouagadougou en 2017. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte global qui s’attèle à enrayer tous les symboles résiduels de la période coloniale : tous les arts sont concernés. En réalité, à travers l’espace muséal, ce sont les anciennes politiques d’acquisition des œuvres durant la période coloniale qui sont vivement contestées et le musée est parfois présenté comme un lieu immoral à la place des dirigeants eux-mêmes. Il est donc le réceptacle idéal des critiques adressées à un régime politique. De nos jours les professionnels du champ muséal traitent ces sujets épineux pour les transformer en objets de discussion plurimédiatiques. Que l’on songe, par exemple, au récent accrochage pluriannuel Récits postcoloniaux proposé par le musée des Beaux-arts de Nancy qui interroge les anciens récits de la conquête d’Algérie à travers une exposition-dossier, des conférences et un film réalisé pour l’occasion. La réécriture est d’autant plus participative qu’elle associe un projet pédagogique en incluant des lycéens nancéiens en section britannique.
L’espace muséal se présente ainsi comme un espace privilégié de régulation des mœurs, fonction qu’il remplit depuis sa naissance. Le musée moderne a été sommé d’évacuer ou de réévaluer les symboles des mondes passées, comme le rappelle Krzysztof Pomian dans le deuxième tome de la magistrale somme sur l’histoire des musées :
Encore faut-il établir à quels critères doit satisfaire une œuvre pour mériter d’y être exposée. Qu’elle ne saurait être médiocre va de soi. Mais, dans le climat terroriste de la première année du musée, il faut, en outre, qu’elle soit acceptable pour un regard révolutionnaire qui ne souffre pas d’être confronté aux symboles et emblèmes de l’Ancien Régime 5.
Deux attitudes se sont simultanément et durablement polarisées autour de ce débat : celle de la préservation des œuvres (pour des critères esthétiques et pédagogiques) et celle de leur destruction ou de leur mise à l’écart (pour des critères éthiques). Elles constituent les deux points magnétiques vers lesquels les avis convergent lorsqu’il s’agit du futur d’une œuvre : lorsque celle-ci ne correspond pas à la pensée dominante (licence vis-à-vis des horizons d’attente) sa survie dépend principalement de son intérêt plastique ou éducatif et de la rhétorique de ses défenseurs. Pour autant sa survie n’est assurée que pour un moment déterminé. En effet, en dépit de l’éclatement culturel et artistique propre à notre siècle qui répudie l’idée de normes, des œuvres jugées acceptables auparavant sont aujourd’hui rejetées, sinon menacées, notamment si l’artiste qui les a réalisées est jugé comme étant immoral. Toutefois, dans la mesure où la première attitude ressort majoritairement triomphante, il faut sans cesse que le musée adapte le récit sur ses collections afin que celles-ci ne soient plus des objets de répulsion mais, sans nécessairement être des objets d’approbation, des objets de discussion : les œuvres d’art peinent bien à se présenter au suffrage. Le récit autour de l’œuvre est donc un médiateur nécessaire entre un public et une œuvre.
Si la narration du musée se heurte aux soubresauts de l’iconoclasme et à la censure depuis sa naissance, il est vrai que ce mouvement s’intensifie aujourd’hui à la faveur des considérations éthiques aigües de notre société, elles-mêmes relayées par les multiples moyens d’expression. Le musée doit donc trouver des solutions pour refléter les aspirations de l’époque. Toutefois, géant empêché à bien des égards, il ne peut pas s’ajuster facilement à toutes les demandes extérieures, ne serait-ce que pour des raisons matérielles. Nous proposons l’étude non exhaustive de deux d’entre elles. La première est la quête d’une langue muséale en phase avec le monde : il s’agit de redéfinir le musée et de représenter le monde actuel à travers le lexique muséal. La seconde concerne la littérature contemporaine qui se présente comme un espace exempt de toutes contraintes et dans lequel l’objet muséal est remodelé à l’envi.
1. Une langue muséale en phase avec les nouveaux horizons d’attente
Depuis sa création en 1946 le Conseil International des Musées (ICOM) s’efforce de définir ce qu’est « le » musée parmi la diversité des structures-membres. La définition a connu huit refontes (1951, 1961, 1974, 1989, 1995, 2001, 2007, 2022). Il est en effet difficile de stabiliser une phraséologie et un lexique qui représenteraient de manière pérenne une structure en perpétuelle mutation et aussi polymorphe, sinon abstraite, qu’est le musée. Comme le rappelle Juliette Raoul-Duval lors de la journée des Comités de l’ICOM portant sur le sujet « de quelle définition les musées ont-ils besoin ? » le mot musée n’est pas une « appellation protégée 6 » – la lexicographie généraliste possède aussi sa propre définition, il y autant d’acceptions que de dictionnaires – mais la définition du Conseil International se distingue car elle est le résultat d’un long processus et d’un travail collégial impliquant de nombreux professionnels des musées à l’échelle internationale, d’où l’importance d’une telle journée d’étude. Nous ne revenons pas sur l’évolution entre les différentes définitions depuis 1946 car son analyse a été menée par François Mairesse 7 ; nous nous intéressons uniquement aux changements entre la définition de 2007 et celle de 2022, en partant du postulat que la nouvelle définition en vigueur reflète plus que jamais les horizons d’attente de notre époque.
En ce qui concerne l’architecture des deux définitions, on constate aisément la présence de trois traits similaires. Le premier rend compte de la nature de l’institution muséale (une institution permanente sans but lucratif au service de la société) et reste majoritairement constant entre les deux définitions. Le deuxième fait état des principales missions assignées au musée dans lequel certains sèmes ont été remplacés : par exemple, la recherche (2007) devient l’étude (2022) ; l’acquisition (2007) devient la collecte (2022). La nuance de sens est infime entre le sème « recherche » et le sème « étude », bien qu’elle suggère un cadre méthodologique tourné non plus exclusivement vers la quête mais également vers l’approfondissement des connaissances. En revanche, parler de collecte plutôt que d’acquisition donne un sens moins restrictif à la définition, notamment parce qu’elle s’adresse aussi bien aux professionnels du monde muséal qu’aux profanes. En effet, dans le jargon muséal, l’acquisition est « l’activité qui consiste à collectionner intentionnellement des objets présentant des points communs, mais aussi des différences […] 8 » ; tandis que dans la lexicographie généraliste, l’acquisition relève avant tout du fait de « devenir propriétaire d'un bien, à titre gratuit ou onéreux 9», ce qui, appliqué au champ muséal, a d’emblée une connotation péjorative puisque l’acte de propriété ressort. Par ailleurs, pour le non-spécialiste, la collecte se fait toujours au profit de quelqu’un ou de quelque chose, ce qui conforte l’idée que le musée est bien « au service de la société ». Dans les faits, la législation qui encadre la majorité des musées – le caractère inaliénable et imprescriptible des collections – n’est pas modifiée selon que l’on parle de collecte plutôt que d’acquisition, mais l’on décèle une atténuation ou une euphémisation de cet acte dans la nouvelle définition proposée par l’ICOM. À l’heure où les politiques d’acquisitions passées sont de plus en plus contestées, remplacer le sème acquisition par le sème collecte permet, non pas de les effacer, mais de les nuancer. Par ailleurs, dans la définition de 2007, un troisième trait rend compte de la finalité de ces missions, qui répondrait aux questions « pourquoi exposer ? », « pourquoi transmettre ? ». Il s’agit de l’étude, de l’éducation et de la délectation. On retrouve des sèmes supplémentaires dans la définition de 2022, notamment le sème « réflexion », qui invite le visiteur à être actif dans le musée et à porter un regard critique sur ce qui est représenté, sur le point de vue proposé : il serait donc un co-écrivain du récit muséal qui ne s’actualise et ne se régénère qu’à condition d’être vu et lu.
L’évolution notoire de la nouvelle définition tient, toutefois, à l’ajout d’un nouveau trait entre la nature, les missions et la finalité des missions : les moyens. Il ne s’agit plus de savoir pourquoi le musée doit répondre à des missions mais comment il y répond. Ce sont les modalités qui sont clairement révélées : en étant « accessible », « inclusif », en « encourageant la diversité et la durabilité » et en « communiquant de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés ». En somme, le musée doit être transparent. Autant d’adjectifs et de substantifs qui sont au centre des préoccupations de notre société et que l’ICOM désigne comme étant des mots-clés : les horizons d’attente des visiteurs sont bel et bien réverbérés, enregistrés par l’actuelle définition, ce qui atteste de leur prise en compte par les professionnels du monde muséal à l’échelle internationale. La re-nomination du musée va donc de pair avec la métamorphose de la société, au risque de devenir uniquement une définition en « miroir 10 ». Néanmoins, de la théorie à la pratique un écart se creuse : tous les musées n’ont pas opéré cette transition éthique que la définition arbore déjà fièrement. Par conséquent, la définition de l’ICOM aurait aussi une valeur pro-active et prospective, puisqu’elle anticipe les défis que de nombreuses institutions muséales ont et auront à relever tout en proposant un cadre commun d’actions qui relient les structures-membres. Par ailleurs, la littérature contemporaine s’est également emparée de l’espace muséal et des débats qui l’animent. En tant qu’objet littéraire, le musée est un espace foncièrement libre et plastique : il ne subit plus les contraintes de sa matérialité.
2. Le musée dans la littérature contemporaine
La transition que doit opérer le paysage muséal aujourd’hui est largement traitée au sein de l’espace littéraire. Le musée est en effet sous tension : la société le presse d’écrire un nouveau récit qui serait le reflet de ses préoccupations, mais il ne peut pas suivre le mouvement effréné de la pensée pour diverses raisons (matérielles, juridiques, économiques, politiques). La littérature se présente ainsi comme un espace dans lequel le musée peut, en tant qu’objet littéraire, être remodelé, critiqué à l’envi et devenir un espace fictif où le récit, les représentations et la classification du monde qu’il propose dans la réalité peuvent être refondus.
La « crise des musées » existe depuis la naissance du musée moderne au XVIIIe siècle. Que l’on songe aux vives protestations formulées par l’architecte, critique d’art et homme politique Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy : celui-ci déplore vivement le déplacement des œuvres d’art italiennes vers Paris qui les prive de leur environnement naturel, donc de la seule atmosphère favorable à leur épanouissement. Ainsi la politique de spoliation artistique initiée par Le Directoire et mise en œuvre par Bonaparte est largement contestée sous la plume de Quatremère de Quincy qui propose déjà une réflexion d’ordre muséologique. Au XIXe siècle, les questions que génère la politique muséale s’étendent aux plumes d’écrivains illustres. Bénédicte Savoy mentionne ce phénomène muséo-littéraire dans sa conférence inaugurale au Collège de France et rappelle à notre souvenir la lettre de Victor Hugo adressée au capitaine Butler au sujet du sac du Palais d’été de Pékin11, ou encore l’article de Paul Valéry sur les problèmes des musées 12. C’est toute une tradition d’écrivains mêlés au champ muséal qui se perpétue jusqu’aujourd’hui, à la différence que l’objet musée s’ouvre désormais à d’autres genres, en regénère certains, voire en fait naître de nouveaux. En effet, Hugo et Valéry écrivent des lettres et des articles et lorsque la fiction romanesque du XIXe siècle s’empare du musée, elle l’envisage davantage comme un décor, et non comme un sujet à part entière. Or on constate depuis le début du XXIe siècle une intensification de la création littéraire dans laquelle le musée est soit le sujet à part entière d’une fiction ; soit un outil d’introspection. Ces deux dynamiques sont notamment portées par des initiatives novatrices, qui se situent à la confluence de plusieurs champs (éditorial, littéraire, muséal, culturel, patrimonial). Elles engagent, en outre, le renouveau des écritures de l’intime par la médiation du musée et de ses collections : à n’en pas douter, le récit individuel s’épanouit à côté du récit muséal au sein de l’espace littéraire.
2.1 Représenter le musée dans la fiction muséale contemporaine : un espace remodelé à l’envi
La fiction muséale permet en effet de faire émerger un point de vue interne et individuel, un autre récit au sujet du musée et de ses collections, plus libre que le discours officiel et scientifique du musée. Elle fabrique ainsi un espace muséal fictif affranchi, voire idyllique, tout juste viable dans la réalité.
Des ouvrages voient le jour dans lesquels la fiction au musée embrasse et relève les défis contemporains rencontrés par le champ muséal. Des lions comme des danseuses 13 d’Arno Bertina interroge, par exemple, l’identité européenne et africaine à travers la restitution du patrimoine africain – notamment bamiléké. Le récit se focalise sur les collections du musée Quai-Branly Jacques Chirac qui deviennent gratuites – ce à quoi s’ajoute la gratuité du visa également – pour les « ressortissants du continent africain [qui] devaient pouvoir découvrir les expositions au sein desquelles telle ou telle œuvre de leur patrimoine serait exposée 14». L’ouvrage – né d’une résidence d’écrivain et d’une commande institutionnelle – est publié une première fois en 2015, puis enrichit en 2019, en plein boom des questions relatives à la décolonisation des arts et à la future communication « éthique » entre la France et le continent africain. Le Musée de l’innocence 15 d’Orhan Pamuk est corrélé à l’édification d’un musée éponyme à Istanbul en 2012 que l’on peut aisément considérer comme étant l’un des couronnements les plus remarquables en matière de dialogue entre la littérature et l’espace muséal. La collecte fictive de Kemal se prolonge matériellement dans un musée de pierre, dont le projet précède toutefois le roman. Pionnier en la matière, le Musée de l’Innocence est auréolé du prix du musée européen en 2014. Il est également la réalisation tangible du projet culturel et muséographique formulé dans le catalogue d’exposition à valeur de manifeste – L’Innocence des objets 16 – dans lequel l’auteur plaide pour un musée à taille humaine, qui opérerait un changement, sinon un renversement, de focalisation : d’un musée traditionnel où l’Histoire officielle serait mise en scène, le musée de l’innocence représenterait une histoire individuelle, celle des deux personnages Kemal et Füsun, qui ouvrirait vers la représentation élargie à une classe sociale. Il constitue toutefois un hapax dans le paysage muséal contemporain.
La fiction muséale se présente donc comme un terreau fécond, où tous les débats qui animent le champ muséal peuvent s’épanouir librement. Elle permet aussi d’élargir, par l’interpénétration entre le champ muséal et le champ littéraire, le nombre de points de vue sur ces questions complexes, tout en les faisant connaître à un plus grand nombre.
2.2 Le musée et ses collections : des outils introspectifs ? Le cas de la collection « Ma nuit au musée » (Éditions Stock)
Une proposition éditoriale à l’initiative d’Alina Gurdiel est à l’origine de cette collection : un écrivain est invité à passer une nuit dans un musée (parisien ou européen majoritairement) et à écrire le récit de cette expérience. Le genre que doit adopter l’ouvrage n’est pas suggéré, mais il apparaît que la quasi-totalité des œuvres – sans concertation de la part des auteurs – s’inscrit dans la grande famille des écritures de soi ; tantôt elles s’apparentent à des biographies (Nuit Espagnole 17), tantôt à des autobiographies (La Leçon des ténèbres 18 ; Le Parfum des fleurs la nuit 19 ; Comme un ciel en nous 20 ; Marcher jusqu’au soir 21), tantôt à des autofictions (Les Muses ne dorment pas 22), parfois à des lettres (Il y a un seul amour 23). L’identité générique des ouvrages reste toutefois hybride et poreuse. Léonor de Récondo propose, par exemple, un récit qui tient autant de l’autobiographie que de la biographie. En effet, l’écrivaine alterne les chapitres dans lesquels elle évoque sa propre existence et ceux où elle retrace la vie de Domínikos Theotokópoulo – Le Greco – tout en entrelaçant prose et versification. L’espace muséal a de tout temps constitué un lieu propice à l’exercice introspectif, mais le projet éditorial permet la pleine éclosion du je – ne serait-ce que parce que les auteurs se retrouvent seuls, si l’on omet la présence des gardiens – mais aussi grâce à la médiation du musée et de ses collections. En effet, ces derniers constituent des nouvelles sources dans lesquelles l’écrivain peut se plonger pour s’écrire – s’exposer ? – révolutionnant ainsi les sources traditionnelles de l’autobiographie que sont les effets personnels (lettres, albums de photographies, journaux intimes).
Les auteurs sont également réunis par la question de l’exil. En effet, l’histoire personnelle et/ou familiale des écrivains a été fracturée, notamment par un régime politique, et ils n’en ont pas toujours retrouvé la trace dans la narration muséale, voire s’en sont toujours sentis exclus. Pour ne citer que quelques exemples, Adel Abdessemed a connu un exil politique puisqu’il était censuré et menacé en Algérie ; la famille de Léonor de Récondo a été contrainte de fuir l’Espagne sous le régime franquiste ; Leïla Slimani a, quant à elle, quitté volontairement le Maroc en 1999 dans lequel elle se sentait prisonnière ; le père de Jakuta Alikavazovic a fui la Yougoslavie ; Zoé Valdès, née à la Havane, est exilée en France en raison de son opposition au régime cubain ; enfin, la famille de Santiago Amigorena a fui la dictature uruguayenne au début des années 1970. L’espace muséal n’était ainsi pas lisible pour eux, ils n’y retrouvaient pas le récit de leur histoire, ce que regrette aussi Leïla Slimani: « Le musée reste pour moi une émanation de la culture occidentale, un espace élitiste dont je n’ai toujours pas saisi les codes 24 ». On comprend dès lors l’importance du choix du musée : il repose essentiellement sur la connaissance sensible du parcours des auteurs. En effet, le musée doit être le parfait médiateur, autrement dit le parfait opérateur de passage, entre l’hôte nocturne et son histoire personnelle. Christophe Ono-dit-Biot le reconnait en invoquant la figure quasi mystique de Concepción, dont on devine l’identité : « Picasso, pas un hasard. Évidemment pas un hasard. Concepción faisait bien les choses, agitant pour nous la muleta suprême de la peinture, la muleta noire comme le sang quand il n’a plus d’oxygène : Guernica 25 ». De fait, la nuit au musée repose aussi sur un processus de révélation identitaire en miroir. Dans Nuit Espagnole les combats respectifs de Pablo Picasso et d’Adel Abdessemed contre la censure et la violence se réverbèrent : « Le moment est venu d’accoucher les esprits de leurs vérités cachés et le scribe se positionne devant l’artiste confronté à l’artiste. La guerre de Picasso a réveillé la sienne 26 » : les œuvres respectives des deux artistes se réfléchissent – et s’actualisent – l’une dans l’autre.
La déambulation nocturne au musée et le biais de la fiction muséale permettent, par ailleurs, de projeter l’histoire individuelle des écrivains sur les cimaises des musées, sinon de proposer une alternative au discours scientifique du cartel afin de se libérer de sa « tyrannie 27 » : le lecteur lit l’œuvre à travers le point de vue personnel de l’auteur. Cette projection atteint son point d’orgue lorsque Leïla Slimani établit une analogie entre sa propre division identitaire et l’emplacement géographique de la Punta della Dogana où elle passe la nuit :
Située à la confluence de deux grands canaux qui sillonnent la ville, le Canal Grande et la Canal de la Giudecca, la Douane est le point de rencontre de 2 civilisations : l’Empire italo-germanique et le monde arabe ou byzantin. » J’y vois le symbole de ma propre histoire. Peut-être est-ce là que je vis, dans ce milieu qui ressemble à une presqu’île pointue. […] Je n’ai ni tout à fait quitté mon lieu de départ ni tout à fait habité mon lieu d’arrivé. Je suis en transit. Je vis dans un entremonde 28.
L’enfermement consenti dans l’espace muséal offre par conséquent une mise en abyme des différents types d’enfermements propres à chaque écrivain (culturel, identitaire, politique) et actualise chez eux le sentiment d’exclusion des sphères culturelles et artistiques dont ils ont été ou sont encore victimes, parfois de manière inconsciente. L’expérience se présente donc comme un outil de (ré)appropriation culturelle, identitaire, voire patrimoniale. Lors de son enfance, le père de Jakuta Alikavazovic l’interroge régulièrement sur le stratagème qu’elle élaborerait si elle volait la Joconde, car, du fait de son statut d’immigré, son rapport à l’art conservé dans les musées occidentaux s’est cristallisé autour des notions d’illégitimité et de vol. Cette question a durablement orienté la relation de l’écrivaine à l’art, et aux musées plus généralement :
Cette phrase était un jeu, bien sûr, mais n’était-elle pas aussi autre chose ? Jamais je ne l’ai remise en question dans mon enfance. Pourtant elle est restée fichée dans mon esprit, et mon esprit s’est construit autour d’elle, l’a incorporée jusqu’à ce qu’elle en devienne l’un des centres, l’un des cœurs cachés 29.
Comme un ciel en nous enquête sur le désir de légitimation d’un individu vis-à-vis d’un patrimoine, d’une culture, qui, malgré leur force d’attraction, le renvoient à son « nom secret de l’étrangeté 30 » et sur l’héritage de ce dernier :
Pourquoi était-il incapable, ou me croyait-il incapable, de visiter le Louvre de manière désintéressée, comme tout un chacun, comme fait tout le monde ? Ce que je crois aujourd’hui et qui manque de me briser le cœur, c’est que cette rêverie trahit quelque chose d’une tristesse. D’une tristesse passée sous silence. Que ce songe, en apparence léger, en apparence joyeux, parle de l’illégitimité que, malgré tout, il éprouvait à se trouver là. Comme si sa présence était déplacée. Comme s’il était coupable du simple fait d’être là – et qu’il était le seul à le savoir 31.
La nuit au musée se présente donc comme une expérience curative, permise, entre autres, par un dispositif confessionnel revisité. En effet, l’exercice auquel les auteurs se livrent ne se limite pas à la description de l’espace muséal et de ses collections dans la grande tradition antique de l’ekphrasis portée par Philostrate de Lemnos, revivifiée dès les XVIIIe et XIXe siècles à la faveur de l’envolée des écrits sur l’art (salons, compte-rendu d’exposition, critique d’art, presse spécialisée, journaux intimes d’écrivains et/ou d’artistes, écriture artiste). Il s’agit avant tout d’un retour à soi : l’expérience esthétique est ainsi corroborée par une expérience introspective, de telle sorte que les écrivains n’écrivent pas sur l’art, mais à travers l’art, ce qui ancre définitivement la naissance d’un nouveau régime entre la littérature et les arts. On constate alors une extension de l’espace muséal vers deux espaces immatériels : l’intimus (espace symbolique) et l’espace extérieur au musée (la terre natale, par exemple). L’espace intime – intimus – est à entendre au sens fort : superlatif d’interus, il signifie « ce qu’il y a de plus en dedans, de plus profond » : le rapport au sacré, entre autres, dont les auteurs font mention à de maintes reprises. La géographie personnelle de l’auteur se dessine donc en parallèle de la déambulation nocturne dans le musée : l’histoire individuelle côtoie la grande Histoire.
La nuit au musée propose donc un décentrement vis-à-vis de la représentation, il ne s’agit plus de se fier à ce qui émane de l’objet et qui est porté par le discours unilatéral du musée mais de partir de soi-même pour lire l’objet et réactualiser le récit muséal. L’expérience muséale inédite et sa mise en récit permettraient donc de faire l’œuvre – non pas de la consacrer symboliquement en tant qu’œuvre d’art car les critères esthétiques ne sont pas retenus – mais de la resémantiser à partir de sa propre expérience : soit de se l’approprier, à travers un geste inaugural ; soit de se la réapproprier, à travers un geste second.
Eléments de conclusion
Il existe bien un déplacement des défis contemporains cristallisés au sein de l’espace muséal vers le lexique muséal et la littérature contemporaine qui enregistrent et ratifient les changements de paradigmes. Les différentes définitions du mot musée par l’ICOM et la lexicographie généraliste en attestent qui doivent refléter les nouveaux horizons d’attente propres à chaque ère qui s’ouvre. Ainsi, la plasticité du verbe, celle de la lettre, s’acclimate plus facilement aux nouveaux modes de pensée, elle les reflète plus rapidement que le musée qui ne peut mettre en œuvre ses transitions aussi facilement. La littérature permet, en outre, une re-sémantisation individuelle du musée et de ses collections mais aussi une reclassification de ce dernier selon des critères non plus uniquement esthétiques et techniques mais par des valeurs comme de moralité, d’égalité, de justice.
- Représenter., François Mairesse (dir.), Dictionnaire de muséologie, Paris, Armand Colin, 2022, p. 562.
- Ibid.
- Neil MacGregor, À monde nouveau, nouveaux musées. Les musées, les monuments et la communauté réinventée, Paris, Hazan, 2021.
- Felwine Sarr, Bénédicte Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, Paris, Éditions Philippe Rey, Éditions du Seuil, 2018.
- Pomian Krzysztof, Le Musée, une histoire mondiale. II. L’ancrage européen 1789 – 1850, Paris, Gallimard, 2021, p. 26.
- Juliette Raoul-Duval, « Introduction et contexte par Juliette Raoul-Duval, présidente d’ICOM France », De quelle définition les musées ont-ils besoin ? Actes de la journée des Comités de l’ICOM, 10/03/2020, Dequelledéfinitionlesmuséesontilsbesoin_numerique.pdf (icom-musees.fr).
- François Mairesse, « Définitions et missions des musées », op. cit., pp. 33-40.
- Id., p. 45.
- Acquérir., Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, https://cnrtl.fr/definition/acqu%C3%A9rir.
- Marie Cornu, « Penser le musée comme catégorie juridique, quels enjeux de définition ? », in De quelle définition les musées ont-ils besoin ? Actes de la journée des Comités de l’ICOM, op.cit.
- Lou Wang, Nora Wang, Xin YE, Victor Hugo et le sac du Palais d’Été, Paris, Les Indes Savantes, coll. « Visions d’artistes », 2003.
- Paul Valéry, « Le problème des musées », Le Gaulois, 4 avril 1923.
- Arno Bertina, Des Lions comme des danseuses, 2019, Lille, La Contre Allée, coll. « Fictions d’Europe », 2019.
- Id., p. 28.
- Orhan Pamuk, Le Musée de l’innocence, Valérie Gay-Aksoy [trad.], Paris, Gallimard, 2011.
- Orhan Pamuk, L’Innocence des objets, Valérie Gay-Aksoy [trad.], Paris, Gallimard, coll. « Livres d’Arts », 2012.
- Adel Abdessemed, Christophe Ono-dit-Biot, Nuit Espagnole, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2019.
- Léonor de Récondo, La Leçon de ténèbres, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2020.
- Leïla Slimani, Le Parfum des fleurs la nuit, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2021.
- Jakuta Alikavazovic, Comme un ciel en nous¸ Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2021.
- Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée » 2019.
- Zoé Valdés, Les Muses ne dorment pas, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2020.
- Santiago Amigorena, Il y a un seul amour, Paris, Éditions Stock, coll. « Ma nuit au musée », 2020.
- Leïla Slimani, Le Parfum des fleurs la nuit, op.cit., p. 56.
- Adel Abdessemed, Christophe Ono-dit-Biot, Nuit Espagnole, op.cit., p.31.
- Id., p. 62.
- Philipe Comar, De la tyrannie du cartel, Paris, L’Échoppe, coll. « Envois », 2022.
- Leïla Slimani, Le Parfum des fleurs la nuit, op.cit., pp. 125-128.
- Jakuta Alikavazovic, Comme un ciel en nous, op.cit., p. 35.
- Id., p. 145.
- Ibid.
