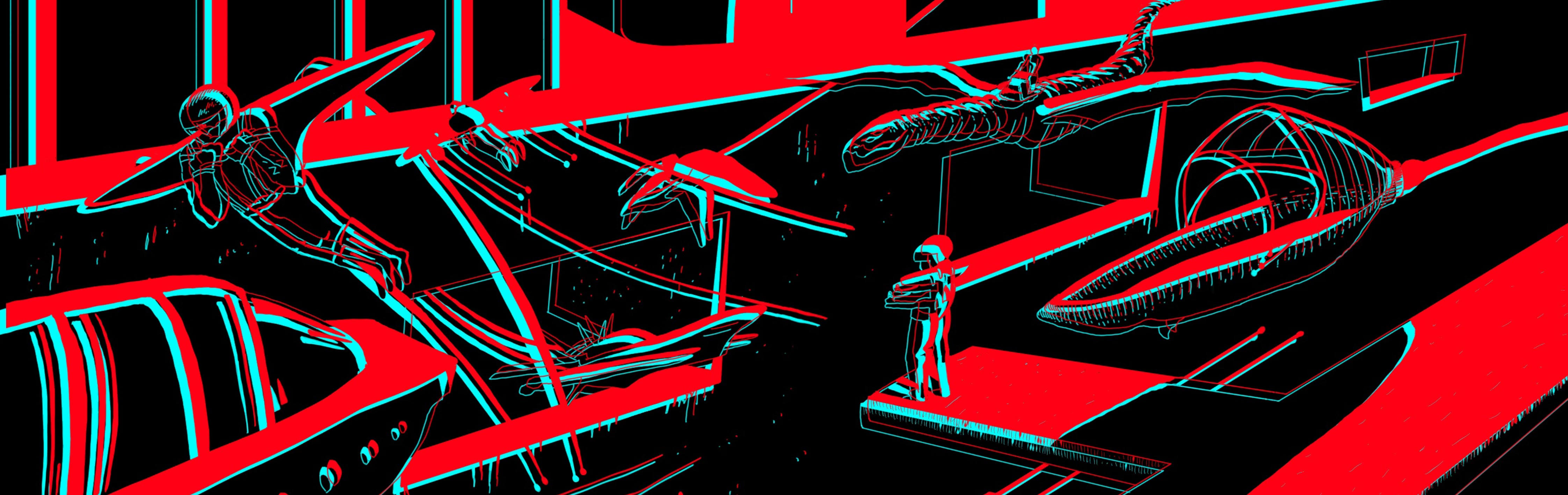
Les Pays des merveilles de Tim Burton
Les films de Tim Burton sont des invitations se développant autour de récits d'initiation,passant par l'introspection grâce à un univers purement mental, véhicule narratif idéal du merveilleux et du fantastique. Cette constante se double du désir du réalisateur de se servir de techniques de prise de vue dépassées technologiquement. Tim Burton use de trucages souvent dignes de ceux employés par Georges Méliès pour représenter ces univers hors normes et hors du temps aussi bien dans le fond que dans la forme. Prothèses, animation en volume ou images informatiques, surimpressions, caches et contrecaches, toiles peintes, trompel'œil, les outils de représentation de l'invraisemblable sont variés et portent en eux une signification particulière relative à leur mode de production.
La conception matérielle des composants visibles révèle les multiples niveaux de perception qu'offre le graphisme de l'image cinématographique, Tim Burton jouant avec la fausse crédulité de celui qui regarde de, peutêtre, trop près l'objet projeté, au risque d'en perdre le propos car il en oublie le tout. S'il est exact que les différentes origines de l'image frappent directement l'œil au visionnage d'un film de Tim Burton, cette posture contient un discours sur le statut de l'image et de l'objet représenté à l'écran. Cette hétérogénéité n'est pas purement ornementale, elle est vectrice de sens, symbole de la mise en correspondance de plusieurs mondes.
Exerçant d'abord le métier d'animateur, le cinéaste suivit à la fin des années 1970 des études à CalArts avant d'intégrer les Studios Disney pour lesquels il travaille plusieurs années (jusqu'en 1984). Il entretient donc un rapport particulier et fondamental à l'effet visuel ainsi qu'à sa fabrication, passant, des années 1980 aux années 2010, de la pratique du dessin animé et de celle de l'animation en volume à l'image numérique pour la représentation de ses décors comme pour celle de ses personnages.
Rétif à l'emploi de l'imagerie par ordinateur, Tim Burton attendra Mars Attacks ! 1 pour s'en servir massivement 2. Film-pivot dans sa filmographie, cette œuvre de sciencefiction engage une réflexion sur la signification d'une telle hétérogénéité de l'image et appelle à une relecture de ses premières réalisations. Apparaît alors une ligne directrice entre ce qui doit être pris pour une représentation authentique et ce qui n'est que la représentation d'une pure imagination et doit être compris comme tel.
L'Image comme apparence
Vincent Amiel et Pascal Couté signalent que
L'esthétique hollywoodienne contemporaine se caractérise par la production d'images qui se donnent comme apparence, sans volonté illusionniste, autrement dit sans chercher à se faire passer pour la réalité perçue. Tim Burton, poussant cette logique à sa limite, crée des univers dont la fausseté est clairement revendiquée 3.
Les auteurs se réfèrent notamment à Sleepy Hollow 4 et, par le terme « univers », désignent principalement le décor et ce qui relève de l'atmosphère visuelle et sonore dans laquelle baignent les personnages. A posteriori, au visionnage d'Alice au pays des merveilles, leur réflexion apparaît d'autant plus évidente et valide. Le phénomène n'est donc pas atypique chez le cinéaste : au moins deux de ses films répondent au constat de Vincent Amiel et Pascal Couté. Tim Burton ferait alors partie des cinéastes qui exploitent à son maximum le paradoxe de la croyance en l'unité du spectacle cinématographique tel que le présente Christian Metz :
Il est entendu que le public n'est pas dupe de l'illusion diégétique, qu'il « sait » que l'écran ne présente rien d'autre qu'une fiction. Pourtant, il est de la plus haute importance, pour le bon déroulement du spectacle, que ce faux-semblant soit scrupuleusement respecté (faute de quoi le film de fiction sera déclaré « mal fait »), que tout soit mis en œuvre pour que la tromperie soit efficace et ait un air de vérité (on rejoint ici le problème du vraisemblable). N'importe quel spectateur se récriera qu’il « n'y croit pas », mais tout se passe comme s'il y avait néanmoins quelqu'un à tromper, quelqu'un qui « y croirait » vraiment 5.
Suivant la pensée des trois auteurs précités, Tim Burton n'applique pas le principe du faux-semblant essentiel au bon déroulement d'un film illusionniste. Plutôt que de camoufler ou de travestir la vérité (la réalité) de la production des images et de la fabrication matérielle de l'intrigue, il amplifie le mensonge, le rend perceptible afin de pousser la réflexion au-delà du mal fait et au-delà de l'illusion de réalité que devrait à priori adopter une œuvre de fiction pour maintenir le jeu de la naïveté avec le spectateur faussement crédule.
Ce faisant, si le cinéaste ne vise pas un illusionnisme par la technique, il s'impose en conséquence de repenser le statut de ladite fiction. Effectivement, puisqu'il n'y a plus de tromperie possible, la perception du film doit être modifiée. Le spectateur doit interroger non pas l'origine de l'image cinématographique mais plutôt la raison pour laquelle cette image a été produite de manière à ce qu'il sente sa construction : pourquoi le cinéaste montre-t-il que l’image est truquée et donc purement imaginaire ? Selon Tim Burton, il faudrait penser le trucage perceptible comme un vecteur d'idées autant, sinon davantage, qu'un créateur d'images extraordinaires car, dans sa fabrication même, il est porteur de sens et moteur de mise en scène.
Complexifiant l'approche, à l'intérieur du corpus burtonien, le trucage se déploie majoritairement dans deux composants primordiaux de l'image : le corps de l'acteur et ce qui l'entoure (« l'univers » pour reprendre le terme de Vincent Amiel et Pascal Couté), données auxquelles viennent s'ajouter, ou se soustraire, deux temps de conception du rendu visuel final de l'image : celui du tournage et celui de la post-production. Ce sera le dosage variable de ces quatre modalités qui produira, tout en la détruisant, l'illusion de l'unité de la fiction et engendrera des mondes « anywhere out of the world 6 », selon l'expression utilisée par Vincent Amiel et Pascal Couté pour définir les mondes burtoniens. En fonction des choix du cinéaste, l'univers de la fiction sera plus ou moins éloigné du monde familier ou en deviendra la parabole.
Le Trucage profilmique
Le choix de concevoir les effets spéciaux au tournage, sans qu'il y ait de modifications majeures apportées à l'image enregistrée, permet à Tim Burton de manipuler la matière grâce à des trucages rudimentaires opérant devant la caméra, au moment de la prise de vue. Ce que le spectateur voit finalement à l'écran, aussi étrange que soit le personnage d'Edward aux mains d'argent 7, atteint ainsi une certaine forme d'authenticité pour le cinéaste du simple fait de sa présence physique effective, de son impression sur la pellicule argentique.
Effectivement, il y a bien une incarnation du personnage, un comédien interprétant un rôle et donnant la réplique à un autre, placés ensemble dans un même cadre, dans le champ de la caméra. Bien qu'il y ait une part de re-création du monde, un truc invisible mais perceptible ajouté au corps de l'acteur, l'être hybride existe réellement dans la mesure où il entre en interaction directe, et non pas différée, avec son univers et les autres personnages. Ils forment, ainsi réunis à un moment T, un monde cohérent simulant une réalité impossible, le personnage d'Edward devenant, au-delà de la diégèse, un porteur d'imaginaire et de magie grâce à son existence matérielle.
Au trucage mécanique en mouvement, récurrent chez Tim Burton, celui-ci ajoute, entre autres, au temps du tournage, des feuilles de décors dont la finition reste imparfaite. Ces trucages immobiles instaurent un cadre spatial particulier pour leurs incarnations en chair et en os. Ces espaces de jeu en trompe l'œil sont présents visuellement devant la caméra, donnant un instant l'illusion du volume ou de la profondeur de champ à un environnement hautement factice. En effet, ces décors n'en sont pas moins du toc et, pris sous cette perspective, pour Vincent Amiel et Pascal Couté, ils « inscrivent [inscrit] les [le] films [film] dans le cadre du merveilleux 8 », du ‘tout peut arriver’ et autorisent l'apparition de l'imaginaire et du merveilleux. Tim Burton explique sa démarche : « En combinant [dans Sleepy Hollow] les décors de studios, les acteurs, les costumes et tout le reste, on a vraiment le sentiment de s'immerger dans un monde ; [...] bien que ce soit faux, on en sent la réalité 9. » Le cinéaste tente de retrouver une esthétique du vrai en passant par le factice : le merveilleux et l'imaginaire deviennent alors vraisemblables.
Rendre réaliste une fiction nécessite l'association de textures et de corps pendant le tournage bien plus que le photoréalisme de l'ensemble, selon Tim Burton. Grâce à cette alchimie, il devient possible d'admettre une certaine validité de l'univers diégétique quels que soient les événements qui se déroulent. Les différents composants de l'image doivent co-exister en même temps devant la caméra pour parvenir à créer la densité nécessaire pour transmettre le propos burtonien. L'artificiel se distingue alors de l'apparence, le cinéaste lui offrant une dimension réflexive : il devient tangible.
Le Trucage cinématographique
Mais si les trucages de plateau produisent une forme de réalisme, qu'en estil des effets spéciaux intervenant en dehors du temps du tournage, comme Large Marge dans Pee-Wee Big Adventure 10, réalisée en animation en volume et insérée par montage, après une partie du tournage ?
Ces deux personnages sont filmés individuellement, leurs plans sont montés en champ contrechamp pour donner l'impression d'un dialogue et d'un même espace de jeu. Le cadre et le montage les séparent cependant. Prisonniers chacun dans leur cadre, ils ne vivent pas dans le même univers malgré leurs échanges de paroles et de regards. Il y a une explication à ce dispositif de mise en scène si directif. Marge – le spectateur en aura la confirmation dans une des scènes suivantes – n'appartient pas au même niveau narratif que Pee-wee, elle n'existe que par son regard, il s'agit d'un fantôme. Le champ et le contrechamp symbolisent deux niveaux narratifs ; Marge est une aberration visuelle, expliquant d'ailleurs les causes de sa propre mort et son impossibilité rationnelle à communiquer avec les vivants tandis que Pee-wee est bien vivant et est victime de l'hallucination.
La scission ponctuelle des mondes et leur dialogue improbable se traduisent donc chez Tim Burton, dans une première phase de sa filmographie, par l'isolement des personnages dans des cadres séparés et par le fait d'être issu de l'animation en volume plutôt que de la prise de vue réelle. L'animation concrétise des brèches vers d'autres univers, principe repris dans Beetlejuice 11 par des jeux de visibilité et d'invisibilité du corps horrifique, permises ou interdites selon l'ouverture d'esprit des vivants. Dans ce long métrage, seule Lydia peut voir les fantômes, contrairement à ses parents, car l'adolescente possède une sensibilité particulière lui permettant de visualiser ce qui est invisible.
Mars Attacks ! (1996) marque historiquement un basculement dans la filmographie de Tim Burton. Si le cinéaste retient dans un premier temps l'animation en volume pour mettre en mouvement les extraterrestres, l'animation par ordinateur sera finalement choisie, dans une forme moderne du procédé de dynamation cher à Ray Harryhausen. Trop chronophage et coûteuse, la décision est plus économique qu'artistique. Cependant, cette conciliation forcée n'entache en rien la logique de création burtonienne d'une brèche vers un ailleurs illustrée par le changement technique. Au contraire, elle l'élargit puisque pour la première fois, les acteurs côtoient des êtres virtuels à l'intérieur d'un même cadre et tous ces personnages, réels et invraisemblables vont avoir un impact direct les uns sur les autres.
Le trucage des Martiens intervient massivement à l'intérieur du plan, les extraterrestres envahissent l'image autant que la planète dans un effet de contagion total. Tim Burton n'a plus besoin du montage pour faire surgir les petits hommes verts. Ils entrent directement en interaction avec les personnages en chair et en os, comme Edward aux mains d'argent. Cependant, ils n'appartiennent pas moins au cauchemar d'une Amérique paranoïaque fantasmant qu'il arrive quelque chose à la nation somnolente : ils sont une projection, création imaginaire de ce qui pourrait potentiellement se produire si des Martiens arrivaient sur Terre.
À la situation narrative absurde répond la situation non moins absurde de la fabrication du film luimême : les acteurs jouèrent avec des partenaires absents car ils seront intégrés plus tard. Par ce système de décalage entre le moment du tournage et la finalisation du contenu de l'image, l'effet de présence-absence des Martiens est renforcé à travers le jeu parfois hésitant des comédiens à croire ce qu'ils ne peuvent pas percevoir mais seulement subir.
Les petits hommes verts sont à l'intérieur du cadre, bien présents à l'image mais, pourtant, ils ne semblent pas vraiment crédibles par leur manque de photoréalisme, particulièrement quand ils sont mis en relation directe avec un corps humain filmé en prise de vue réelle. Ces personnages viennent doublement d'un autre monde. De par leur origine géographique dans la diégèse et de par leur origine informatique de fabrication pour le cinéma, ils participent non pas à l'homogénéité du tissu filmique mais à son hétérogénéité. Le graphisme cartoonesque des Martiens se veut lui-même désuet, irréaliste. Il revendique son artifice, son invraisemblance et sa fonction de vecteur de spectaculaire et d'imaginaire.
Être un intrus dans son propre monde
Le cinéma fantastique constitue un terrain particulièrement fertile pour tester de nouveaux trucages car ils mettent en scène un « audelà de la réalité courante 12 », selon les termes de Pierre Hermadinquer. Thierry Lefebvre prolonge cette remarque par le souvenir que laissent les trucages :
N'en déplaise à certains esthètes traditionalistes, les trucages cinématographiques marqueront l'histoire des représentations. Les plus « faux » surtout, ceux qui ne prétendent pas à la reproduction discursive de la réalité, mais qui nous entraînent dans des mondes aberrants 13.
Les Martiens de Tim Burton s'engouffrent dans cette dynamique de création. Celle-ci permet de dépasser les limites de la fiction pour créer un hyperimaginaire. Suivant la réflexion de Thierry Lefebvre, les créatures du rêve d'Alice 14 et Underland dans son entier peuvent et doivent être d'une fausseté revendiquée puisqu'ils sont de pures images mentales, ne visant pas la vraisemblance ni l'authenticité, le rêve faisant fi de ces considérations. Le tout sonne faux pour mieux affirmer son appartenance au domaine de l'imaginaire. Le mètre-étalon de la facticité des images s'incarne en la rêveuse elle-même, seul personnage non retouché par ordinateur. JeanPhilippe Tessé prolonge cette perspective :
[…] le corps d'Alice n'est qu'une exception qui confirme la règle, son impact figuratif dépendant du fond numérisé d'où il se détache. [...] dans un environnement qui propose des présences restituées, générées, un intrus, Alice, suffit à renouveler l'expérience d'une présence immédiate, vivante, incarnée, sensuelle 15.
La jeune femme possède le seul corps authentique, en prise avec la réalité diégétique et filmée, en conséquence, en prise de vue réelle et sans déformation physique constante, contrairement aux autres acteurs. Elle rappelle par son aspect charnel l'existence d'un monde diégétique réel au milieu de simulacres. Tim Burton offre ainsi au pays des merveilles les dimensions d'un univers mental, rendu visuellement plausible par la distance entre la présence physique de la comédienne et le monde immatériel qui se déploie autour d'elle. Alice est bien seule, se parlant à ellemême. Paradoxalement, la jeune femme est l'intruse dans un monde qui pourtant n'appartient qu'à elle.
L'héroïne y combat son dragon intérieur dans un état de conscience proche de celui du spectateur : cet ennemi n'est autre qu'une part d'elle-même et ne peut donc pas vraiment physiquement la terrasser. Le personnage tient néanmoins à croire au réel péril de Underland autant qu'à la fiction produite par son cerveau/ordinateur alors que Tim Burton démontre, via les effets numériques ostensibles, qu'il ne peut rien arriver à Alice, car tout se passe dans sa tête. L'ensemble est strictement virtuel. Il suffit de réveiller le personnage pour que les créatures s'en aillent. Le simple geste d'éteindre l'ordinateur anéantirait les images informatiques.
Dans les films de Tim Burton, les effets spéciaux, quels qu'ils soient (numérique, animation en volume), concrétisent des images mentales, représentent des êtres et des univers issus de l'imagination d'un ou de plusieurs personnages. Appartenant à un esprit, ils n'ont pas à répondre aux normes de représentation du réalisme selon le cinéaste. Détaché de ces contingences, leur graphisme ne vise pas le photoréalisme, au contraire, il tend à se détacher de ce principe afin d'attester avec d'autant plus de force leur valeur fictionnelle. Les corps subissent en conséquence toutes les déformations utiles pour représenter les peurs et les espoirs du personnage ou du spectateur, le faire rêver ou cauchemarder.
Dominique Willoughby synthétise ce type de partis pris esthétiques sous les expressions de « cinéma photographique redessiné », ou de « cinéma dessiné 16 » en fonction de leur importance visuelle dans la fiction. Si de telles interactions existent depuis les années 1910, Tim Burton, parmi d'autres (comme Robert Zemeckis notamment à travers Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 17 par exemple), réutilise cette hybridation, de manière extrêmement lisible et surannée comme pour mieux montrer sa dette envers l'histoire des techniques et du dessin animé en particulier. En cela, Alice au pays des merveilles et Mars Attacks ! peuvent être considérés comme du « cinéma photographique redessiné » puisque le cinéaste se sert massivement du cinéma graphique (autrement dit de l'animation) pour concevoir visuellement des personnages majeurs ou des mondes entiers. Le fantôme de Marge, les Martiens et les créatures d'Underland relèvent bien d'une forme de « cartoonisation 18 » par leurs capacités de déformation et de transformation, impossibles sans avoir recours et effectuer un retour au cinéma graphique.
À la croisée des mondes
La pensée burtonienne pose cependant des difficultés d'interprétation. En 2001, les possibilités budgétaires et l'évolution des images de synthèse auraient permis au cinéaste de créer des êtres par ordinateur pour La Planète des singes 19. Cette possibilité fut d'ailleurs envisagée mais, contrairement au cas de Mars Attacks !, l'argument financier ne fut pas déterminant. Film de science-fiction, cette planète et ses habitants auraient pu n'être que des vues de l'esprit. Cependant, Tim Burton préfère travailler avec des acteurs maquillés en singes, s'imposant la contrainte du corps de l'acteur en dépit de la préférence des producteurs pour l'image numérique. Son intention semble donc de rendre bien réels les singes et leur société, passant comme dans Sleepy Hollow et Edward aux mains d'argent, via des trucages de plateau, par le faux pour revenir au vrai.
Dans la première version de La Planète des singes 20, Franklin J. Schaffner cherche à fabriquer un être hybride en transformant les acteurs en singes. Pour cela, ils y conservent des mouvements et des postures humaines. À l'inverse, Tim Burton souhaite que ses singes se déplacent comme des singes et expriment visuellement leur animalité profonde tout en étant incarnés par des humains. Le cinéaste contourne la question technique du comment (en 2001, rendre encore crédible un acteur déguisé en singe) vers le pourquoi (en 2001, chercher à rendre crédible un acteur déguisé en singe). La technique en ellemême ne l'intéresse pas, il cherche plutôt à lui donner un sens servant l'intrigue plutôt que de se reposer sur elle pour la produire.
Chez Tim Burton, l'existence matérielle, bien que truquée, d'individus simiens, génère un certain malaise, un faux-semblant erroné, par le double niveau de lecture de l'image, entre la diégèse et l'extra-diégèse : un acteur maquillé en singe imite le comportement et la gestuelle du primate pour les besoins de la crédibilité de la fiction. Il doit régresser, remonter l'arbre de l'évolution pour retrouver le singe qui est toujours, instinctivement, en lui. Ce singe n'appartient donc pas à un futur hypothétique de la Terre, il n'est pas virtuel ou à venir, effet qu'aurait suggéré une incarnation animée. Il est déjà présent, sommeillant en chaque spectateur sous une forme de mémoire ancestrale. Preuve en est, il a suffi d'entraîner les comédiens pour qu'ils parviennent à ré-adopter les mouvements désormais propres seulement au singe. Grâce à ce parti pris technique et humain, Tim Burton retourne à l'idée de Pierre Boulle pour l'écriture de son roman : « La connaissance en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce que vous en faites qui la transforme en l'un ou en l'autre 21 ». La leçon de morale originelle s'inscrit dans la diégèse burtonienne et déborde de celle-ci par l'effet invisible mais perceptible des trucages et du jeu des acteurs, réactivant, par un biais autre que celui choisi par Schaffner, une réflexion sur l'intrigue de La Planète des singes grâce à son esthétique.
Conclusion
Ces choix de mise en scène contiennent donc une logique qui se répercute de film en film, impliquant qu'une technique de prise de vue ou un trucage particulier signale l'existence d'un monde fictif réel et d'un monde fictif imaginaire. Les œuvres de Tim Burton mélangent plusieurs techniques de prises de vue et d'effets spéciaux à des fins précises, exploitant deux modes de fabrication de l'image cinématographique de manière extrêmement ciblée. À travers le manque de réalisme assumé du graphisme des images animées, ce cinéma s'avoue clairement artificiel et hors du temps puisque Tim Burton ne suit pas systématiquement les évolutions techniques propres à cet art et ne contribue que modestement à leur développement.
L'animation par ordinateur telle qu'il l'emploie rend évidente la virtualité des êtres et des mondes. Restant en surface, impliquant le recours d'un animateur pour se mouvoir, ces créations ne sont pas incrustées dans la profondeur de la pellicule argentique originale du film. Superposées et non entrelacées, ces deux images, bien que toutes les deux présentes dans une même fiction, ne font pas partie du même monde.
Les toiles peintes, les trompe-pas-vraiment-l'œil et autres dispositifs de décors artificiels installent le personnage à l'intérieur d'un univers dans lequel il est inadapté. La remarque d'Edgar Morin, « la prestidigitation, comme la sorcellerie, réussit apparitions, disparitions et métamorphoses. Mais, le sorcier est cru sorcier alors que le prestidigitateur est su truqueur 22 », trouve illustration idéale dans les films réalisés par Tim Burton. Il faut donner un signifiant au trucage puisqu'il ne peut pas être cru vrai. Tim Burton, plutôt que de le cacher, le revendique, lui offrant un rôle majeur dans la fiction, vecteur de merveilleux défiant les préceptes du réel, invitant le spectateur à réfléchir à sa propre conception de la réalité et des mondes des merveilles.
- Mars Attacks ! (id.), Tim Burton, Tim Burton Productions, ÉtatsUnis, 1996, 106 minutes.
- Batman et Batman, le défi contiennent des images informatiques (explosions) mais leur présence est mineure.
- Vincent Amiel, Pascal Couté, Formes et obsessions du cinéma américain, Paris, Klincksieck, 2003, p. 87.
- Sleepy Hollow (Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête), Tim Burton, Mandaley Pictures, American Zoetrope, Paramount Pictures, ÉtatsUnis, 1999, 105 minutes.
- Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, Paris, Christian Bourgois, 2002, p. 9899.
- Vincent Amiel, Pascal Couté, op. cit., p. 89.
- Dans le film du même titre : Edward Scissorhands (Edward aux mains d'argent), Tim Burton, Twentieth Century Fox, ÉtatsUnis, 1990, 103 minutes.
- Vincent Amiel, Pascal Couté, op. cit., p. 88.
- Stephen Pizzello, « Entretien avec Tim Burton. La photographie de Sleepy Hollow », in Positif, n°613, mars 2012, p. 109.
- Pee-Wee Big Adventure (id.), Tim Burton, Warner Bros., ÉtatsUnis, 1985, 88 minutes.
- Beetlejuice (id.), Tim Burton, The Geffen Film Company, ÉtatsUnis, 1988, 92 minutes.
- Pierre Hermadinquer, Technique des effets spéciaux pour le cinéma et la télévision, s.l., Édition Dujarric, 1993, p. 5.
- Thierry Lefebvre, « Avant-propos », 1895 : Pour une histoire des trucages, n°27, septembre 1999, p. 5.
- Dans l'adaptation des textes de Lewis Carroll : Alice in Wonderland (Alice au pays des merveilles), Tim Burton, Walt Disney Pictures, Roth Films, The Zanuck Company, Team Todd, ÉtatsUnis, 2010, 108 minutes.
- Jean-Philippe Tessé, « La Dernière femme », Les Cahiers du Cinéma, n°655, Avril 2010, p. 16.
- Dominique Willoughby, Le Cinéma graphique. Une histoire des dessins animés : des jouets d'optique au cinéma numérique, s.l., Textuel, 2009, p. 200.
- Who Framed Roger Rabbit? (Qui veut la peau de Roger Rabbit ?), Robert Zemeckis, Warner Bros., États-Unis, 1988, 104 minutes.
- Dominique Willoughby, ibid.
- Planet of the Apes (La Planète des singes), Tim Burton, Twentieth Century Fox, ÉtatsUnis, 2001, 115 minutes.
- Planet of the Apes (La Planète des singes), Franklin J. Schaffner, APJAC Productions, Twentieth Century Fox, ÉtatsUnis, 1968, 112 minutes.
- Pierre Boulle, cite dans JeanClaude Morlot, « Interview with Pierre Boulle », in Paul A. Wood (dir.), The Planet of the Apes Chronicles, Londres, Plexus, 2000, p. 26.
- Edgar Morin, Le Cinéma ou l'homme imaginaire. Essai d'anthropologie, Paris, Minuit, 2007, p. 60.
