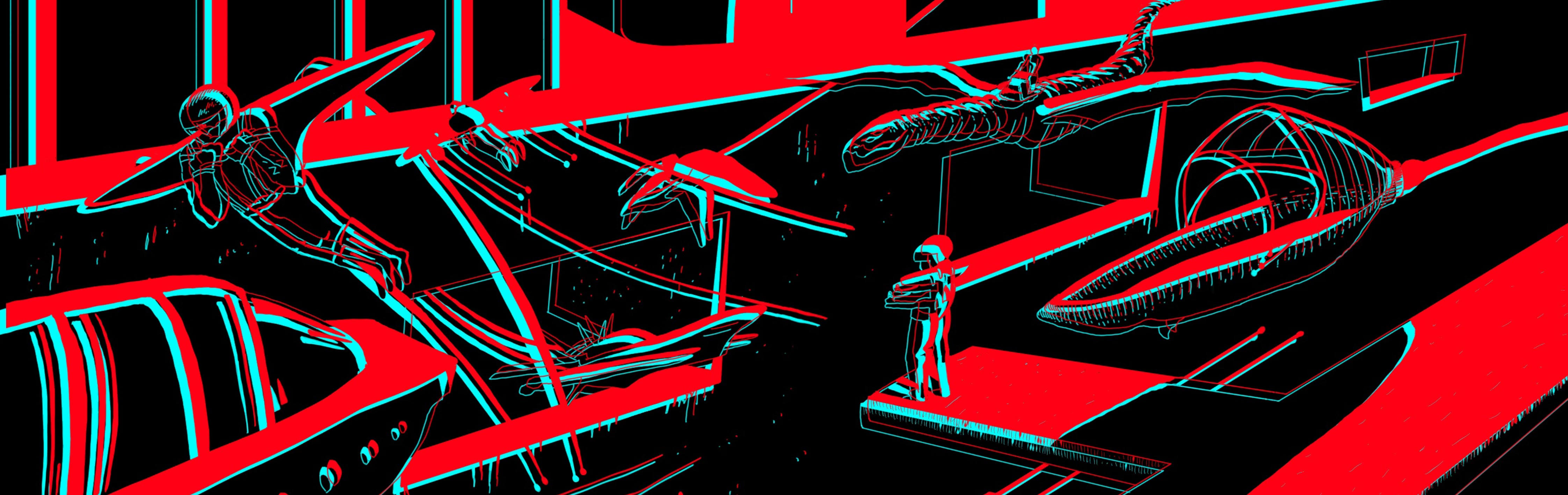
Des débits de l’imaginaire chez Jack Vance : Délit, déni, dépit et défi
Nous proposons ici une approche de l’œuvre de Jack Vance (1916-2013), un des grands maîtres des littératures de l’imaginaire qui a écrit aussi bien en fantasy qu’en science-fiction. Nous pouvons rappeler ainsi son influence déterminante en fantasy avec le monde de la Terre Mourante, créé en 1950, et des personnages comme Rhialto ou Cugel, celui de Lyonesse initié en 1983, autant que sa prédilection certaine pour le space opera et le planet opera, des genres qui lui ont permis, entre autres prix, d’obtenir plusieurs Hugo. En utilisant des exemples précis issus du gigantesque corpus vancéen – 44 volumes pour l’édition intégrale élaborée avant sa disparition – depuis son emblématique première nouvelle « Le Penseur de Mondes » (« The World-Thinker », 1945) jusqu’à son dernier roman Lurulu (2004), nous souhaitons donc aborder les différents débits du flux imaginaire dont Vance irrigue ses différentes et multiples œuvres de fiction pendant plus d’un demi-siècle. En ce sens, et à l’aide d’un recours un peu facile à la paronomase – débit, défi, délit, déni, dépit – nous voulons traiter différentes modalités particulièrement incarnées dans les récits vancéens. En évoquant les différents défis que revêt la création de mondes imaginaires, nous montrerons que le regard de Vance traite cette invention à plusieurs niveaux, n’hésitant pas à la mettre en scène au sein de ses récits mêmes. Là, le regard vancéen se révèle bien plus nuancé que le laisserait penser le fameux sense of wonder fréquemment relevé chez Vance : le débit se transforme fréquemment en délit, conduisant le lecteur – comme a priori l’auteur – à reconsidérer le véritable apport de l’imaginaire au monde. Le déni provoqué par l’imaginaire n’est ainsi souvent pas loin de susciter un pur et simple dépit. C’est dans le refus de ce dernier mouvement que se trouve pourtant peut-être le défi final de l’imagination.
Le débit
Incidemment, Jacques Chambon rappelle, dans sa préface à Papillon de Lune, le livre d’or consacré à Vance, qu’un autre préfacier vancéen, Barry Nathaniel Malzberg, avait proposé une théorie littéraire étrange mais séduisante : « le titre de la première œuvre publiée d’un auteur [a] un caractère symbolique : il annoncerait la direction de toute une carrière 1. » Mais, comme continue à l’expliquer Chambon, « s’il est facile de la prendre en défaut, et par-là même difficile de lui reconnaître une valeur scientifique, la théorie de Malzberg fonctionne à merveille dans le cas de Vance 2. » Malzberg citait alors la nouvelle de 1947, « Le Château de vos rêves » (« I’ll build your dream castle », 1947) qui n’est pourtant pas la première de Vance. En effet, la carrière d’écrivain de l’auteur américain débute en 1945 avec un autre titre, tout aussi programmatique, « Le Penseur de Mondes » (« The World-Thinker », 1945).
Cette nouvelle inaugurale, typique de l’Âge d’Or de la science-fiction américaine, met en scène Laoomé, un personnage démiurgique, reclus hors des frontières de l’univers connu par les hommes, dont l’occupation fondamentale semble être de créer des mondes en utilisant « notre propre univers comme modèle 3 » et d’expérimenter ainsi – principalement à partir de l’être humain 4 – toutes les ressources possibles de l’évolution. Il explique d’ailleurs parfaitement et simplement sa tâche en répondant aux interrogations éberluées d’un Terrien :
- Mais comment un seul cerveau peut-il concevoir les détails d’un monde ? Les feuilles de chaque arbre, les traits de chaque homme…
- Cela serait fort ennuyeux, acquiesça Laoomé. Mon esprit ne conçoit qu’au sens large, introduit les racines déterminées dans les équations hypostatiques. Les détails évoluent ensuite automatiquement 5.
Entre parenthèses, il n’est d’ailleurs pas indifférent que cette histoire prenne pour intrigue la recherche d’une jeune femme en fuite qui possède, enfouie au fond de son esprit, les codes qui permettent de diriger les ordinateurs régulant les transferts de fonds de l’empire humain et par là-même de régler l’équilibre économique, social et vital, de cet univers.
L’imagination est propre à chacun et un des personnages d’Escales dans les étoiles (Ports of Call, 1998), même en avouant que cela n’est « pas immédiatement accessible au simple curieux », peut évoquer l’omniprésence de l’imagination créatrice :
La doctrine de base nous enseigne que chaque individu, bon gré, mal gré, engendre son propre univers dont il – ou elle – est l’Être Suprême. Nous n’utilisons pas, vous le remarquerez, le mot « Dieu », puisque le pouvoir de l’individu n’est ni transformateur ni pénétrant et que chaque personne a un concept différent concernant la nature de son programme divin. Peut-être manipulera-t-il simplement le cours ou – disons – la disposition d’un univers classique 6.
Chez Vance, les manipulations sont toutefois de plus grande envergure, alimentant un véritable débit de crue. Comme le dit Brian Ash, « parmi tous les écrivains qui ont inventé une grande diversité de mondes étrangers, [Vance] occupe une place à part 7 » ; il saute de planète en planète, visitant « des mondes particuliers convenant à toutes les fantaisies imaginables 8. » Dans « Les Singulières Arcadies de John Holbroock Vance », Jean-François Jamoul, en s’arrêtant sur ce qui fait la puissance d’évocation vancéenne, met lui aussi en avant la nécessité fondamentale de s’écarter de notre monde et d’en façonner de nouveaux :
Chez Vance, la réalité d’un monde ne se construit pas seulement avec des mots, mêlés comme des numéros dans un chapeau ; elle résulte d’un certain agencement des choses : chaque détail pris isolément pourrait appartenir à notre monde, tous ces détails pris ensemble déterminent incontestablement un ailleurs différent du monde terrestre. Ils sont un foyer de représentation, un libre déploiement de l’imagination de l’auteur 9.
C’est cette démarche qui façonne aussi bien le travail de l’écrivain que ses interrogations sur le langage, « le style devient le meilleur complice de la transformation de l’impossible en possible 10 », l’auteur peut donner libre cours à une exploration linguistique théorique sous le couvert de cette « imagination verbale et démiurgique 11 » qui transforme le moindre passage descriptif en univers viables et vivants autant que chatoyants et marquants 12.
Le délit
Pourtant, à l’inverse de la vision utopiste des littératures de l’imaginaire, de l’imagination, l’invention et la création se révèlent, dans le champ imaginatif, des agents de crime et de destruction. À cet égard, La Geste des Princes-Démons (1963-1981), composée de cinq romans, illustre et précise l’hybris que mettent en exergue les folies de criminels hors-normes. Dans La Machine à tuer (The Killing Machine,1964), Kokkor Hekkus a pris le contrôle d’une planète oubliée où il met en scène, à l’insu des natifs, des guerres dont il tient tous les rôles principaux. Dans Le Palais de l’amour (The Palace of Love, 1966), Viole Falushe s’est érigé en véritable dieu d’une planète où chaque premier-né lui est donné. Les plus beaux rejoignent le légendaire palais de l’amour. Dans Le Visage du démon (The Face, 1979), Lens Larque, suite à une insulte, remodèle une lune à l’image de son visage pour que tous les habitants d’une planète le voient s’élever dans le ciel chaque nuit. Enfin, dans Le Livre des rêves (The Book of Dreams, 1981), Howard Alan Treesong écrit, enfant, un récit narrant les exploits d’un groupe de chevaliers qui deviennent ses incarnations ; une forme de schizophrénie lui offrant des possibilités surhumaines et une variété et intensité d’émotions le plaçant au-dessus des normes usuelles.
Laoomé s’était déjà, avec ou malgré ses pouvoirs démiurgiques, révélé comme indifférent au mal et à la mort. En créant et modifiant les espaces, le faiseur de mondes condamne avec indifférence les êtres qui les peuplent à une mort certaine et, lorsqu’il demande au héros, Lanarck, de tendre la main pour toucher un univers, ce n’est que pour susciter une dévastation terrifiante :
Lanarck s’exécuta. Il était bel et bien à un mètre de son visage et la forêt rousse s’écrasa comme une mousse sèche sous le bout de ses doigts.
-Tu viens de détruire un village, commenta Laoomé, qui fit encore grandir la planète à une vitesse impressionnante, jusqu’à ce que Lanarck se trouve à trente mètres au-dessus de la surface. Il contemplait la dévastation que son contact avait provoquée un instant auparavant. Les arbres, […] avec des troncs de neuf ou dix mètres de diamètre, étaient à terre, fracassés. Les ruines de huttes grossières étaient visibles, et il en sortait des appels et des cris de douleur, à peine audibles aux oreilles de Lanarck. Des corps d’hommes et de femmes gisaient çà et là, écrasés 13.
Laoomé, banni de son propre univers et peut-être inadapté au nôtre, est enfin condamné lui aussi à la mort, soumis à des attaques cérébrales qui détruisent systématiquement les créations sur lesquelles il travaille :
Lanarck prit soudain conscience d’une curieuse raideur dans le rapport qu’il avait établi avec le Penseur de Mondes. Il regarda derrière lui et se rendit compte que les grands yeux noirs étaient devenus vitreux, que le terrible corps noir était agité de tressauts et de secousses. Et la planète de rêve de Laoomé se transformait. […] Les nobles arbres roux étaient devenus des tiges grises pourries qui oscillaient comme des ivrognes. D’autres s’écroulaient et se repliaient comme des colonnes de papier mâché. […] Des cieux tombait une pluie de flammes. [..] Plus soudainement qu’il n’avait été créé, le monde s’évanouit 14.
L’ultime agonie de Laoomé détruira ainsi tous les mondes et toutes les sociétés qu’il avait sortis de son esprit. Créatures et créateurs, victimes et bourreaux, se retrouvent pris dans la même déchéance. Comme l’explique le pauvre Perrin, gardien du phare du Rocher d’Isel dans « Quand se lèvent les cinq lunes » (« When the Five Moons Rise », 1954), qui se rend compte qu’une conjonction lunaire exceptionnelle (les cinq lunes de la planète se lèvent en même temps) donne vie aux rêves et aux cauchemars des êtres pensants : « Il semblait que chaque individu était victime de ses propres fantasmes 15. » Avec le délit, le débit devient incontrôlable. Dans « Le Retour des Hommes » (« The Men Return », 1957), la Terre traverse ainsi une « poche de non-causalité 16 » où l’infraction aux lois naturelles devient norme, un univers des possibles illimités, où son organisation se dissout entièrement : « les sphères se fondaient en pyramides, devenaient dômes, touffes de spirales blanches, poteaux qui perçaient le ciel ; puis, en guise d’ultime tour de force, en tesseracts 17. » Le monde est alors simplement invivable : « Parfois, Bêta flottait ; parfois, il s’envolait dans les airs ; parfois, il adhérait au terrain. Il finit par sombrer dans un nœud de granit qui se figea autour de lui 18. » Face à ce torrent devenu déluge, Vance propose alors la mise en place d’une certaine forme de protection en opposant au délit et au débit inconsidéré qui en sourd inévitablement un dépit et un déni assumés.
Le déni
À chaque excès d’imagination répond donc simplement la négation de celle-ci. Les aventures de Cugel l’Astucieux (The Overlord, 1965), formant une suite ininterrompue de situations et d’endroits tous plus extraordinaires les uns que les autres, sont au final purement déceptives, chaque promesse cachant une tromperie : parmi d’autres exemples, une cité fantasmagorique qui apparaît la nuit sur les mers, scintillant de mille feux et résonnant de mille fêtes, n’est qu’une ville-fantôme, un piège fatal. D’ailleurs, l’objet initial de la quête de Cugel est une lentille violette au pouvoir ambigu : regarder le monde à travers elle revient à voir un monde de luxe et de rêve là où la réalité n’est que crasse et déchet.
Dans un passage tiré de Madouc (1989), dernier tome du cycle de Lyonesse, déjà commenté par Rhoads et Goimard, le magicien Hilarion se trouve confronté à un problème significatif. Ayant confié à des charpentiers gobelins sous les ordres du contremaître Shylick la mission de lui construire 19 une nouvelle demeure, le manoir de Trilda, sur le Pré Lally (une clairière située en plein milieu de la Forêt de Tantrevalles qui est l’espace dévolu, dans l’île de Lyonesse, au surnaturel et à la magie), le mage, avant de régler la facture, insiste pour inspecter l’ouvrage :
Presque aussitôt, le magicien découvrit des négligences. Le devis prévoyait des « gros blocs de pierre de taille de qualité supérieure » ; les blocs inspectés par Hilarion s’avérèrent des simulations préparées à partir de bouses de vaches enchantées. Poussant plus loin ses vérifications, il s’aperçut que les « poutres robustes de chêne bien sec » prévues par le descriptif étaient des tiges de fenouil séchées déguisées par un autre enchantement.
Hilarion fit remarquer ces défauts avec indignation et exigea que le travail fût accompli correctement et selon les critères définis. Shylick maussade argua qu’une précision totale était inconnue du cosmos […].
Hilarion demeura inflexible et Shylick frappa le plancher de son grand chapeau vert. Selon lui, la distinction entre « apparence » et « substance » n’était qu’une subtilité philosophique ; presque tout était l’équivalent de presque tout le reste. Hilarion répondit d’une voix grave :
- Dans ce cas, je vous réglerai mon compte grâce à ce brin de paille.
- Mais non. Ce n’est pas tout à fait la même chose 20.
Paul Rhoads va ainsi jusqu’à voir dans l’épisode du manoir de Trilda la dénonciation de ces créateurs dont le « but ultime est la désintégration et la mort 21. » Nous citerions aussi volontiers Michel Foucault évoquant Raymond Roussel : « Mais cette ombre douce qui, au-dessous de leur surface et de leur masque, rend les choses visibles et fait qu’on peut en parler, n’est-ce pas dès leur naissance, la proximité de la mort, de la mort qui dédouble le monde comme on pèle un fruit ? 22 »
Le Prince des étoiles (The Star King, 1964), le premier roman des Princes Démons, présente un monde paradisiaque qui subjugue tous ceux qui y posent les yeux. Cependant, pour les hommes, un tel pays doré est autant une bénédiction qu’une malédiction, comme en témoignent les sentiments de son premier découvreur : « Ce monde est beau et serein au-delà de toute expression 23. »
Ce monde était trop beau pour qu’on pût le quitter ; et bien trop beau pour qu’on pût y demeurer. Il suscitait au plus profond de lui-même un tumulte étrange et incompréhensible. Une force inconnue et mystérieuse le poussait à fuir son vaisseau, à se dépouiller de ses vêtements et de ses armes, à se fondre dans cette nature, à s’y plonger, à s’immoler dans une extase qui était l’identification avec cette beauté et cette grandeur insurpassables 24.
Ce monde devient pourtant le lieu d’un règlement de compte meurtrier. Si les commanditaires de l’expédition renoncent finalement à exploiter la planète afin d’éviter de la voir profaner, ils laissent sur place deux personnages – dont l’un a été le tortionnaire de l’autre pendant de longues années sur une étoile morte. Un an plus tard, le retour du héros, Gersen, sur la planète, permet de découvrir que la victime est devenue tortionnaire à son tour. On ne peut alors lire sans frissonner l’affirmation du nouveau bourreau : « […] j’exerce quotidiennement sur Dasce les sévices et les raffinements qu’il m’enseigna autrefois 25. »
Chacun des rêveurs criminels de La Geste des Princes-Démons verra donc l’effondrement et le retournement des univers qu’ils ont fantasmés et créés. L’austère et peu imaginatif Kirth Gersen, le héros de la série, devient ainsi le véritable paladin du monde de Kokkor Hekkus, le tuant et lui volant l’amour de sa princesse prédestinée, et, dans Le Visage du démon, il est celui qui finalement assume le choix de réaliser le plan de Lens Larque et de donner son visage à la lune.
Le dépit
Il n’est donc pas étonnant que Le Prince des étoiles se termine, à l’instar des meilleures œuvres de Vance, sur une note déceptive : « Gersen parcourut une dernière fois la vallée d’un regard mélancolique. Ce monde avait perdu son innocence première ; il avait connu le mal. Il lui semblait que le panorama s’était terni 26. »
Des sentiments similaires se manifestent avec une inquiétante régularité chez Vance. Au déni succède ainsi souvent un mouvement de dépit qui va connaître d’innombrables variations. Nous pourrions mentionner deux nouvelles précoces et méconnues de Vance, « L’Arche d’Alfred » (« Alfred’s Ark », 1965) et « Le Secret » (« The Secret », 1966). Dans la première, un Américain moyen se met en tête de construire dans son jardin une nouvelle arche dans l’attente d’un déluge prochain. Une pluie torrentielle s’abattant sur la ville, tout le voisinage, qui tournait évidemment en ridicule le projet, se bat pour monter à bord du navire et, devant le refus d’Alfred, jette celui-ci par-dessus bord. Alfred à peine plongé dans la boue, la pluie s’arrête, laissant les voisins face à la réalité de leurs actes. Dans la seconde, des enfants et des adolescents vivent une vie libre et utopique sur une île paradisiaque. Dès que l’un d’entre eux dépasse l’adolescence, il se lasse irrésistiblement de cette existence et se construit un esquif pour quitter l’île. Au terme d’un long voyage, le jeune homme finit par faire naufrage sur une terre sombre et désolé. Les reconnaissant à grand peine, il va retrouver là ceux qui l’ont précédé. Il va alors découvrir un secret brutal : la mort, ignoré dans le monde rêvé des enfants, est le pivot d’un monde adulte débarrassé de sa facilité et de sa vitalité. De manière concurrente, ces deux récits tournent le dos à l’imaginaire et à ses rêves pour en revenir au réel, exprimant un dépit sans ambiguïté. Comme une parenthèse, on pourrait remarquer ici que le dernier ouvrage publié par Vance sera aussi sa seule œuvre non-fictionnelle (une autobiographie titrée This is me ; Jack Vance !, prix Hugo 2010) ; comme si, aux portes de la mort, Vance laissait chuter l’imagination au profit de la réalité.
Dans sa dernière œuvre de fiction, Lurulu (2004), qui fait suite à Escales dans les étoiles (Ports of Call, 1998), toutes les quêtes rêvées dans le premier volume se révèlent vaines dans le second. Dans Wyst : Alastor 1716 (1978), le héros, un jeune peintre venu confronter son œil aux lumières idéales de la planète Wyst, où est établie une société égalitaire et utopique, découvre l’envers du décor – la violence des rapports humains marqués par la privation, la ségrégation, la trahison, le cannibalisme, le viol, le suicide et le meurtre institutionnalisés – et finit littéralement aveuglé, impuissant désormais à rendre le monde par son art.
Dans une spirale sans fin, le dépit face aux débits et aux délits de l’imagination entraîne toujours plus loin les espaces dans une décomposition inéluctable. Ainsi, dans « La Guerre des écologies » (« Ecological onslaught », 1953, texte retitré « The World between » en 1965), l’affrontement entre deux groupes cherchant chacun à rendre habitable une planète nouvellement découverte conduit à la condamner. L’escalade des innovations écologiques, suscitant à chaque fois un écosystème de plus en plus fantastique, finit par rendre la planète définitivement impropre à toute terraformation 27. Elle ne sera plus utile ni pour l’un ni pour l’autre des partis.
La manière dont l’imagination tourne, au-delà des limites, ne provoque que le dépit et le recours à un pragmatisme transparent. Celui-ci devient, au fil des années, la principale caractéristique des héros vancéens, les cantonnant ainsi d’ailleurs souvent à devenir des figures figées. On touche là à une critique parfois faite aux récits vancéens, celle de reposer sur des intrigues simplistes plutôt que simples et sur des héros « superficiels » plutôt que « super » ou superbes.
Le défi
Jean-Pierre Lion, dans sa critique de Lurulu publiée sur le site du Bélial, se penche sur cette dimension-ci :
Alors qu’il aura 90 ans cette année, le vieux maître n’est plus ce qu’il était. À bord du Glicca, il essaie de nous faire parcourir un maximum de mondes de l’Aire Gaïane comme dans l’urgence. Lurulu est peut-être son dernier livre, l’un des derniers, assurément, et lorsque viendra la fin, les mondes qu’il a imaginés mais qu’il ne nous a pas encore présentés seront à jamais perdus. Jack Vance écrit là comme s’il voulait sauver, sauvegarder, des pièces de son imagination. C’est charmant, plaisant, mais dépourvu de tout intérêt 28.
Faudrait-il porter un jugement similaire sur un des cycles les plus réputés de Vance, celui de Tschaï (Tschai, Planet of Adventure, 1968-1970) ? Adam Reith, un Terrien naufragé, n’a de cesse de parcourir une planète incroyable, disputée par quatre races extraterrestres (qui donnent leur titre à chacun des quatre volumes : Le Chasch, Le Wankh, Le Dirdir, Le Pnume) et sur laquelle l’espèce humaine s’est scindée en une variété infinie de tribus aux particularismes surprenants. Malgré la richesse de ce monde, malgré les amours et les amitiés qui y naissent, le héros vancéen n’aura pourtant qu’un unique projet : quitter ce monde si fort et si riche pour retrouver la Terre. Face au débit, nous retrouvons encore une fois le dépit de l’acteur. Cependant, tout l’intérêt du lecteur repose précisément sur ce débit merveilleux qui fait que chaque page – ou presque – amène une nouvelle illustration d’une imagination sans limites, élargissant sans cesse les limites usuelles 29. C’est dans cette situation paradoxale que se joue le défi que se lance l’auteur.
Même si on peut concevoir que l’on puisse préférer la destination au voyage (à l’instar de Jean-Pierre Lion), il ne faut pourtant pas se méprendre ; si l’intrigue, pour Vance, n’est que simplicité et prétexte à l’écriture (dans le domaine policier où il renouvelle certains poncifs du genre 30 comme dans ses récits de science-fiction et de fantasy), c’est moins par défaut que par idéologie. Il conviendrait d’ailleurs certainement de parler davantage de philosophie que d’idéologie.
Conclusion
À la qualité et la quantité des imaginaires élaborés par Vance se heurte donc la mise en œuvre faite de l’imaginaire par les protagonistes des œuvres vancéennes. Alimentés par un débit incontrôlé, les imaginaires deviennent des espaces rêvés mais conflictuels dont il faut refuser les excès, de crainte de devoir en nier l’existence ou de les rejeter sans regret, afin de sauvegarder un équilibre général lui-même factice et fictif. A l’inverse, dans « Le Diable de la colline du Salut » (« The Devil on Salvation Bluff », 1959), les missionnaires terriens venus vivre sur La Gloire deviennent ainsi fous à se forcer à vivre normalement sur une planète où rien de logique, de régulier, ne semble exister. Leur unique échappatoire sera finalement d’accepter de suivre le flux, aussi aberrant et chaotique soit-il, de la planète et de se laisser porter par un flot de folie. Le vrai défi de l’œuvre vancéenne est ainsi de réussir à maintenir une dynamique antagoniste assurant la permanence de l’imaginaire tout en délivrant un discours sous-jacent finalement nuancé et complexe sur les ambitions de la création littéraire.
- Barry Nathaniel Malzberg, cité par Jacques Chambon, Préface à Papillon de Lune, Paris, Presses Pocket, 1981, p. 7-37, p. 8.
- Ibid. On peut ainsi mentionner Millet et Labbé expliquant que « c’est certainement Jack Vance qui a réussi la meilleure analyse ethnographique d’une planète dans son Cycle de Tschaï » (Gilbert Millet et Denis Labbé, La Science-fiction, Paris, Belin, 2001, p. 162).
- Jack Vance, « Le Penseur de Mondes » (« The World-Thinker ») [1945], in Docteur Bizarre, E. C. L. Meinstermann (trad.), Paris, Presses Pocket, 1992, p. 77.
- « J’utilise fréquemment les hommes tels que toi. Vous disposez d’une gamme très étendue d’émotions et d’initiatives, une grande flexibilité face aux milieux variés que j’introduis. » explique ainsi Laoomé (Id. p. 73-74).
- Id. p. 74.
- Jack Vance, Escales dans les étoiles, (Ports of Call) [1998], Arlette Rosenblum (trad.), Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 235.
- Brian Ash, Encyclopédie visuelle de la science-fiction, Jean-Pierre Galante et Jean-Pierre Fontana (trad.), Paris, Albin Michel, 1979, p. 88.
- Jack Vance, « Le Château de vos rêves » (« I’ll Build your Dream Castle ») [1947], in Châteaux en espace, E. C. L. Meinstermann (trad.), Paris, Presses Pocket, 1993, p. 97-121 et p. 117.
- Jean-François Jamoul, « Les singulières Arcadies de John Holbroock Vance », in Univers 1984, Paris, J’ai lu, 1984, p. 292-324 et p. 311.
- Millet et Labbé, La Science-Fiction, op. cit., p. 23.
- Claude Aziza et Jacques Goimard, Encyclopédie de la science-fiction, Paris, Presses Pocket, 1986, p. 408.
- Voir l’incipit de l’article de Jacques Goimard, « Jack Vance et Philippe K. Dick : deux petits-fils de Guillaume d’Ockham », in Critique du merveilleux et de la fantasy, Paris, Presses Pocket, 2003, p. 282-285.
- Vance, « Le Penseur de Mondes », op. cit., p. 73.
- Id. p. 74-75.
- Jack Vance, « Quand se lèvent les cinq lunes » (« When the Five Moons Rise ») |1954], in Papillon de lune, op. cit., p. 106-174 et p. 122.
- Jack Vance, « Le Retour des Hommes » (« The Men Return) [1957], in Docteur Bizarre, op. cit., p. 8.
- Id. p. 7.
- Id. p. 12.
- Ce travail effectué en l’espace d’une nuit, comme dans les contes médiévaux évoquant les contrats architecturaux passés avec le Diable, se concentre dans une phrase dont la structure énumérative confine au vertige : « Les charpentiers se mirent au travail ; ils creusèrent, fouillèrent, taillèrent et scièrent, martelèrent, pilonnèrent, meulèrent et ajustèrent, tirèrent de longues bandes de leurs varlopeuses, tant et si bien que le travail fut terminé en une nuit, jusqu’à la girouette en fer noir sur la cheminée. » (Jack Vance, Madouc (1989), E. C. L. Meinstermann [trad.], Paris, Presses Pocket, 1990, p. 199).
- Id. p. 200.
- Paul Rhoads, « L’Etre ailé cueille le fruit de la vie », Postface à La Mémoire des étoiles (Night Lamp, 1996), Paris, Presses Pocket, 1998, p. IV.
- Michel Foucault, Raymond Roussel [1963], Paris, Gallimard, 1992, p. 156.
- Jack Vance, Le Prince des étoiles (The Star king) [1963], Paris, Presses Pocket, 1979, p. 19.
- Id., p. 24.
- Id., p. 220.
- Id., p. 221.
- Pour une analyse précise de cette courte nouvelle, se reporter à Jérôme Dutel, « Guerres de l’écologie ou guerre des écologies chez Jack Vance », in Christian Chelebourg (dir.), Ecofictions et représentations de la nature dans les littératures de l’imaginaire, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, à paraître.
- Jean-Pierre Lion, « Les Critiques de Bifrost », Le Bélial’ Editions, 07/2006, http://www.belial.fr/blog/lurulu.
- À l’image de cette Planète géante, au diamètre presque quatre fois supérieur à celui de la Terre, qu’explorent en partie deux romans de Vance.
- Par exemple, celui du meurtre dans une pièce close de l’intérieur dans Une Pièce pour mourir (A Room to die in) [1965], un roman policier écrit pour Ellery Queen.
