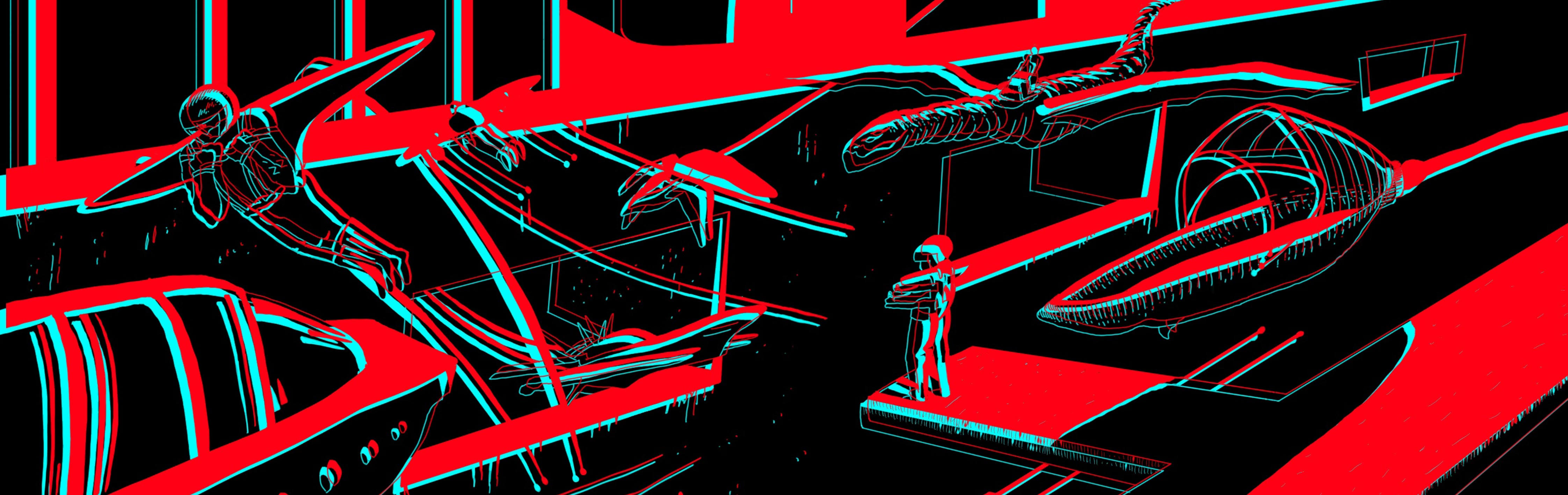
Peter Pan ou les enchantements d’un surnaturel désenchanté
Quoiqu’il n’existe comme tel que depuis un peu plus d’un siècle seulement, le personnage de Peter Pan fait partie des mythes actuels de la culture occidentale — de ceux que Pierre Brunel a appelés les « mythes d’aujourd’hui 1. » Si le dessin animé de Walt Disney (1953), qui a largement contribué à cette mythification, présente une féerie relativement conventionnelle 2, plusieurs des réinterprétations qui se sont succédé ces dernières années ont en revanche perçu dans Peter Pan des latences montrant un univers parfois assez éloigné de celui qu’une certaine tradition a retenu 3. Ce n’est cependant pas à ces reprises que nous nous intéresserons, pas plus qu’à la pièce de théâtre originale 4 de James Matthew Barrie, mais au roman que celui-ci en a tiré en 1915 5, qui, entre autres ambiguïtés, présente la particularité d’envisager le surnaturel au travers d’une thématisation du langage et de la parole qui sape, dans leurs fondements mêmes, la magie et la féerie.
Peter ou la magie du discours
Le surnaturel est indéniablement présent dans le Peter Pan. Encore faut-il s’entendre sur cette notion : on conviendra, avec Christian Chelebourg, qu’est surnaturel « ce qui est perçu comme illogique, impossible, proprement anormal 6. » Cette anormalité est relative aux lois de la Nature et non à celles de la société. Ainsi, s’il est étonnant que les Darling soient pauvres « en raison de la quantité de lait bue par les enfants 7 », cette bizarrerie économique ne relève pas du surnaturel. En revanche, qu’un terre-neuve soit choisi comme bonne d’enfants et qu’il se comporte de surcroît en parfait modèle de nurse anglaise, voilà qui peut être qualifié de surnaturel, eu égard à ce que l’on sait des chiens d’une part, des nounous à la mode victorienne de l’autre. Ce phénomène ne pose pourtant pas problème dans le cadre de ce roman, puisque le premier paragraphe 8 du premier chapitre est conclu par ces mots : « Jamais il n’y eut famille plus simple et plus heureuse jusqu’à l’apparition de Peter Pan » (P.P., ch. I, p. 14). De la même façon, lorsque Mme Darling effectue du rangement dans les pensées de ses enfants, le narrateur s’ingénie à accréditer cette action, invraisemblable pour un esprit rationnel : « C’est la coutume, le soir, chez toutes les bonnes mères » (P.P., ch. I, p. 14), prétend-il. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’impliquer afin de rendre son discours crédible, en s’adressant directement aux narrataires, pour la première fois dans Peter Pan :
Si vous pouviez rester éveillés (ce qui, bien sûr, est impossible), vous surprendriez votre propre mère se livrant à cette activité et vous l’observeriez avec le plus vif intérêt. […] Vous la verriez à genoux, je suppose […]. (P.P., ch. i, p. 15).
L’expression modalisatrice « je suppose » lui permet de faire preuve d’une prudence qui sert ses intérêts puisque, en admettant l’incertitude, il place les faits relatés du côté des actions non fictives (par rapport auxquelles son statut de narrateur ne lui donne aucune omniscience). Ces événements s’inscrivent dans le domaine de la féerie, qui se caractérise par le fait que le surnaturel « y est exposé sans que son surgissement soit problématisé 9 » ‒ ou du moins (c’est le cas du deuxième exemple) sans que le problème qu’il pourrait éventuellement causer ne s’installe durablement.
C’est dans ce même chapitre qu’apparaît le personnage de Peter Pan. Appartenant également à la sphère du surnaturel, il ne se distingue pas essentiellement de beaucoup d’autres êtres imaginaires. Il est en tout cas doté de pouvoirs extraordinaires, ne fût-ce que parce qu’il sait voler. En outre, il semble capable de configurer la réalité selon sa volonté. Cependant, le récit se charge de dévoiler les ressorts de ce pouvoir, qui tient à des causes plus naturelles que ce que l’ambiance féerique du roman donne à croire. En effet, si Peter réussit à modeler le monde à sa guise, c’est au moyen de deux types d’opérations qui n’ont pas grand-chose de surnaturel. D’une part, il modifie les objets du monde en agissant physiquement sur eux. L’exemple de l’accès à la maison souterraine du Pays de Nulle Part est représentatif de ce type d’action. Chaque enfant dispose de son propre arbre creux pour pénétrer dans ce refuge et en sortir. Mais, « à moins de correspondre exactement au diamètre du tronc, il est excessivement difficile de monter et de descendre » (P.P., ch. vii, p. 102). Pour cette raison, explique le narrateur, « si votre silhouette fait des bosses intempestives ou que le seul arbre disponible soit tordu, alors Peter effectue sur vous les modifications qui s’imposent » (P.P., ch. vii, p. 103). Le texte reste muet quant aux techniques utilisées pour ce faire, dont on peut imaginer qu’elles relèvent du surnaturel. Cependant, ce dernier est limité, puisque, « une fois les corrections nécessaires réalisées, il faut veiller à les respecter » (P.P., ch. vii, p. 103). Là où maints conteurs n’auraient pas hésité à inventer des arbres merveilleux qui se seraient adaptés indéfiniment à la forme de leurs occupants, Barrie adopte donc une voie plus prosaïque. D’autre part, Peter agit sur le monde par l’intermédiaire d’une parole directement efficace : ainsi, si les oiseaux de l’île sont devenus farouches, c’est parce qu’il leur a donné des noms étranges (P.P., ch. xiii, p. 178). Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les mots de Peter qui seraient dotés d’un certain pouvoir, mais c’est la parole en général, ce que montre la curieuse règle qui prévoit qu’une fée meure chaque fois qu’un enfant déclare qu’il ne croit plus à ces êtres merveilleux (P.P., ch. iii, p. 44). Ces exemples accréditeraient la pensée magique, selon laquelle les mots seraient capables de « se confondre peu ou prou avec leurs référents 10. » Toutefois, d’autres événements montrent que la réalité de cette magie est mise en doute.
Cette mise en question apparaît notamment dans le troisième chapitre (« Partons, partons ! »), où, Wendy ayant promis un baiser à Peter, celui-ci avoue son ignorance : il ne sait pas ce que cela veut dire. En guise de baiser, la fillette lui offre alors un dé à coudre, « pour ne pas heurter ses sentiments » (P.P., ch. iii, p. 42). En retour, le garçon lui propose lui aussi un baiser, mais lui dépose dans la main « un bouton en forme de gland » (P.P., ch. iii, p. 42). À première vue, ce passage ne signalerait rien d’autre que la naïveté de Peter. Cependant, d’une façon plus fondamentale, il met en évidence une conception spécifique des rapports entre le langage et le monde : les mots ne sont pas indissolublement liés aux référents qu’ils désignent habituellement. Barrie entérine ici l’arbitraire du signe – une idée dans l’air du temps : le Cours de linguistique générale de Saussure paraîtra en 1915 – et montre qu’un mot peut servir à nommer, d’une manière labile, d’autres réalités que celles auxquelles on l’associe par convention. De cette façon, il prend ses distances par rapport à la pensée magique.
D’autres exemples montrent que, à certains moments, l’efficacité de la parole de Peter est liée à un discours injonctif, qui, pour être suivi d’effet, nécessite la collaboration de l’allocutaire : lorsque Peter ordonne à Flocon d’aller chercher un médecin afin de secourir Wendy, l’enfant s’éclipse, puis revient déguisé en homme de l’art, car « il sa[it] qu’il fa[u]t obéir à Peter » (P.P., ch. vi, p. 95). Dans ce cas, on ne se situe plus dans le domaine de l’action magique, c’est-à-dire d’un surnaturel dans lequel « la nature obéit aux lois du verbe plutôt qu’à celles de la matière 11 », mais dans la rencontre de deux volontés humaines, dont l’une entend agir sur l’autre par le simple moyen du langage et de l’autorité dont elle est détentrice. En fait de magie, il s’agit ici de ce que Bourdieu nomme la « magie sociale 12 », qui s’élabore non sur quelque pouvoir surnaturel, mais sur la performativité, dont l’efficacité « est subordonnée à la conjonction d’un ensemble systématique de conditions interdépendantes qui composent les rituels sociaux 13 », ce que le texte n’occulte pas : si Flocon s’exécute, ce n’est pas parce qu’il est soumis au charme d’un sortilège, mais parce que Peter est le chef et que, à ce titre, il doit être obéi. C’est d’ailleurs en vertu de son pouvoir de commandement que Peter réussit à réaliser un certain nombre de situations qu’il invente, mais dont il ne perçoit pas le caractère fictif :
Un autre trait le différenciait en ce genre de circonstance des autres garçons qui reconnaissaient d’emblée les faux-semblants de la vérité, tandis que lui, entre les deux, ne voyait aucune dissemblance. Ce qui, parfois, les troublait, par exemple lorsqu’ils devaient feindre d’avoir mangé leur dîner. S’ils cessaient de jouer la comédie, Peter leur tapait sur les doigts. (P.P., ch. vi, p. 95).
Peter se fait ainsi le metteur en scène d’une fiction qui ressemble à une pièce de théâtre dont les enfants perdus seraient les acteurs (ils doivent « jouer la comédie »). Ceux-ci sont contraints par le garçon, qui n’hésite pas à user de sa force pour les faire participer à la feintise – que lui seul croit réelle, comme s’il s’agissait d’un jeu que lui-même prendrait au sérieux 14. Notons que ce jeu n’amuse pas forcément ses participants, comme en témoigne le soupir que pousse Flocon après sa prestation, « comme chaque fois qu’il avait esquivé de justesse une difficulté » (P.P., ch. vi, p. 96). Les enfants essayent d’ailleurs d’éviter certaines des lubies de leur chef, en utilisant, comme lui, des moyens langagiers. Alors que, à la demande de Peter, Wendy évoque en chantant la maison de ses rêves, ils doivent configurer selon ses désirs l’abri qu’ils sont en train de bâtir, au moyen de différents simulacres (« de larges feuilles jaunes en guise de rideaux », « ils firent semblant de palisser les murs des roses les plus jolies » [P.P., ch. vi, p. 97]). Cependant, lorsque la chanson fait état de « bébés au balcon » (P.P., ch. vi, p. 97), ils tentent de contrer l’ordre qu’ils craignent que Peter n’exprime :
Pour empêcher Peter de commander des bébés, ils se hâtèrent de reprendre leur chanson :
Nous avons garni la maison de roses,
Les bébés babillent à la porte close,
Sans doute sont-ils un peu âgés,
Car depuis longtemps nous voilà créés. (P.P., ch. vi, p. 97).
C’est par une parole à laquelle ils savent qu’ils se conformeront sans difficulté (ils ne devront pas faire semblant d’être des bébés, mais pourront se comporter devant Wendy comme des enfants de leur âge) que les enfants perdus répondent aux injonctions de Peter, ce qui indique une fois de plus les soubassements illocutoires du surnaturel mis en scène dans le roman. Du reste, ce surnaturel est fondamentalement miné, dans la mesure où c’est essentiellement sur le mode du simulacre que la parole de Peter est suivie d’effet : l’ « absolue confiance dans les pouvoirs créateurs du verbe 15 », qui est l’une des caractéristiques du surnaturel, est ébranlée, et avec elle, par conséquent, le surnaturel lui-même.
Wendy ou la magie du récit
Comme Peter, Wendy dispose d’une parole injonctive efficace. Les premiers mots qu’elle prononce après avoir accepté son rôle de mère sont pour demander aux enfants de rentrer, ce qu’ils acceptent sans rechigner : « Tous lui obéirent » (P.P., ch. vi, p. 101). Cette maîtrise du verbe s’étend chez elle aux capacités narratives, qui se laissent deviner dès son premier discours en tant que mère : « Entrez tout de suite, vilains enfants. Je suis sûre que vous avez les pieds trempés. Et, avant de vous mettre au lit, j’aurai tout juste le temps de vous finir l’histoire de Cendrillon » (P.P., ch. vi, p. 101). Cette compétence narrative est d’ailleurs mise en évidence par la structure générale du roman, puisque le chapitre xi est intitulé « L’histoire de Wendy ». Au cours de celui-ci, la fillette propose aux enfants perdus un récit inspiré de son vécu en famille 16 : elle évoque ses parents, ses frères et elle-même, non seulement en lien avec le passé, mais aussi en les projetant dans l’avenir. Son but est de montrer que l’amour d’une mère est indéfectible et que Mme Darling a donc certainement laissé la fenêtre ouverte en espérant le retour de ses enfants. Ce faisant, Wendy parvient à captiver son auditoire : « C’était une bien belle histoire, et les enfants en étaient aussi ravis que leur jolie narratrice. On ne pouvait rêver mieux » (P.P., ch. xii, p. 151). En plus d’être apprécié positivement, ce récit est suivi d’effet : en donnant aux enfants une confiance inébranlable en l’amour maternel, il les encourage à demeurer au Pays de Nulle Part, puisqu’ils sont convaincus que, de toute façon, leur mère ne les oubliera pas. À la fin du roman, l’efficacité du récit apparaîtra plus grande encore, car il se réalisera effectivement : les enfants Darling reviendront en famille, accompagnés par les garçons perdus, qui, à l’annonce du départ de Wendy, s’étaient affligés « non pas tant parce qu’ils allaient la perdre mais surtout parce qu’au bout du voyage l’attendait – ils le pressentaient – un bonheur qui leur restait inaccessible » (P.P., ch. xi, p. 155).
Pas plus que du côté de Peter, il n’est question pour Wendy d’une quelconque efficience magique : le pouvoir du récit appartient ici à l’ordre du perlocutoire. Le texte en indique deux dimensions fondamentales : la forme du message (« C’était une bien belle histoire ») et la qualité du locuteur (« leur jolie narratrice »). La petite fille ne ménage d’ailleurs pas sa peine pour utiliser les ressources du langage de sorte à provoquer certains sentiments chez ses auditeurs : elle n’hésite pas à se faire injonctive 17 et à utiliser les ressources de l’action rhétorique (l’hupocrisis d’Aristote 18). On retrouve ici la « magie sociale » de Bourdieu, qui requiert notamment la légitimité du locuteur et des allocutaires 19, laquelle est étroitement liée à l’installation, par Peter, de Wendy en position de mère – et à celle, corollaire, des enfants perdus en fils de cette mère d’adoption (cf. chapitre vi). La légitimité de la fillette dépend également d’un dispositif textuel qui, dès le début du roman, la met en évidence. Ainsi, bien que le premier chapitre, intitulé « L’arrivée de Peter », paraisse consacré à l’enfant qui ne veut pas grandir, l’incipit — dont on connaît l’importance stratégique dans toute œuvre narrative 20 — se centre sur Wendy : « Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu’ils grandiront. Voici comment Wendy le découvrit » (P.P., ch. i, p. 9). Quant à l’explicit, il prend place dans un chapitre dont le titre met en évidence Wendy (« Et Wendy devint femme »), même si le contenu du chapitre en lui-même ne néglige ni Peter, ni Jane (la fille de Wendy), ni Margaret (la fille de Jane). Ajoutons que, au cours du roman, la fillette se trouve valorisée de diverses manières, notamment parce qu’elle détient un savoir dont ne dispose pas Peter, comme le prouvent ces quelques exemples : elle connaît ce qu’est un baiser (P.P., ch. iii, p. 42), elle plaque sa main sur la bouche du garçon parce qu’elle sait « qu’il risqu[e] de se trahir en lançant son cri de guerre » (P.P., ch. viii, p. 120), elle est consciente du fait que l’auto-satisfaction de Peter pourrait nuire à sa réputation (P.P., ch. viii, p. 120)… Surtout, elle a de la mémoire, ce qui lui permet de raconter des histoires inventées par d’autres (comme celle de Cendrillon [P.P., ch. vi, p. 101]) ou de s’inspirer de son propre passé pour nourrir les récits qu’elle compose 21 ; au contraire, Peter se montre souvent déficient en matière de narration 22 parce qu’il oublie au fur et à mesure ce qu’il a vécu :
Il était tellement plus rapide qu’eux que, de temps en temps, il filait comme une flèche et disparaissait en quête de quelque aventure à laquelle ils n’avaient pas de part. Puis, il revenait, s’esclaffant encore des bonnes plaisanteries échangées avec une étoile mais qu’il avait déjà oubliées, à moins qu’il ne remontât avec des écailles de sirène encore collées à sa peau, et pourtant incapable de raconter ce qui s’était passé. (P.P., ch. iv, p. 60-61).
Le narrateur ou la magie de la régie
En mettant en exergue la figure de Wendy, c’est son rapport au langage que le texte consacre : le roman de Barrie n’est pas seulement l’histoire de Peter, ce metteur en scène fantasque qui, pris à son propre jeu, serait aveuglé par la pensée magique, mais aussi celle d’une raconteuse qui mène avec brio son entreprise de narration. Cette valorisation de la fonction narrative ne passe pas seulement par Wendy : elle est également en relation avec le narrateur, c’est-à-dire avec l’instance textuelle à qui échoit en principe la mission de raconter. En s’exprimant fréquemment à la première personne, celui-ci se caractérise par une implication personnelle qui lui permet de dévoiler les méandres du processus narratif, en particulier par l’exercice de la fonction de régie. En plusieurs occasions, il fait état du pouvoir qui est le sien d’organiser le récit selon sa volonté. La fin du chapitre vii est significative à cet égard. Alors qu’il doit raconter la fin d’une mêlée entre les Peaux-Rouges et les garçons perdus, le narrateur explique qu’il n’a pas encore décidé s’il allait ou non l’exposer en détail. En une longue digression, il passe alors en revue plusieurs histoires qu’il pourrait lui préférer, pour finalement conclure :
Laquelle de toutes ces aventures choisirons-nous ? Le mieux est de tirer au sort. C’est ce que j’ai fait et le lagon a gagné. […] Bien sûr, je pourrais retenter la chance et choisir la meilleure des trois ; enfin, peut-être est-il plus juste de s’en tenir au lagon. (P.P., ch. vii, p. 112).
Toutefois, les choix opérés ne sont pas toujours le fruit du hasard, comme en témoignent les dernières lignes du chapitre iii :
Atteindront-ils à temps la nursery ? Si oui, quel bonheur sans mélange pour eux et, pour nous, quel soupir de soulagement nous pousserions. Mais alors il n’y aurait pas d’histoire. D’un autre côté, s’ils arrivent trop tard, je promets solennellement que tout finira bien. (P.P., ch. iii, p. 55-56).
La première voie envisagée garantit le bonheur des personnages et le soulagement du lecteur. Il semble dès lors difficile d’opposer à cette issue euphorique une solution qui puisse, sur le plan des bénéfices escomptés, rivaliser avec elle. Le problème est que, si les personnages arrivent à temps à la nursery, l’histoire ne peut pas se dérouler. Ceci constitue un obstacle décisif, puisque l’on constate dès le paragraphe suivant que M. et Mme Darling arrivent trop tard et que le récit peut ainsi continuer. La poursuite de l’histoire apparaît de ce fait comme une priorité absolue, plus nécessaire que le « bonheur sans mélange » qui était promis initialement. Ainsi la fonction narrative est-elle valorisée de nouveau, d’autant plus que le narrateur se montre capable d’annoncer la fin du récit, soit parce qu’il en connaît déjà le déroulement, soit parce qu’il a le pouvoir d’orienter à sa guise le cours des événements.
Le narrateur manifeste encore son pouvoir en d’autres passages du roman : il montre par exemple son droit de vie et de mort sur les personnages lorsqu’il décide de sacrifier le pirate Lucarneau afin d’illustrer comment le capitaine se sert de son crochet ‒ « Tuons maintenant un pirate, pour illustrer la méthode de Crochet. Lucarneau fera l’affaire » (P.P., ch. v, p. 76). Néanmoins, cette maîtrise du récit comporte des limites, qui apparaissent clairement dans le chapitre xvi, au cours duquel les personnages font preuve d’une certaine autonomie dans la conduite du récit (« Nous venons d’écrire cela parce que c’était le charmant tableau qu’ils avaient imaginé avant de quitter le navire […] » [P.P., ch. xvi, p. 217]), ce qui rend impossible l’omniscience du narrateur :
Maintenant je comprends ce qui m’avait tant intrigué et pourquoi, après avoir exterminé les pirates, il n’était pas retourné dans l’île et avait laissé Tinn escorter les enfants vers le continent. Il avait combiné son coup depuis longtemps. (P.P., ch. xvi, p. 218).
Sans doute peut-on envisager, derrière l’instance théoriquement abstraite du narrateur, Barrie lui-même, dont il serait le représentant ‒ la « persona », comme l’appelle Butor 23 ‒, d’autant plus que le narrateur encourage ce rapprochement lorsqu’il envisage de prévenir Mme Darling du retour de ses enfants « comme le font certains auteurs » (P.P., ch. xvi, p. 211), et quand il se pose ouvertement en scripteur (« Nous venons d’écrire cela […] [P.P., ch. xvi, p. 217]). C’est donc l’auteur lui-même qui serait partagé entre son pouvoir sur le texte et une certaine impuissance face à un récit qui, à certains moments, lui échapperait. À cet égard, il n’est peut-être pas indifférent que Barrie ait été un grand amateur de Stevenson 24, qui, dans « Un chapitre sur les rêves », confessait que ses fictions étaient « le produit exclusif de quelque brownie, de quelque démon familier, de quelque collaborateur invisible […] 25 », et limitait ainsi la portée de son action :
Je suis un excellent conseiller, à la manière d’une servante de Molière. Je supprime, je retaille, j’habille le tout des meilleurs mots, des meilleures phrases que je puisse trouver ou inventer. Je tiens la plume, aussi. Et c’est moi qui reste assis à la table, ce qui est peut-être le pire de l’affaire 26.
Il serait certes exagéré d’appliquer exactement à Barrie ces mots de Stevenson, car le narrateur de Peter Pan (et derrière lui son auteur) se trouve plus souvent en situation de maîtrise qu’en position de simple conseiller. Il n’empêche que le pouvoir et ses limites coexistent dans le roman, où ils s’enchevêtrent de manière complexe, jusqu’à l’ambiguïté parfois 27.
Le surnaturel, entre magie et narration
C’est par une même ambiguïté qu’est marqué le surnaturel dans Peter Pan, partagé entre, d’une part, une dimension féerique assumée sans complexe et, d’autre part, le désenchantement provoqué par le dévoilement des illusions de la pensée magique, dont le texte indique qu’elle repose avant tout sur l’utilisation performative du langage. Cette hésitation perdure jusqu’à la fin du roman, qui se clôt sur l’éternel retour de Peter et de la féerie, mais aussi sur la reconnaissance du caractère indispensable de la narration, puisque, « chaque fois que revient le temps du nettoyage de printemps, excepté lorsqu’il oublie, Peter vient chercher Margaret et l’emmène au Pays de Nulle Part où elle lui raconte des histoires sur lui-même qu’il écoute avec avidité » (P.P., ch. xvii, p. 239).
Cependant, en dépit de cette coexistence, le rapport de forces ne tourne-t-il pas fatalement au désavantage de la magie, puisque celle-ci a besoin, pour être efficiente, d’une créance totale, que rend définitivement impossible la révélation ‒ même partielle et intermittente ‒ de ses fondements illusoires ? En définitive, le merveilleux, dans lequel « la pensée magique […] prend le pas sur la pensée rationnelle 28 », s’estomperait ainsi derrière une magie qui assumerait la médiatisation opérée par le langage et par le récit. Cette prééminence du langage est d’ailleurs programmée dès les premières pages, puisque Peter se manifeste pour la première fois sous une forme linguistique. En effet, lorsque, au cours des investigations qu’elle mène dans l’esprit de ses enfants, Mme Darling découvre le garçon, ce n’est pas le personnage en lui-même qu’elle remarque, pas plus que son image, mais le mot « Peter » :
Elle ne connaissait aucun Peter, et pourtant il était bien là, dans l’esprit de John et de Michael, et commençait à apparaître en gribouillis dans celui de Wendy. Ce nom s’inscrivait en lettres plus grosses que celles de tous les autres mots et Mme Darling, en le considérant, lui trouva une allure effrontée. (P.P., ch. i, p. 17).
L’être fabuleux qui donne son nom au roman est donc avant tout un signe linguistique, qui, de surcroît, s’intéresse principalement aux histoires : s’il vient à la fenêtre de la nursery, c’est « pour écouter des histoires » (P.P., ch. III, p. 47), et c’est parce que Wendy en connaît qu’il veut l’emmener avec lui (P.P., ch. iii, p. 48).
Peut-être Barrie perçoit-il que c’est dans les mots et dans la narration que réside le fondement de son art, lui qui a inventé Peter Pan pour les enfants Davies, à qui il raconte des histoires, « en particulier ce qui se passe dans les jardins de Kensington la nuit, après la fermeture des grilles 29. » Il sait ainsi que le surnaturel n’est pas donné d’emblée, mais qu’il est le résultat d’une transformation idéale du monde au moyen du matériau langagier. Cette focalisation sur le langage n’est pas une invention de Barrie, car les contes accordent depuis longtemps, selon leurs modalités propres, une grande importance à la parole 30. Il n’empêche que l’hésitation entre magie et narration porte la marque de son temps, dans la mesure où le tournant des xixe et xxe siècles voit se modifier profondément le rapport au surnaturel littéraire. Dans le domaine du fantastique, Max Duperray a ainsi montré que l’Angleterre assiste, à cette époque, à un passage d’un « fantastique traditionnel » à un « fantastique médiatisé 31 », d’une « sensibilité imaginaire » à un « scepticisme délétère 32. » Pour le merveilleux, Jean de Palacio a étudié comment, au même moment (mais en France cette fois), les contes se trouvent souvent détournés de leur sens originel, notamment par un mécanisme de « perversion par contrefaçon », qui « suscite des préoccupations, des paroles et des décors opposés à la logique du conte 33. » Les raisons de ces changements sont multiples : « […] le développement de l’esprit scientifique et de la méthode expérimentale », de même que « la naissance du naturalisme en littérature 34 », en plus de « cet esprit de Décadence inséparable de la fin du xixe siècle, qui n’a qu’éloignement ou aversion pour toutes les formes de naïveté et d’innocence, tant populaires qu’enfantines 35 », encouragent la défiance envers le merveilleux. En même temps, il existe à la jointure des xixe et xxe siècles une « surenchère du merveilleux 36 », sans doute « liée à un désir de réaction, à la fois contre l’hégémonie de la science et celle du réalisme 37. » L’époque est donc propice à la tension dans le domaine du merveilleux, pris entre refus et attirance, incrédulité et adhésion, ce qui contribuerait à expliquer l’ambiguïté qui caractérise le surnaturel dans Peter Pan.
Conclusion
Cette tension était en fait inscrite dans le titre original du roman, Peter and Wendy, qui mettait en évidence aussi bien le petit garçon confiant dans la magie de la parole que la fillette consciente de la puissance des histoires assumées comme produits langagiers. Avec le nouveau titre de 1915, Peter Pan and Wendy, le changement de « Peter » en « Peter Pan » permet de nommer plus complètement le garçon et de le mettre en valeur par rapport à une Wendy seulement prénommée ; il insiste en outre sur la dimension mythologique du personnage, grâce à son association avec le dieu du panthéon grec Pan. Ce phénomène est amplifié par de nombreuses rééditions, qui ne conservent que le nom de Peter Pan 38, laissant de côté celui de Wendy, et ce d’une façon significative : en se focalisant exclusivement sur un garçon dont le rapport au mythe est affirmé d’emblée, elles inscrivent le roman dans une féerie qui ne serait pas problématique, faisant ainsi l’impasse sur l’une des ambiguïtés fondamentales qu’il recèle ‒ et qui peut dérouter les enfants 39.
Peut-être serait-ce le destin de certains textes qui présentent conjointement l’enchantement et le désenchantement, la magie et ses ressorts, que d’être reçus partiellement, par une lecture qui chercherait à éviter la désillusion. Comme dans d’autres œuvres, la féerie tient, dans Peter Pan, à une utilisation spécifique du langage, qui permet d’habiter le monde en projetant sur lui l’image que l’on s’en fait, mais sans que sa nature n’en soit changée pour autant. Cependant, les enchantements promis par ce surnaturel désenchanté, qui passent par l’assomption de la narration et de la fiction ‒ d’une fiction qui se sait fictive et ne se prétend pas autre ‒ paraissent parfois trop lointains à ceux qui recherchent l’évasion immédiate qu’une féerie absolument magique semble mieux à même de prodiguer.
Il n’est d’ailleurs pas certain, finalement, que ce type de réception ne soit pas approprié à son objet : si, selon Alain Montandon, « Barrie montr[e], par le jeu de l’intertextualité, combien toutes ces histoires d’île au trésor, d’Indiens, etc., s’entrecroisent, se recoupent, se fécondent mutuellement 40 », l’auteur de Peter Pan indique aussi à quel point la rêverie peut se faire créatrice et susciter une lecture qui acquiesce à ces virtualités d’être.
- Philippe Forest, « Pan (Peter) », in Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes d’aujourd’hui [1988], Monaco, Éditions du Rocher, 1999, p. 600-607.
- Cf. Alison Lurie, Ne le dites pas aux grands. Essai sur la littérature enfantine [1990], Monique Chassagnol (trad.), Paris/Marseille, Rivages, coll. « Collection de littérature étrangère », 1991, p. 139. Cf. également ce qu’écrit Brian Stableford à ce propos : « Rewriting the story as a pantomime or a Disney cartoon — or as a nostalgic sequel, after the Spielberg film Hook — does serve to deflect attention from the bitter heart of the myth, but it could not be nearly so powerful without its tragic quality » (Brian Stableford, « Barrie, (Sir) J(ames) M(atthew) », in David Pringle [dir.], St. James Guide to Fantasy Writers, Detroit, St. James Press, 1996, p. 40).
- On pense par exemple à la bande dessinée de Régis Loisel (Peter Pan, 6 tomes, Issy-les-Moulineaux, Vents d’Ouest, 1990-2004) ou à certains textes contemporains (cf. notamment Fabrice Colin, CyberPan, Paris, Mango Jeunesse, coll. « Autres Mondes », 2003 ; Xavier Mauméjean, L’Ère du dragon, Paris, Mnémos, coll. « Icares », 2003 ; Richard Comballot (dir.), Les Ombres de Peter Pan, Paris, Mnémos, coll. « Icares », 2004).
- Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Cette pièce, créée en 1904 à Londres, se distingue essentiellement du roman en ce que celui-ci contient un dernier chapitre qui présente Wendy devenue adulte et mère à son tour, et dans lequel sa fille, Jane, prend sa place aux côtés de Peter. Il est à noter que cet épilogue, absent de la première version de la pièce, avait été ajouté par Barrie dans la version représentée le 22 février 1908. Celle-ci « ne fut […] donnée qu’à titre exceptionnel, pour clore en beauté la quatrième saison de la pièce, et ne fut pas reprise du vivant de l’auteur. D’ailleurs, il faudra attendre 1957 pour qu’elle soit enfin éditée » (Franck Thibault, « Préface », in James Matthew Barrie, Peter Pan ou Le Garçon qui ne voulait pas grandir [1937], Franck Thibault (trad.), Rennes, Terre de brume, 2004, p. 9 [p. 7-32]). L’étude en parallèle de l’œuvre dramatique et de l’adaptation romanesque serait certainement instructive, mais nous nous en tiendrons ici au roman.
- Peter and Wendy, Londres, Hodder and Stoughton, 1911. Ce roman fut réédité en 1921 par la même maison sous le titre Peter Pan and Wendy.
- Christian Chelebourg, Le Surnaturel. Poétique et écriture, Paris, Armand Colin, coll. « U », série « Lettres », 2006, p. 8.
- James Matthew Barrie, Peter Pan [1911], Henri Robillot (trad.)[1988], Paris, Gallimard jeunesse, coll. « Folio junior » n° 411, 2005, ch. I, p. 12. Les références à cet ouvrage, dont le titre sera abrégé en « P.P. », seront dorénavant mentionnées directement au fil du texte.
- « Paragraphe » est entendu ici au sens strict, c’est-à-dire comme un « ensemble d’alinéas ».
- Chelebourg, Le Surnaturel, op. cit., p. 71.
- Id., p. 44.
- d., p. 243.
- Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’Économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 109.
- Ibid.
- Cf. cet autre exemple : « “Faire semblant” était pour lui si réel que, durant un repas simulé, on pouvait le voir s’arrondir. C’était fort éprouvant mais il fallait bien s’incliner devant ses lubies » (P.P., ch. VII, p. 105) — mais le texte est ici ambigu, car on ne sait si Peter s’arrondit « magiquement » ou s’il fait semblant de grossir (ce que le terme « lubies » laisserait croire, sans que l’on puisse en être certain).
- Chelebourg, Le Surnaturel, op. cit., p. 243.
- Ce récit commence par « Il était une fois », c’est-à-dire par un « indice […] incontestable de la rupture avec le monde réel » (Chelebourg, Le Surnaturel, op. cit., p. 73), alors qu’il s’agit en fait d’une histoire racontant des événements s’étant réellement déroulés et que, d’ailleurs, les auditeurs ne s’y trompent pas : « Je les ai connus », dit John (P.P., ch. XI, p. 148), et Laflûte se réjouit de figurer parmi les personnages de l’histoire. Ainsi, même le marqueur d’entrée dans la féerie est invalidé.
- « Maintenant, je veux que vous pensiez aux sentiments des malheureux parents avec tous leurs enfants disparus », « Songez aux lits vides ! » (P.P., ch. XI, p. 149).
- « […] déclara Wendy triomphante […] », « […] reprit calmement Wendy […] », « […] dit Wendy en se concentrant pour ménager ses effets […] » (P.P., ch. XI, p. 150).
- Cf. Bourdieu, Ce que parler veut dire, op. cit., p. 111.
- Cf. notamment Andrea Del Lungo, L’Incipit romanesque [1997], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2003.
- Même s’il lui arrive aussi d’avoir « la mémoire oublieuse » (P.P., ch. VII, p. 107).
- Quoiqu’il se montre parfois capable de raconter l’une ou l’autre aventure (cf. P.P., ch. VII, p. 108).
- Cf. Michel Butor, Essais sur le roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1992, p. 76.
- Cf. Humphrey Carpenter et Mari Prichard, The Oxford Companion to Children’s Literature [1984], Oxford/ New York, Oxford University Press, 1995, p. 46.
- Robert Louis Stevenson, « Un chapitre sur les rêves » [1888], in Essais sur l’art de la fiction, France-Marie Watkins et Michel Le Bris (trad.), Paris, La Table ronde, 1988, p. 364 (p. 353-369).
- Ibid.
- Le narrateur a beau se reconnaître simple serviteur des personnages (à l’instar de Stevenson conseillant ses « brownies ») lorsqu’il entre dans la nursery, il ne manque pas de montrer son pouvoir en indiquant qu’ils mériteraient « d’arriver pour apprendre que leurs parents sont partis à la campagne » (P.P., ch. XVI, p. 211) ; mais il renonce à ce projet, craignant le courroux de Mme Darling s’il « infléchiss[ait] les faits dans ce sens » (P.P., ch. XVI, p. 211) — ce qui indique qu’il est capable d’influer sur le récit, mais que le déroulement de celui-ci est fixé à l’avance (par lui ou selon le bon vouloir des personnages, il est difficile de le préciser). Un peu plus loin, après avoir décidé d’observer les lieux en spectateur (P.P., ch. XVI, p. 213), il sort tout de même de sa réserve pour annoncer à Mme Darling que ses enfants vont revenir (P.P., ch. XVI, p. 217) ; il le fait « pour la rendre heureuse » (P.P., ch. XVI, p. 215), alors que, quelques pages auparavant, il formait ce projet pour empêcher l’effet de surprise espéré par les enfants (P.P., ch. XVI, p. 211) même s’il savait que leur mère lui « reprocherait vivement de priver les enfants de leur petit plaisir » (P.P., ch. XVI, p. 213) ; du reste, en ce qui concerne Mme Darling elle-même, il hésite, affirmant d’abord qu’il la méprise (P.P., ch. XVI, p. 213), puis confessant : « Certains préfèrent Peter, d’autres Wendy ; moi, c’est à elle que va ma préférence » (P.P., ch. XVI, p. 215).
- Chelebourg, Le Surnaturel, op. cit., p. 72.
- Alison Lurie, Ne le dites pas aux grands, op. cit., p. 145.
- Christian Chelebourg note que, dans les contes de fées, « “Il était une fois…” est l’indice infaillible d’un reniement des lois ordinaires de la nature, au profit d’un espace discursif à la cohérence exclusivement verbale » (Chelebourg, Le Surnaturel, op. cit., p. 73). On retrouve cette cohérence dans Peter Pan, mais sans le marqueur stéréotypique d’entrée dans la féerie, et avec une problématisation du rapport à la parole et à la narration.
- Max Dupperay, « La littérature fantastique en Angleterre au tournant du siècle. Quelques aperçus ordonnés », in Max Dupperay (dir.), La Littérature fantastique en Grande-Bretagne au tournant du siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1997, p. 13 (p. 11-55).
- Id., p. 55. « Partant du tropisme de l’étrangeté théosophique, hermétique ou kabbalistique, les textes vont d’un psychologisme d’atmosphère à un objectivisme détaché, mais […] ils ne se départissent jamais d’un présupposé réaliste pour faire passer à l’ère de la modernité triomphante l’écho lointain du sublime gothique […] ».
- Jean de Palacio, Les Perversions du merveilleux. Ma Mère l’Oye au tournant du Siècle, Paris, Séguier, 1993, p. 44.
- Id., p. 11.
- Id., p. 12 (dans le texte original, « esprit de Décadence » est souligné).
- Id., p. 15.
- Id., p. 17.
- Cf. Peter Hollindale, « Select Bibliography », dans James Matthew Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens. Peter and Wendy, Oxford/New York, Oxford University Press, coll. « World’s Classics », 1991, p. xxxi (p. xxxi-xxxii).
- Cf. à ce sujet les commentaires de Krista Johansen, qui écrit notamment : « Throughout, the narration is too self-conscious, which has the effect of never allowing the reader to forget that this is a consciously-created world ; it is all made up » (Krista V. Johansen, Quests and Kingdoms. A Grown-Up’s Guide to Children’s Fantasy Literature, Sackville [New Brunswick, Canada], Sybertooth Inc., 2005, p. 78).
- Alain Montandon, Du récit merveilleux ou l’Ailleurs de l’enfance : Le Petit Prince, Pinocchio, Le Magicien d’Oz, Peter Pan, E.T., L’Histoire sans fin, Paris, Imago, 2001, p. 15.
