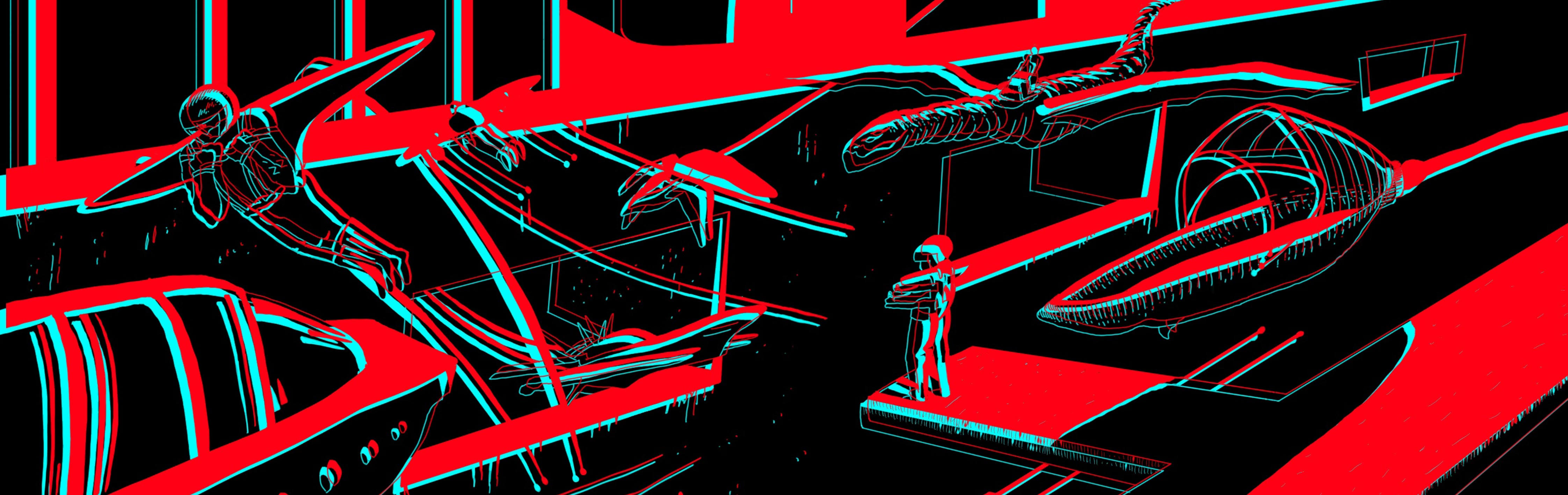
La quête sans fin de Philip K. Dick, explorateur des cosmos privés
Introduction : des influences, un marché, des intentions
Comme pour tous les auteurs, mais d’une façon certainement plus exacerbée, chez Philip K. Dick la création de mondes fictionnels repose sur des paramètres qui lui sont propres et qu’en principe il contrôle, et d’autres, extérieurs, sur lesquels il n’a pas prise. Nous commencerons donc par donner quelques repères qui permettront de voir comment s’est construit ce créateur de mondes, et qui constituent en quelque sorte la genèse de l’univers dickien. Jeune écrivain de science-fiction publiant sa première nouvelle en 1952 (« Roog »), Dick est d’abord conditionné par l’héritage classique du genre. Parmi les auteurs qui l’ont influencé, on note Bradbury et bien sûr Van Vogt, l’auteur de The World of Null-A (1948), roman à propos duquel Dick déclarait :
Je trouvais que ça avait une qualité prophétique ; c’est de là que m’est venue l’idée d’une mystérieuse qualité de l’univers qui pouvait être abordée dans la science-fiction. Ce que j’apercevais vaguement était une sorte de monde métaphysique, un royaume invisible de choses à peine entrevues 1.
La réalité derrière le voile, ce sera évidemment le thème majeur de Dick, fan avoué de science-fiction, mais aussi grand amateur de Platon, de l’allégorie de la Caverne et des philosophes présocratiques.
Il y a d’un côté un auteur en herbe qui veut placer ses écrits, et de l’autre un marché qui répond aux lois de l’offre et de la demande. Dick est attiré par les récits étranges, le fantastique, voire la fantasy 2, il n’est pas fasciné par la science. Mais le fantastique s’essouffle ; pour preuve, le déclin des pulps dédiés au genre : Unknown n’existe plus depuis 1943 et Weird Tales s’arrête en 1954. John W. Campbell règne en maître sur la revue phare Astounding Science-Fiction et il privilégie l’aspect scientifique du genre, au point de rejeter certains textes de Bradbury. On ne parle pas encore de hard science, mais la filiation est indéniable. Ce que Dick veut écrire ne correspond pas à ce moule, malgré tout il publie dans des magazines plus ouverts tels que The Magazine of Fantasy and Science Fiction, et s’il se sert de la quincaillerie de la science-fiction, c’est pour servir son propos. Après quelques compromis, Dick arrivera à ses fins pour se détacher de ses modèles et proposer la science-fiction originale que l’on connaît – originale pour son époque, avant d’être imitée, puis d’être rattrapée par la réalité, nous y reviendrons.
Le jeune Dick aime la science-fiction et les pulps. Il ne s’en cache pas, mais au contact de la communauté intellectuelle de Berkeley, qu’il fréquente quand il est étudiant, il prend également goût pour la « grande littérature » et des auteurs tels que Proust, Flaubert, Stendhal ou Joyce. « J’occupais là deux mondes qui normalement ne se recoupaient pas 3 », se souvient-il. La dualité des mondes littéraires est déjà au centre de sa vie. Une fois qu’il a su qu’il serait écrivain, il a eu l’ambition de percer dans la littérature générale, ambition sans lendemain, puisque sur la dizaine de romans qu’il a écrits, un seul sera publié de son vivant, Confessions of a Crap Artist (1974). Un échec qui l’amènera à réinsuffler du mainstream dans sa science-fiction, marquée par un certain manque de rigueur scientifique (on se souvient plus de la fiction que de la science), et, diront certains, un souffle de folie. « Dick était fou », jugement facile et réducteur, mais effectivement Dick avait tendance à ne pas réfléchir comme Monsieur tout le monde. La prise d’amphétamines – pour travailler comme un forçat – et de drogues – favorisée par l’époque, les années soixante, et le milieu, la contre-culture – a exacerbé ses tendances paranoïaques et schizophrènes, dont il aimait aussi jouer 4.
Cette brève contextualisation n’offre qu’un aperçu des modalités créatrices d’un auteur prolifique qui va envahir au propre comme au figuré l’espace science-fictionnel, ce terreau contribuant à créer un cadre fictionnel hétéroclite : au fil du temps, récit après récit, Dick va inventer un monde composite étrange, mélange de réalisme, d’absurde et de cauchemar, un monde où se côtoient le possible et l’impossible, le vécu et le fantasmé, le trivial et le métaphysique. C’est un univers que l’on a qualifié de divergent, désarticulé, incertain, chaotique, mais dans les meilleurs écrits de Dick, c’est un monde qui fonctionne, qui fascine et qui, du point de vue de son créateur, a un but. En effet, Dick se donne un objectif qui finira par tourner à la quête obsessionnelle, c’est de comprendre la nature du monde phénoménal, du « réel », et à terme, d’en donner une définition ; une lourde tâche qui soulève de multiples questions théoriques qui chez Dick, écrivain de science-fiction, genre populaire s’il en est, doivent passer par la représentation s’il veut faire accepter ses choix. Et c’est cette représentation qui fait la saveur de sa fiction, en illustrant de façon littérale diverses interrogations philosophiques ou ontologiques dans des univers imaginaires où les lois de la causalité sont mises à mal. Après avoir consacré une grande part de cet article à ce point, nous nous interrogerons sur le rapport complexe et changeant entre espace réel et monde(s) imaginaire(s) de la science-fiction, car près d’un demi-siècle après que Dick a inventé ces mondes fictionnels, déterminer avec précision lequel des deux a le plus d’emprise sur l’autre s’avère être une tâche de plus en plus ardue.
Comment l’imaginaire dickien s’empare de tous les espaces
Dick s’empare d’abord de l’espace « réel » de la science-fiction, le paysage éditorial, où sa signature apparait de plus en plus. Le jeune auteur publie quatre nouvelles en 1952, puis vingt-neuf en 1953, vingt-neuf en 1954, et douze en 1955, plaçant des textes dans vingt-trois pulps différents sur cette période, ce qui en dit long sur la santé du genre. Si sa production baisse à partir de 1955, c’est parce qu’il se met au roman, avec la même frénésie, en partie parce qu’écrire de la science-fiction n’est guère lucratif si on ne s’appelle pas Heinlein ou Asimov. Dick publiera ainsi jusqu’à douze romans en quatre ans (1964-1967). Là encore, le contexte réel – économique – a une incidence sur la production de fictions, les chefs d’œuvre côtoyant les textes alimentaires.
Sur le papier, Dick s’approprie l’espace imaginaire traditionnel de la science-fiction, celui des planètes lointaines. Pas si lointaines, puisque c’est souvent la planète Mars – ou l’un de ses satellites – qui sert de cadre lorsqu’il a besoin de situer son récit hors la Terre, dans des romans comme The Three Stigmata of Palmer Eldritch, Time Out of Joint ou The Simulacra 5. Il met aussi son empreinte sur l’espace commun, aux deux sens du terme, ordinaire et partagé. C’est la Terre d’un avenir pas très éloigné, peuplée des habituels antihéros dickiens aux prises avec leurs tracas quotidiens, des héros bien petits face aux groupes industriels et aux gouvernements plus ou moins totalitaires qui règnent en maîtres. On a souvent remarqué que ses personnages sont pour la plupart des Californiens et que la société qu’il met en scène ressemble beaucoup à celle de son époque, voire à la banlieue de Berkeley, son port d’attache 6. Comme le souligne Marcel Thaon, il y a souvent un clivage marqué entre ces deux mondes, des doubles aux images inversées. La Terre est surpeuplée, trop chaude, trop réglementée, alors que Mars est déserte, froide, et a des allures de Far-West. La représentation du monde est bipartite : sol natal/terre d’exil, dedans/dehors, humain/alien. La planète que l’on colonise, c’est aussi l’opportunité de reconstruire un monde, la perspective d’un recommencement, en évitant de reproduire les erreurs commises sur l’ancien monde. C’est du moins ce qu’on espère en théorie, les choses s’avérant plus compliquées en pratique, ce que Dick souligne avec ironie dans « Planet for Transients » (1953) où, fuyant une Terre aux ressources épuisées, les hommes débarquent sur Mars pour constater que le monde dans lequel ils plaçaient leurs espoirs n’est qu’une planète-poubelle laissée à l’abandon par leurs propres ancêtres.
Le monde comme représentation
La dualité Terre/planète étrangère est fréquente dans la science-fiction de l’époque. Ce qui l’est moins, c’est l’ajout d’un troisième espace : l’espace intérieur, qui va devenir le grand terrain de jeu de Dick, un laboratoire d’idées qui permet d’explorer les pistes les plus variées et d’échafauder les hypothèses les plus singulières. Et ce sera là sa marque de fabrique : dans sa fiction, Dick va mettre le sujet au centre de l’espace. L’auteur a beaucoup lu et assimilé, mais ce qui influence surtout sa fiction des débuts, c’est la théorie jungienne de la projection, c’est-à-dire « la transposition non intentionnelle et non perçue d’un état psychique subjectif vers le dehors, sur un objet extérieur, ce qui fait que l’on peut voir quelque chose qui n’est pas là – où n’y est que très peu 7. » Cette théorie, Dick la reprend à sa façon : « Ce que nous expérimentons comme extérieur à nous peut n’être qu’une projection de notre inconscient », ainsi « le monde de chaque individu doit être quelque peu différent de celui de chaque autre individu 8. »
On construit le monde comme on le perçoit. Dès sa première nouvelle, « Roog » (1952), Dick applique et illustre cette hypothèse. « Roog », c’est le monde vu à travers les yeux d’un chien, qui s’imagine que les éboueurs sont des êtres malfaisants, parce qu’ils volent les précieuses denrées que ses propriétaires stockent dans un conteneur métallique. Et si ces « méchants » mangent ce qui se trouve dans le coffre aux trésors à l’extérieur de la maison, pourquoi n’iraient-ils pas jusqu’à entrer dans la demeure pour y dévorer les occupants ? C’est en observant un vrai chien que Dick a eu cette idée. Un animal ne perçoit pas le monde comme nous, évidemment. Mais nous non plus, nous ne percevons pas le monde de la même façon que notre prochain, pour des raisons physiologiques ou pathologiques. Comment un aveugle perçoit-il le monde ? Comment un autiste appréhende-t-il le monde ? Le personnage de Manfred Steiner dans Martian Time-Slip offre à cette question des éléments de réponse effrayants : isolation, terreur et paralysie étant son lot quotidien. Mais cette différence existe d’abord parce que le monde extérieur passe par le filtre de la reconstruction mentale, un postulat que Dick exploite de façon jusqu’au-boutiste dans Eye in the Sky (1957), roman que Norman Spinrad définit comme « un interfaçage de réalités subjectives 9. »
Suite à un accident dans une installation militaire, les héros inconscients sont en effet amenés à voyager dans l’esprit les uns des autres, peu importe comment. Ils n’en ont d’abord pas conscience, mais quand les phénomènes bizarres s’accumulent, ils comprennent ce qui leur arrive, car dans leur monde à eux les choses ne se passent pas comme cela. Mais de quel monde parle-t-on au juste ? Ils sont d’abord dans l’esprit d’un vieux bigot pour qui le monde tourne selon les règles d’une foi moyenâgeuse. On pousse un juron, on a un bouton qui pousse sur le nez. On prie, et notre voiture en panne redémarre. Au supermarché on peut acheter des indulgences et des colifichets pour assurer le salut de son âme. Puis on passe dans l’esprit d’une paranoïaque, qui projette sa peur irraisonnée sur tout ce qui l’entoure : le téléphone et le grille-pain sont dangereux, l’escalier est un piège, la cave recèle des araignées monstrueuses, il y a des créatures lovecraftiennes partout. Sa maison veut même la dévorer comme dans Charnel House de Graham Masterton (1978), Dick n’ayant pas renoncé à ses premières amours fantastiques. Ensuite, dans le monde feutré d’une vieille puritaine très rigide, certaines choses n’existent pas, comme le sexe, les insectes, le bruit, les odeurs, à l’inverse du monde de la paranoïaque, qui ajoute des choses. À la fin de la séquence de la puritaine, ses compagnons la poussent au bout de sa logique absurde d’éradication et énumèrent tout ce qui peut la gêner. Au bout du compte, elle fait table rase d’innombrables catégories pour laisser un monde bien plus propre (« a much cleaner world ») quasiment vide. Qui n’a jamais rêvé d’en faire autant lui jette la première pierre… Ce qu’Eye in the Sky illustre, c’est que « les états mentaux altérés créent à leur tour des réalités altérées aussi ‟réelles” que ce que nous considérons individuellement comme ‟la réalité fondamentale” 10. »
Dis-moi comment tu vois le monde, je te dirai qui tu es. Un principe que Dick reprend dans un passage de A Maze of Death (1970) : les héros en quête de vérité arrivent devant un bâtiment mystérieux qui pourrait leur apporter les réponses aux questions qu’ils se posent : où sont-ils ? Que leur est-il arrivé ? Ils sont en fait dans une reconstruction mentale et numérique de l’univers. L’édifice est une « Vinerie » (« Winery ») pour le bon vivant, une « Bestialerie » (« Hippery hoppery ») pour l’obsédé sexuel, une « Spiritualerie » (« Wittery ») pour l’intellectuelle, une « Sorcerie » (« Witchery ») pour la mystique illuminée. Tous projettent ce qu’ils sont sur le monde extérieur, ou supposé tel. Dans Eye in the Sky, le monde de la paranoïaque est ainsi empreint de terreur, celui du bigot animé d’une magie grotesque, celui de la puritaine régi par un aveuglement conduisant à d’absurdes éradications. Il y a une constante, c’est la part d’obsessionnel dans chacune de ces visions, ainsi de celle du militaire nationaliste, qui voit de dangereux communistes à chaque coin de rue – le livre a été écrit en pleine période maccarthiste. Et si la plupart de ces personnages sont obsessionnels, n’est-ce pas parce que Dick l’était aussi, projetant et transposant un aspect de sa psyché sur la leur ?
Eye in the Sky est l’un des premiers romans de Dick, et il se caractérise par son humour et sa fraîcheur, en particulier dans la représentation littérale de ces mondes revus et corrigés par l’esprit. Tentant de s’enfuir du monde du bigot, deux des héros s’envolent dans le ciel en s’accrochant à un parapluie, dans le plus pur style Mary Poppins. Ils montent, ils montent… pour finir par nous offrir un aperçu de la Terre vue du ciel assez particulier, puisqu’ils découvrent un univers ptolémaïque dans toute sa splendeur : un petit soleil tourne autour d’une Terre énorme, alors qu’au loin de minuscules étoiles scintillent. La représentation moyenâgeuse prend un tour encore plus fantasmagorique quand les explorateurs sont confrontés à une vision du ciel et de l’enfer, bien entendu placés au-dessus et en dessous de la Terre. Certains passages de Eye in the Sky ont ainsi un petit air du Pilgrim’s Progress de Bunyan (1678), avec ses illustrations littérales des préceptes de la Bible. Les hommes repeignent le monde avec leurs yeux, et certains d’entre eux sont vraiment de piètres artistes – des « crap artists », dirait Dick.
Faisant preuve du relativisme intégral qui le caractérise, l’auteur imagine donc qu’il y a autant de mondes que d’humains, des mondes intérieurs, des cosmos privés qui peuvent se rejoindre et se ressembler, un peu, beaucoup, ou pas du tout. Ce qui fait aussi la singularité de sa fiction, c’est l’interaction entre l’espace extérieur commun et les mondes intérieurs privés. Et ce lien complexe entre les différentes sphères a pour conséquence que d’une scène ou d’un chapitre à l’autre, on passe d’un monde proche du nôtre à un monde aux lois différentes, souvent sans indicateur. Lecteurs et personnages peuvent ainsi franchir un seuil sans le savoir, ce qui crée un climat étrange où règne l’incertain. Dans Ubik (1969), il y a une passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants. Dans The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1964), les frontières de tous ordres disparaissent, entre monde réel et fantasmé, entre présent et futur, entre la Terre et Mars. La mobilité entre les mondes s’accentue car les frontières sont de plus en plus poreuses, et c’est ce qui caractérise le monde selon Dick 11.
Le monde comme reconstruction
Chez Dick, l’individu ne revisite pas seulement le monde dans son esprit, il arrive aussi que l’on construise un monde truqué autour de lui. Ainsi, dans le monde en guerre de Time Out of Joint (1958), on fabrique toute une ville en carton-pâte autour d’une seule personne, le héros Ragle Gumm, à la façon du film The Truman Show (Peter Weir, 1998), qui s’en est largement inspiré. Gumm est un stratège militaire qui a fini par craquer et qui s'est retiré mentalement dans l'époque de son enfance. Pour continuer à utiliser ses indispensables talents, les autorités ont donc recréé ce monde paisible d’autrefois, où Gumm joue au concours du journal local « Où sera le petit homme vert demain ? ». Sans le savoir, en jouant à ce jeu de type bataille navale, il contribue à l’effort de guerre en localisant les frappes des missiles ennemis. La soi-disant fiction ludique a une raison d’être stratégique vitale dans le monde réel. Pour cela, il a fallu construire tout un monde en dur autour du sujet, une ville factice bucolique, comme dans la série The Prisoner (Patrick Mc Goohan, 1967-1968). « All the world’s a stage », écrivait Shakespeare (As You Like it, 1623). Ici, c’est une ville entière qui est recomposée comme un décor de cinéma et peuplée d’acteurs et de figurants, tous aimables, tous complices. On se trouve en présence d’un chronotope complètement faussé, car si la ville est truquée, le temps et le contexte historique le sont aussi, puisque Gumm se croit en 1959, alors qu’on est en 1998, et qu’on entretient l’illusion d’un monde paisible alors que celui-ci est en guerre. Le monde travesti se met au diapason de la régression mentale et temporelle du héros et entretient sa psychose pour mieux s’en servir.
Dans The Penultimate Truth (1964), on travestit le monde grâce aux médias : la presse et la télévision – on n’imaginait pas encore internet. Cette fois, le monde factice est construit en deux dimensions, par l’image et le verbe. La manipulation est inverse : on ne truque pas la réalité pour un individu mais pour tout un peuple, et on impose une réalité au sujet plutôt que de l’accompagner dans son délire personnel. Les autorités font ainsi croire que la guerre se poursuit et a transformé la terre en désert nucléaire, alors que le conflit est terminé depuis des années et que la planète reverdit. But de l’opération : garder sous contrôle la population parquée sous terre et éviter qu’elle ne répète les erreurs du passé. Comment donner au mensonge l’allure du vrai ? Grâce au poids des mots et au choc des photos. Faux reportages télévisés agrémentés de visions d’apocalypse hollywoodiennes, faux journaux dignes des meilleurs propagandistes de l’Histoire, discours idéologiques élaborés du leader virtuel Yancy. « L’outil fondamental pour la manipulation de la réalité est la manipulation des mots. […] Orwell l’a mis en évidence dans son roman 1984 12 », souligne Dick, dont l’œuvre regorge de figures tyranniques : dictateur bienveillant dans Now Wait for Last Year (1966), dictateur idéologue à la Hitler dans The World Jones Made (1956), dictateurs nazis dans The Man in the High Castle (1962), où le verbe est combattu par le verbe, puisque c’est un livre à l’intérieur du livre qui essaie de remettre le monde à l’endroit en rétablissant une vérité historique tronquée : non, nous ne vivons pas dans un monde où l’axe germano-nippon a gagné la Seconde Guerre mondiale.
Dans The Penultimate Truth, le chronotope est aussi basé sur un leurre, puisque la population croit vivre une époque de guerre qui est en fait révolue, et est confinée dans un lieu qu’elle aurait toutes les raisons de fuir. Quant au leader Yancy, ce n’est qu’un faire-valoir, un simulacre de synthèse dont les mots sont écrits par une équipe de scénaristes. Des leaders en carton, il y en a plusieurs chez Dick, comme dans The Simulacra (1964) et son faux couple présidentiel, composé d’un robot pour le président et d’une série d’actrices qui endossent tour à tour le rôle de la First lady qui ne vieillit jamais. De fausses réalités sont mises en scène par des acteurs, des figurants, des machines à forme humaine et des humains arrivés à un stade plus ou moins avancé de déshumanisation, soit qu’ils agissent comme des robots programmés, soit qu’ils deviennent insensibles au sort de leurs semblables. Pour Dick il est évident que « de fausses réalités engendrent de faux êtres humains 13. »
C’est là que se rejoignent les deux grandes préoccupations de l’auteur : « Qu’est-ce que la réalité ? » et « Qu’est-ce qui constitue un être humain authentique ? » Ce n’est pas mon propos de revenir sur les différences entre machines humanisées et hommes déshumanisés, mais je soulignerai que le monde n’est pas une île déserte, un décor vide. Il est peuplé d’êtres vivants, ou qui ont l’apparence du vivant, et qui entretiennent l’idée selon laquelle les apparences peuvent être trompeuses. Dès lors que l’homme prend conscience du monde qui l’entoure, il y met sa touche personnelle, l’observateur modifiant l’objet contemplé, de façon intérieure avec les cosmos privés, ce qui est en général inoffensif. Mais si l’on a les moyens d’influer sur le réel, le remodelage du monde peut se faire de façon beaucoup plus invasive et oppressive. À cet égard, pour Dick, l’information c’est le pouvoir, et qui contrôle la communication des images contrôle et refaçonne le monde :
Nous vivons aujourd’hui dans une société où les médias, les gouvernements, les grandes compagnies, les groupements religieux et les partis politiques fabriquent des pseudo-réalités – et il existe l’équipement électronique requis pour faire rentrer ces univers illusoires dans la tête du lecteur, du spectateur, de l’auditeur. […] C’est un pouvoir stupéfiant : celui de créer […] des univers mentaux. Je devrais le savoir. Je fais la même chose 14.
Le propos de Dick n’est pas entièrement nouveau : le réalisateur révisionniste de The Penultimate Truth, Gottlieb Fischer, est directement inspiré de Goebbels, ministre de la propagande nazie qui contrôlait tous les médias. Comme l’explique Hannah Arendt, « les faits dépendent entièrement du pouvoir de celui qui peut les fabriquer 15. » La pratique est ancienne, seuls les moyens et les méthodes changent.
Science-fiction ou prémonition du monde de demain ?
Ce n’est donc pas nouveau, mais ce qui est intéressant, c’est qu’« aujourd’hui », pour Dick, c’est 1978, une époque où l’information était encore transmise par les journaux, la télévision ou la radio. C’était le temps des téléphones filaires, avant la démocratisation des ordinateurs, bien avant internet. Et pourtant il parle de « mécanismes électroniques » qui créent « des univers mentaux ». C’est là qu’un complément de perspective historique amènera cette réflexion vers son dernier point. En 1952, année des débuts littéraires de Dick, année de publication de The Demolished Man d’Alfred Bester, la science-fiction post-Hiroshima commence déjà à s’émanciper des anciens modèles dits de « l’Âge d’or ». En 1982, année de la mort de Dick, sort Blade Runner, le film de Ridley Scott, grand inspirateur du mouvement cyberpunk, qui s’apprête à secouer le monde de la science-fiction en créant une nouvelle mythologie. Dick est arrivé alors qu’une certaine forme de science-fiction disparaissait, et il a contribué à l’enterrer (ne fut-ce que provisoirement, car le space opera a pu renaître de ses cendres dans les années 90), et il est parti juste avant l’apparition d’une nouvelle forme, qu’il a contribué à créer.
Bien que Dick n’ait jamais cultivé la fascination technologique et informatique du mouvement cyberpunk, il le préfigure néanmoins, car toute son œuvre porte en gestation les univers de la virtualité et ses avatars technologiques, même si, « au contraire d’un Brunner avec Sur l’onde de choc [The Shockwave Rider] en 1975, Philip K. Dick n’a jamais anticipé à la lettre l’informatique individuelle 16. » En explorant les mondes intérieurs et les mondes truqués, en peuplant le monde réel de machines intelligentes, Dick a tracé sans le savoir la carte du monde de demain à la manière d’un prophète aveugle. Comme le suggère le designer numérique Adam Greenfield 17, sans rien avoir entrevu d’internet, Dick aurait même anticipé le monde post-PC et post-internet, le monde en permanence connecté, qui au quotidien nous met au contact d’intelligences ou de vies artificielles, via nos téléphones, mais aussi nos montres, nos chaussures de sport et bientôt nos lunettes, par la magie des puces électroniques et des nanotechnologies. Dans le monde dickien, il y a une bonne part d’animisme, d’abord parce qu’on prête une intention aux objets, comme la paranoïaque de Eye in the Sky, mais aussi parce que les objets finissent par réellement s’animer 18. Chez Dick, il y a des animaux électriques dans les jardins (Do Androids Dream of Electric Sheep ?, 1968), on discute avec un robot-taxi (« We Can Remember It for You Wholesale », 1966), on se dispute avec sa porte d’entrée (Ubik, 1969), on se fait psychanalyser par une valise (The Three Stigmata of Palmer Eldritch, 1964), des publicités volantes débarquent dans les appartements comme des drones indésirables (The Simulacra, 1963). « Notre environnement, ce monde de machines […], de mécanismes artificiels, d’ordinateurs, de systèmes électroniques […] est en train de prendre vie 19 », écrit-il en 1972.
Trente ans après sa naissance, le cyberpunk a été rattrapé par la réalité, avec l’internet mondial, le piratage banalisé, les objets connectés, l’omniprésence informatique. Pour beaucoup d’utilisateurs, le monde virtuel est aussi présent que le monde réel, si tant est que cette dichotomie fasse encore sens. Avant, on entendait que le cybermonde n’était pas « réel ». Mais moins réel que quels mondes ? Celui de la télévision ? De la radio ? De notre voisin de palier ? De parfaits étrangers vivant à 5000 kilomètres de notre sphère personnelle ? L’opposition entre monde tangible et monde numérique s’efface, les frontières disparaissent tant et si bien que le virtuel envahit le réel. Parfois il s’y dilue, parfois il s’y substitue, la fusion s’opère à des degrés divers selon les individus, que ce soit de leur plein gré ou à leur insu. Cela nous ramène à Dick et son univers où la cohabitation entre cosmos privés et monde extérieur commun est la règle. Ses univers privés ne sont pas créés par l’informatique – souvent par les drogues – mais les principes de cohabitation, de passage et d’amalgame entre ces mondes parallèles sont les mêmes que ceux qui régissent les rapports entre notre bonne vieille terre et le cyberespace, que ce soit dans la dimension imaginaire – voir des films tels que Matrix (les Wachowski, 1999) – ou réelle – voir l’utilisation du programme informatique « Second Life ».
James G. Ballard, autre auteur de science-fiction majeur, très différent de Dick, mais lui aussi peu versé dans les nouvelles technologies, a également eu une vision très juste de l’avenir en marche. En observant l’explosion de l’univers médiatique et technologique, il faisait le constat de « la mort de la réalité ». Selon lui, autrefois,
[…] les gens faisaient clairement la distinction entre le monde extérieur, celui du travail, de l’agriculture, du commerce, des relations sociales, […] et le monde intérieur, celui de l’esprit, des rêves éveillés […]. À présent la situation s’est inversée. Les paysages extérieurs sont presque entièrement fictifs, créés par la publicité, la consommation de masse, la politique pratiquée comme la publicité 20.
C’est l’avènement de la « société du spectacle » selon Debord 21, mais aussi et surtout, nous sommes au cœur des principes de « simulacre » et de « simulation » selon Baudrillard, qui s’est intéressé aux deux auteurs 22. Pour Ballard, la fiction est partout, à tel point que « nous vivons à l’intérieur d’un énorme roman » (un roman de Dick, serait-on tenté de dire) et que « [l]e travail du romancier est d’inventer la réalité 23. » Dick n’a pas essayé d’inventer la réalité, mais de la définir, et au bout de vingt ans de réflexion il avoue qu’il n’a pas trouvé mieux que cette définition : « La réalité est ce qui, lorsqu’on cesse d’y croire, ne s’en va pas 24. » Ce n’est pas un aveu d’échec, car ce qui importe le plus, ce n’est finalement pas la réponse, qui ne cesse d’évoluer en même temps que le monde se transforme. Ce qui compte, c’est la réflexion, la quête, évidemment sans fin.
En cherchant à savoir ce qu’était la réalité, Dick lui a donné un nouveau visage dans ses livres. C’était de la science-fiction il y a cinquante ans, c’est le monde en mutation d’aujourd’hui. Notre monde peuplé de machines intelligentes, de simulacres, d’avatars et d’acteurs, conditionné par une gigantesque interface réel/virtuel, c’est le monde qu’a entrevu Philip K. Dick, un monde où la science-fiction s’est diluée partout, via la culture populaire et les nouvelles technologies. Alors qu’on aurait pu prendre cette exploration des mondes privés pour un exercice solipsiste un peu vain, il s’avère que Dick a entrevu ce que serait le XXIe siècle. « Nous vivons dans un monde dickien » : c’est une phrase qui relève du cliché. Ce monde dickien qui devient peu à peu le nôtre, c’est celui de Minority Report (Steven Spielberg, 2002) et de Blade Runner (Ridley Scott, 1982).
Après sa mort, la figure de Dick a continué de rayonner dans le monde de l’imaginaire. Il est devenu héros de roman, officiellement (Michael Bishop, Philip K. Dick is Dead, Alas, 1987), ou sous forme de pastiche (Christopher Miller, The Cardboard Universe, 2009), de bédé (Robert Crumb, The Religious Experience of P.K. Dick, 1986), on a écrit des suites à ses œuvres (K.W. Jeter, Blade Runner 2, 3, 4, 1995, 1996, 2000), on les a adaptées au théâtre (Flow my Tears, the Policeman Said, 1985), au cinéma (douze films), à la télévision (The Man in the High Castle, 2015-2017), en comics (Tony Parker, Do Androids Dream of Electric Sheep?, 2009-2010), on a écrit des histoires « à la manière de » (Dimension Philip K. Dick, Richard Comballot ed., 2008), on lui a consacré des biographies (Lawrence Sutin, Divine Invasions, 1989), d’innombrables études, des monographies, des sites internet, un ingénieur a même façonné un robot ayant le visage de Dick (David Hanson, 2005). Devenue iconique, son image plane et se répand partout à la manière de son personnage Palmer Eldritch, une omniprésence post-mortem que l’auteur d’Ubik aurait goûtée avec ironie. L’autre grande ironie, c’est que Dick voulait appréhender le monde au moyen de sa (science-)fiction, mais c’est finalement le monde qui s’est emparé de celle-ci.
- « Entretien avec Charles Platt », Jacques Chambon (trad.), p. 271-286, in Richard Comballot (dir.), Philip K. Dick : Simulacres et Illusions, Chambéry, ActuSF, 2015, p. 273.
- Voir des nouvelles comme « The Father-Thing » (1954), « The Cookie Lady » (1953), « Upon the Dull Earth » (1954), « The King of the Elves » (1953).
- « Entretien avec Charles Platt », in op. cit., p. 273.
- « J’ai passé une fois le Minnesota Multiphasic Test […] et il en est ressorti que j’étais paranoïde, cyclothymique, névrotique et schizophrène […] Mais il apparaissait aussi que j’étais un incorrigible menteur », se plait à confesser Dick (Ibid.).
- Voir Marcel Thaon, « La planète Mars de Philip K. Dick », postface à Glissement de temps sur Mars, Paris, Presses Pocket, 1986, p. 295-318.
- Voir Laurent Queyssi, « Un artisan de génie : personnages et structures narratives chez Philip K. Dick » [2000], p. 87-107, in Comballot (dir.), Philip K. Dick : Simulacres et Illusions, op. cit.
- Marie-Louise von Franz, Reflets de l’âme. Projections et recueillements selon la psychologie de C.G. Jung (Spiegelungen der Seele) [1990]. Présentation de la réédition, Paris, Entrelacs, 2011.
- « Entretien avec Charles Platt », in Comballot (dir.), op. cit., p. 274.
- Norman Spinrad, « La transmutation de Philip K. Dick » [1990], p. 45-62, in Hélène Collon (dir.), Regards sur Philip K. Dick, Paris, Encrage / Les Belles lettres, 2006, p. 56.
- Ibid.
- Aspect de sa fiction traité dans la communication « Voyages immobiles et quêtes impossibles dans Le Dieu venu du Centaure de Philip K. Dick, roman des frontières éclatées », colloque du CERLI 2014, Mobilités dans les récits de fantastique et de science-fiction (XIX-XXIe siècles) : quête et enquête(s). Article à paraître.
- Philip K. Dick, « Comment construire un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard » (« How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later ») [1978], Emmanuel Jouanne (trad.), in Le Crâne, Paris, Denoël, « Présence du futur », 1986, p.20. « The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words […] George Orwell made this clear in his novel 1984. »
- Id., p.17. « Fake realities will create fake humans »
- Id., p.15. « today we live in a society in which spurious realities are manufactured by the media, by governments, by big corporations, by religious groups, political groups – and the electronic hardware exists by which to deliver those pseudoworlds right into the heads of the reader, the viewer, the listener. […] it is an astonishing power : that of creating […] universes of the mind. I ought to know. I do the same thing. »
- Hannah Arendt, Le Système totalitaire (The Origins of Totalitarianism) [1951], Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 76.
- Ariel Kyrou, ABC Dick, nous vivons dans les mots d’un écrivain de science-fiction, Paris, éditions Inculte, 2009, p. 173.
- Adam Greenfield, Every[Ware], La Révolution de l’ubimédia, (Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous [2006], Cyril Fiévet (trad.), Limoges, FYP Éditions, 2007. « L'ubimedia peut se définir comme ce qui reste de l'informatique quand les ordinateurs ont disparu — ou plutôt, ont fusionné avec tout ce qui nous entoure. Un monde de puces communicantes, de capteurs en tous genres, de surfaces interactives et d'interfaces innovantes, qui redéfinissent notre conception des objets, des lieux et des relations sociales. » (4ème de couverture).
- Voir le microscope « tueur » de « Colony » (1953), l’usine vivante d’« Autofac » (1955), les jouets animés de « The Little Movement » (1952), préfigurant ceux de Toy Story (John Lasseter, 1995) ou Small Soldiers (Joe Dante, 1998), les souliers baladeurs de « The Short Happy Life of the Brown Oxford » (1954), animés en vertu du « Principe d’Irritation Suffisante » qui convaincra plus les amateurs de Brown ou Sheckley que les amoureux de la science.
- P.K. Dick, « L’homme et l’androïde », (« The Android and the Human ») [1972], Martine Bastide (trad.), in Le Grand O, Paris, Denoël, « Présence du futur », 1988, p.12. « our environment […] of machines, artificial constructs, computers, electronic systems […] is becoming alive. »
- Entretien in Friends 17, octobre 1970. « people made a clear distinction between the outer world of work and of agriculture, commerce and social relationships […] and the inner world of their own minds, daydreams […]. Now the whole situation has been reversed. The exterior landscapes are almost entirely fictional ones created by advertisisng, mass merchandising, and politics conducted as advertising » (notre traduction).
- Guy Debord, La Société du spectacle [1967], Paris, Gallimard, « Folio », 2008.
- Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, éditions Galilée, 1981.
- Préface à Crash !, Robert Louit (trad.), Paris, Calmann-Levy, coll. « Dimensions », 1974, p. 11. « We live inside an enormous novel […] The writer’s task is to invent the reality. »
- Dick, Le Crâne, op. cit., p.14. « Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away. »
