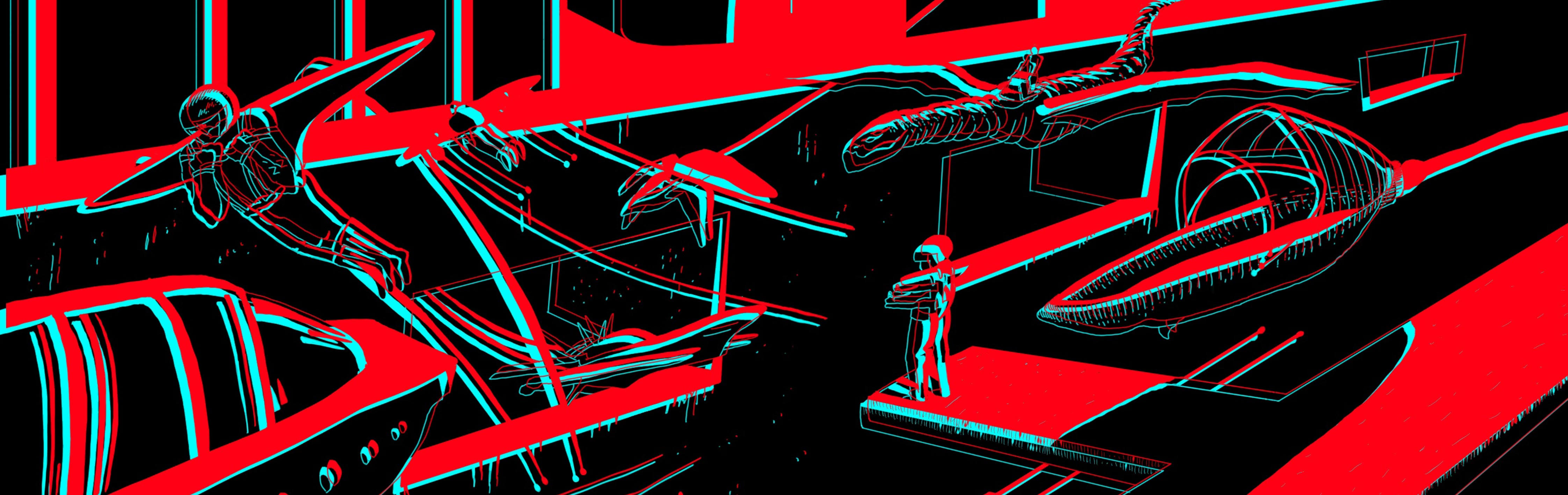
You shall not pass ! Les mondes sans adultes, un essai de décolonisation culturelle ?
Eloignez-les tous !
Rien de tel qu’un bon vieux crash d’avion pour se débarrasser des adultes et vivre, enfin, une aventure digne de ce nom : nous pouvons reconnaître Lord of the Flies (1954) de William Golding, lui-même inspiré du Coral Island de Ballantyne (1858), roman dans lequel quelques garçons survivent, seuls, à un naufrage qui emporte les adultes.
Mais l’absence d’adultes n’est pas toujours le fait d’un très malencontreux accident. En 1876, c’est l’exaspération qui conduit Tom Sawyer à gagner une petite île du Mississippi pour se défaire de ces adultes injustes et beaucoup trop encombrants. Plus récemment, un autre enfant terrible, Rufio, qui remplace provisoirement Peter Pan dans la version de Steven Spielberg de l’histoire de James Matthew Barrie (Hook, 1991), ne se contente plus d’être en lutte contre quelques pirates : « All grown-ups are pirates…We kill pirates », s’exclame-t-il dans un syllogisme qui nous condamne sans pitié : les enfants tuent les pirates, les adultes sont des pirates, donc les enfants tuent les adultes. En 2008, Nicolas Bary propose une adaptation cinématographique du Timpetill de Henry Winterfeld (Timpetill. Die Stadt ohne Eltern, 1937), réaffirmant notre appétit contemporain pour un monde dépeuplé – au moins provisoirement – de ses adultes, psychologiquement « matés » par les enfants selon le mot d’Oscar, chef de bande. Il n’est donc plus question de laisser les adultes disparaître par accident, de s’en tirer à si bon compte : aux jeunes la charge (ou, plutôt, le privilège) de les bouter au-delà des frontières de leur pays imaginaire, qu’il soit île ou village, navire ou même monde tout entier.
Dans la deuxième saison de la série Sliders (saison 2, épisode 11, 1996, « The Young and the Relentless »), Quinn et ses compagnons glissent dans un monde dominé par la jeunesse : les plus de trente ans (lecteurs et lectrices concerné-e-s sauront se reconnaître) forment alors une population d’adultes-retraités, économiquement et socialement disqualifiés, marginalisés. Plus tôt, en 1929, Antonin Artaud, père du théâtre de la cruauté, monte symptomatiquement Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac (1928), pièce dans laquelle l’enfant pousse son entourage au suicide. La jeunesse semble décidée à rendre aux aînés la monnaie de leur pièce, et qu’importe le crime. Pour être adulte, il faut nécessairement être coupable – au moins envers les enfants.
Si le projet n’est pas toujours aussi sombre, il reste que la distinction adulte/enfant et vieillesse/jeunesse, qui pourrait figurer au nombre des oppositions symboliques qui structurent, selon Pierre Bourdieu, notre champ de pensée, continue aujourd’hui à faire l’objet d’une mise en scène privilégiée, à l’heure même où la frontière entre les générations tend à s’impréciser, en termes d’âge (la jeunesse est portée à 30 ans), mais également en termes de pratiques, de consommation : en somme, en termes de différenciation. D’où cette question qui nous anime : le succès actuel des mondes sans adultes offre-t-il une réponse à un effacement de la possibilité pour la jeunesse de faire groupe, ou de faire communauté ?
On pense, comme témoins de ce succès, à l’intérêt renouvelé pour la figure de Peter Pan comme adolescent éternel (saison 3 en particulier de la série Once Upon a Time), aux adolescents prisonniers du bloc dans Le Labyrinthe de James Dashner (adapté en 2014 au cinéma par Wes Ball), à la saga Gone de l’Américain Michael Grant, à The 100, série télévisée développée par Jason Rothenberg en parallèle aux romans de Kass Morgan, ou encore à Pixel Noir, roman de Jeanne-A Debats publié en 2014 chez Soon. De quoi, à l’heure où les cultures se colonisent et s’échangent sans distinction au profit d’une désignation « grand public », interroger la manière dont la jeunesse travaille à exclure, en fiction, des adultes avec lesquels elle est amenée à partager, de plus en plus, des objets culturels qu’elle se croyait destinés. Ainsi, au-delà des États et Empires imaginés, ces fictions induisent le questionnement suivant : un monde sans adultes est-il déjà un autre monde ? Dans quelle mesure cette privation peut-elle constituer une logique de production ?
En premier lieu, se défaire les uns des autres permettrait possiblement une réaffirmation communautaire et un refus d’une communication des goûts, voire un refus de ce que nous sommes si souvent tentés d’appeler une « culture de masse ». Cette redistribution communautaire semble alors favoriser une lutte non plus externe mais interne de la jeunesse contre elle-même : ce qui, en réalité, n’évacue pas des adultes certes discrets, mais attentifs. Des adultes qui, enfin, se nourrissent d’une double crise, la crise adolescente doublant une crise du monde nécessaire à l’hégémonie d’un modèle, dans une logique d’absence activante.
Un Empire, est-ce une frontière ?
Au commencement était la disparition. Dans le premier tome de Gone, tous les individus de plus de 15 ans disparaissent soudainement. Dans The 100, ce sont cent individus de moins de 18 ans qui sont envoyés sur Terre par des adultes réfugiés dans l’espace, dans une fiction post-apocalyptique. Dans Pixel Noir, seuls des mineurs sont envoyés dans un virtuel de repos élaboré pour des malades ou blessés graves.
On remarque, en premier lieu, la réaffirmation d’une démarcation nette entre jeunes et adultes, selon un principe de retranchement salutaire (repeupler la Terre dans The 100 lorsque l’air manque dans la station spatiale, soigner les blessés dans Pixel Noir, préserver le monde d’une catastrophe dans Gone). Cette démarcation n’en demeure pas moins inquiétante. Dans Gone, tout adolescent qui arrive au jour de ses quinze ans est sinistrement amené à disparaître, guidé par un monstre appelé l’Ombre qui, si elle prend d’abord la forme séductrice d’un père, d’une mère, reste indéfinissable, voire informe, lorsqu’elle révèle sa nature dévoratrice. Ainsi, contre des évolutions sociales qui tendent à indéfinir des tranches d’âges auparavant imposées, la fiction propose de renouveler le motif, ici presque littéral, d’une ligne d’ombre, pour reprendre l’expression de Conrad, séparant la jeunesse de l’âge adulte ; une ligne par-delà laquelle s’engloutirait « cette intensité particulière d’existence qui est la quintessence des aspirations de jeunesse 1 ».
Par ailleurs, la séparation d’avec les adultes n’est plus nécessairement le fait d’une lutte, révélant un changement de paradigme de ces aspirations de jeunesse. Dans Gone, les adultes mettent en danger le monde en risquant de faire entrer en fusion le cœur d’une centrale nucléaire. L’un des enfants, ayant comme d’autres déclaré certains pouvoirs, fait alors disparaître les adultes de la ville, qu’il protège d’un dôme devenu frontière infranchissable. Dans The 100, les adultes prennent la décision d’envoyer 100 prisonniers mineurs sur Terre afin d’y étudier les conditions de survie (la Terre a été évacuée suite à un conflit nucléaire). Dans Pixel Noir enfin, des adolescents blessés ou malades sont plongés dans un virtuel de réparation par des adultes chargés de les médicaliser. Il n’est donc pas question d’une lutte directe entre adultes et jeunes mais, plus généralement, d’une dialectique menace-survie située au-delà du simple conflit. Ce qui n’empêche pas d’aboutir à l’éveil et à la satisfaction d’un affranchissement vis-à-vis de la présence adulte.
Arrivés sur Terre, une grande partie des enfants et adolescents de The 100 célèbre la liberté acquise qu’ils ritualisent dans une cérémonie tribale de dé-technologisation. Les adolescents portent au poignet un bracelet qui communique aux adultes des informations nécessaires à l’évaluation de la possibilité de survie sur Terre. Dès lors, le retrait des bracelets recouvre deux sens : d’une part, il s’agit de faire croire aux adultes que les adolescents sont morts, qu’il est trop dangereux de revenir sur Terre. Après avoir été expédiés et abandonnés de force, les adolescents cherchent en retour un moyen d’abandonner les adultes à l’espace. D’où le deuxième sens au retrait des bracelets : celui d’une libération d’entraves, et d’une revendication d’autonomie – « on fera ce qu’on voudra » devient, très classiquement, la première devise de ces adolescents enthousiastes.
Il n’est donc pas question de supprimer les adultes : si dans chacun des trois cas la séparation est bien une question de survie, elle semble d’abord répondre à la nécessité d’accéder à un espace propre : non pas une chambre mais un monde à soi que l’on peut fermer à clé, sans être dérangé, pour reprendre les mots de Virginia Woolf. Le mur de la zone est longtemps infranchissable dans Gone, les adultes de Pixel Noir ne peuvent savoir ce qui se joue dans le virtuel de repos : à l’image des bracelets ôtés dans The 100, la fiction joue du besoin des enfants de rompre la communication, et de savoir leurs cris ne pas être relayés par le babyphone.
Cette décolonisation momentanée par effacement des adultes semble par ailleurs répondre à un besoin de communauté sur lequel insiste Jason Rothenberg dans The 100 via des images de rituels autour du feu, qui ne sont elles-mêmes pas sans rappeler ce que Elias Canetti écrit de la meute :
Dans la meute, […] l’individu ne peut jamais se perdre aussi complètement qu’un homme moderne dans n’importe quelle masse. Dans les constellations changeantes de la meute, dans ses danses et ses expéditions, il se tiendra toujours à son bord. Il sera dedans et aussitôt après au bord, au bord et aussitôt après dedans. Quand la meute fait cercle autour de son feu, chacun pourra avoir des voisins à droite et à gauche, mais le dos est libre ; le dos est exposé découvert à la nature sauvage 2.
Le cas de The 100 est d’autant plus éloquent qu’il limite très exactement le nombre de jeunes envoyés sur Terre. Cette réduction permet précisément l’avènement communautaire dont naît, pour Canetti, le phénomène d’intensité :
La densité de la meute a toujours quelque chose de feint : ils se serrent étroitement, sans doute, et dans leurs mouvements rythmiques traditionnels ils jouent à être nombreux. Mais ils ne le sont pas, ils sont très peu ; la densité réelle qui leur manque, ils la remplacent par l’intensité 3.
En évacuant les adultes, la fiction propose de remettre en jeu cette intensité de la jeunesse évoquée déjà par Conrad, ainsi que sa capacité à faire communauté : « Youth culture offers a collective identity, a reference group from which youth can develop an individual identity 4. »
La formule proposée en titre, « You shall not pass », n’est peut-être pas sans raison devenue un mème depuis la version cinématographique du Lord of the Rings de Tolkien par Peter Jackson (2001-2003) : qu’il s’agisse d’un virtuel de repos (où l’on peut, aussi, se reposer des adultes), d’un dôme infranchissable pour des adultes désormais « exo » ou d’une Terre recolonisée par des adolescents sans contact avec ceux qui les y ont expédiés, le sentiment géographique sur lequel insistent ces fictions double la quête d’un sentiment démographique fondé sur l’exploitation d’un écosystème culturel propre. À ce titre, la formule de Canetti est éclairante : dans la meute, l’individu ne peut jamais se perdre aussi complètement que dans la masse. Ainsi, à l’heure où culture de masse et culture de jeunesse tendent à s’indifférencier dans un discours commun qui, précisément, fait commun, les frontières des mondes sans adultes s’opposent à ce processus en autorisant un repli salutaire, une résistance de la jeunesse à la grande dévoration au profit du repas ritualisé de la meute : alors, « […] quelque chose d’un corps unique passe en tous ses membres. Ils prennent, mordent, mâchent, avalent la même chose. Tous ceux qui en ont mangé sont désormais liés par ce seul animal : il est contenu en eux tous à la fois 5 ». Et il n’est pas question d’en laisser quelque reste aux avides adultes.
Un Empire, est-ce un pouvoir ?
Cet abandon de la masse au profit de la communauté de chair fictionnelle n’est pas qu’une planche de salut pour ce qui serait une identité jeune en perdition. L’effacement provisoire des adultes n’évacue pas les luttes mais les redéfinit à l’aune d’une génération Hunger Games. Dans la trilogie de Suzanne Collins, un garçon et une fille de chaque district sont tirés au sort pour s’affronter à mort dans une arène filmée. La réduction des effectifs (de même que la répartition en secteurs) favorise certes le démantèlement de la masse, mais suggère également la redéfinition de l’adversaire.
Dans ces mondes sans adultes, c’est d’abord dans ses propres rangs que la jeunesse trouve des nouvelles proies à prendre en chasse. Dans Pixel Noir, les enfants sont mis sous la coupe d’un adolescent tyrannique. Dans Gone, des bandes se forment inévitablement, comme autant de conflits au gré desquels les victimes s’accumulent dans un cimetière de l’adolescence, dont les tombes sont creusées par d’autres adolescents. L’adulte ne s’efface donc pas pour accepter sa défaite devant l’adolescent ou lui abandonner tout pouvoir : sur le modèle des célèbres Hunger Games, il ne s’éclipse que pour mieux laisser les adolescents s’entretuer. Christian Chelebourg évoque à ce sujet un « sacrifice de la jeunesse pour l’hégémonie adulte ». Il poursuit : « La préservation de l’ordre adulte [passe] par une hécatombe de la jeunesse 6. » L’hécatombe est au rendez-vous : si elle est le principe fondateur des Hunger Games, elle n’en demeure pas moins essentielle et violente dans Gone ou dans The 100, qui tous deux insistent sur l’agrandissement progressif de l’espace occupé par le cimetière, nous permettant de lire les mondes sans adultes, paradoxalement, comme de possibles cimetières pour la jeunesse.
De fait, Benoîte Groult rappelle, dans une formule qui lui est attribuée, que le passage à l’âge adulte ne se réalise pas dans le meurtre des parents mais dans celui de l’enfant de ses parents. C’est très symboliquement que Gone met en scène une lutte fratricide, Sam étant contraint de combattre au fil des six tomes celui dont il découvre qu’il est le frère jumeau. Ce devenir-adulte dans le conflit contre soi et contre ses autres-soi parcourt les œuvres citées.
C’est que, sans adultes, la jeunesse n’a plus lieu d’être, pas plus qu’elle n’a, en réalité, d’occasion de se définir en tant que groupe différencié : en finir avec les adultes, ce serait aussi, peut-être, une manière d’imposer à la jeunesse d’en finir avec elle-même. Le retrait des adultes ne serait dans ce sens qu’un miroir aux alouettes, un dispositif aussi séduisant que, finalement, contraignant : car en disparaissant il n’est pas question de faire disparaître l’idée d’adulte mais précisément de la faire transiter, de l’insinuer, de la distiller discrètement : d’en faire, pour cette jeunesse-meute, une proie à digérer. La fiction de jeunesse semblerait ainsi avoir compris un principe énoncé par Christian Chelebourg : « À quoi servirait de tuer le père si l’on envie ni son statut, ni sa place 7 ? »
Le problème a donc changé de visage : il ne s’agit plus d’une lutte pour le pouvoir, d’une lutte des jeunes souhaitant s’emparer des privilèges supposés des adultes. Il s’agirait désormais de contraindre la jeunesse au pouvoir, de faire endosser aux jeunes le rôle du père et de la mère malgré eux, ainsi que le soulignent les nombreuses scènes de reproductions familiales dans les œuvres citées. La question mise au jour par ces mondes sans adultes n’est donc plus celle du vouloir pouvoir, mais du devoir vouloir, pour reprendre la formule de Montesquieu (voire du devoir vouloir pouvoir). La disparition des adultes n’est pas la disparition de l’adulte : auparavant rendu exo, l’adulte devient endo et émerge dans les adolescents que le lecteur rencontre. Si l’adolescent est mis en scène comme monde enchâssé au sein du monde adulte (la Zone dans Gone), l’adulte se révèle comme récit enchâssé dans l’adolescent qui bientôt le remplace, garant malgré lui de la préservation d’un ordre des choses qui lui apparaît, dans l’urgence, nécessaire. En somme, si la place du père ou du parent n’est plus enviée, il s’agit de contraindre l’envie.
Un Empire, est-ce un devoir ?
Dans Gone, un personnage évoque la disparition des adultes comme « le jour de la délivrance », et assume sa vision des événements : la catastrophe pourrait bien être une bénédiction :
On est sûrs de vouloir retrouver quelqu’un ? avait-il ironisé.
On a besoin des adultes, avait protesté Virtue de son air pédant.
Pour quoi faire ?
Pour…
Virtue en était resté perplexe 8.
L’absence de réponse à cette question pas si simple indique bien que la fiction se plaît ici à mettre en scène les craintes adultes d’être mis de côté et de ne pas être capable de s’accrocher, tel le terrible Hook, au pays imaginaire des enfants, ou d’être abandonnés dans les ténèbres comme une créature d’un autre temps au cri de « You shall not pass ! ». Cette angoisse parcourt les six volumes de la série sous les traits indéfinis de l’Ombre qui conduit les enfants à disparaître au jour de leurs 15 ans. Un moment désigné comme une « tentation », et auquel la survie de certains permet aux autres de s’y préparer :
Désormais, tous les enfants de la Zone savaient ce qui les attendait. Le temps semblait s’arrêter. Et, alors qu’on restait suspendu dans une espèce de limbes, la tentation se présentait sous les traits de la personne à qui on tenait le plus. Celle qu’on voulait retrouver à tout prix 9.
La tentation prend la forme d’une blessure narcissique d’un adulte tremblant de ne pas être la personne élue, attendue : en somme, de voir se réaliser la dislocation de l’adultocentrisme.
Les mondes sans adultes ne feraient donc, à ce titre, que nourrir le besoin d’adultes dans un monde qui désire s’en priver. Ce faisant, ils répondent à l’incommunicable expérience de l’« être adulte ». La formation de la Zone dans Gone illustre une demande de fiction et, plus encore, d’immersion fictionnelle comme outil de connaissance et de reconnaissance. Cette démarche immanente s’oppose à la démarche transcendante de la communicabilité : dans The 100 la transcendance adulte (métaphorisée par leur vie dans l’espace) est contrebalancée par l’expérience des adolescents envoyés sur Terre ; dans Gone les jeunes sont pris au piège d’un dôme qui les retient, une bulle d’immanence qui conduit à révéler l’adulte non plus comme hors-soi mais comme en-soi. La fiction met donc la jeunesse en situation d’expérimenter son besoin de l’adulte comme état, en même temps qu’elle s’amuse à rassurer l’adulte sur l’effectivité de son statut : on a besoin d’adultes pour… : il est bien question de remplir ces points de suspension.
La crise vécue par les personnages, qui n’est pas sans évoquer la crise adolescente, répond alors dans ces mondes sans adultes à la définition qu’en donne Antonio Gramsci :
[…] la crise, c’est précisément quand la capacité et la dynamique d’émergence sont atteintes, lorsque le nouveau n’arrive pas à surgir. […] La crise travestit jusqu’à la notion d’innovation si bien qu’elle ne produit jamais du nouveau, mais la simple continuation de l’ancien sous des dehors de rupture 10.
Les conditions d’émergence sont bel et bien réunies : les Cent découvrent que leur métabolisme supporte l’existence terrestre, les adolescents de Gone se découvrent des pouvoirs surnaturels. Cependant, la fiction met en scène cet espoir adulte que la crise (à défaut de la joie) demeure : les héros sont mis en situation d’urgence, contraints par la violence de leur état à l’impossibilité d’user de leurs capacités nouvelles pour faire émerger un monde nouveau. La rupture, notamment avec l’autorité parentale, ou plus généralement avec l’adulte comme monde extérieur, ne conduit qu’à la stase dans la nécessité soudaine d’appliquer un modèle connu. La crise de l’adolescence se présente ainsi dans ces récits comme la satisfaction adulte du désir de ne pas changer, comme la mise en fiction du principe suivant : s’effacer, c’est s’imposer.
Conclusion
Les mondes sans adultes sont des fictions de la déterritorialisation et de la reterritorialisation, qui sous-tendent chez Deleuze un imaginaire de la disqualification et de la possible requalification. De fait, le « vous ne passerez pas » intime à la fois l’appétit territorial de la jeunesse-meute et l’angoisse adulte d’une éviction intolérable.
La fiction de jeunesse, fiction de la roublardise, se plaît alors à conjuguer les discours pour conjuguer les satisfactions. Si l’adolescent semble se passer momentanément de l’adulte, c’est au prix d’un remplacement qui voit l’adulte émerger comme récit intérieur au cœur de l’aventure extérieure de l’adolescence transformée, intensifiée. Un monde à soi, certes, à la condition qu’il remplisse la satisfaction d’un désir dont l’adolescent lui-même est en passe de devenir demandeur : le besoin adulte de rester un besoin.
Sans pour autant revenir à une tradition édificatrice rendue plus discrète, la fiction de jeunesse ne cesse pas de nourrir cette « rage de civiliser 11 » qui l’anime, expression de Francis Marcoin qui conjugue la force du sauvage et du wild et l’appétit nerveux de policer les meutes. De fait, si cette pipe n’est pas une pipe, alors ces mondes sans adultes ne sont pas des mondes sans adultes : car mes fictions, comme mon langage, écrivait Roland Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux, sont elles-mêmes des adultes très civilisés.
- Joseph Conrad, La Ligne d’ombre, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 2010 [1917], p. 132.
- Elias Canetti, Masse et puissance, Paris, Gallimard, « Tel », 1986 [1960], p. 97.
- Ibid., p. 97-98.
- Michael Brake, Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures in America, Britain and Canada, Londres, Taylor and Francis e-Library, 2003 [1985], p. 191.
- Elias Canetti, Masse et puissance, éd. cit., p. 119
- Christian Chelebourg, Les Fictions de jeunesse, Paris, PUF, « Les Littéraires », 2013, p. 169.
- Christian Chelebourg, Les Fictions de jeunesse, Paris, PUF, 2013, p. 196.
- Michael Grant, Gone. Tome 3 : Mensonges, Paris, Pocket Jeunesse, 2014 [2010], p. 158
- Ibid. p. 200.
- Antonio Gramsci, Cahiers de prison 1 à 5, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1996, p. 283.
- Christian Chelebourg, Francis Marcoin, Cahiers Robinsons, n°38, « Civiliser la jeunesse », 2015, p. 7.
